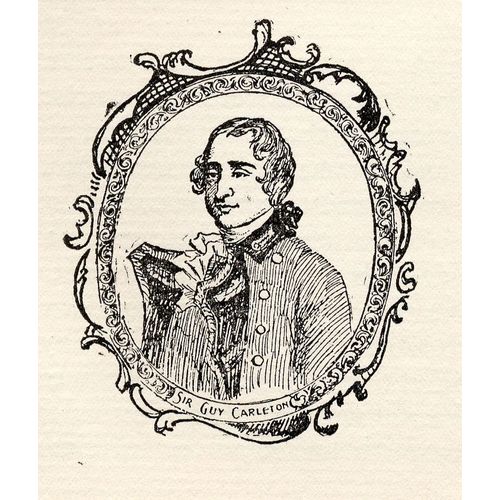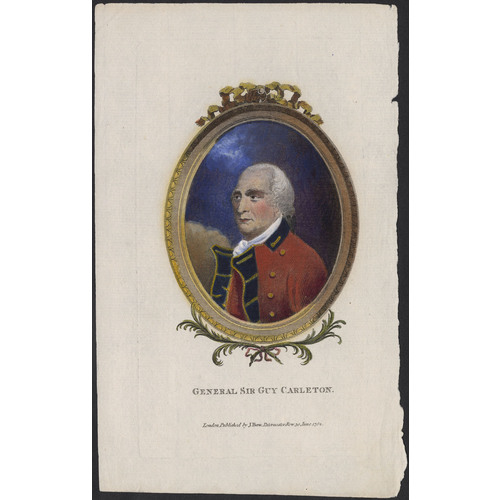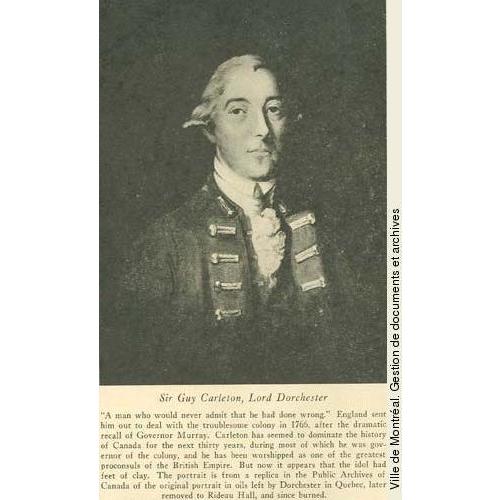Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
CARLETON, GUY, 1er baron DORCHESTER, officier et administrateur colonial, né le 3 septembre 1724 à Strabane, Irlande, troisième fils de Christopher Carleton et de Catherine Ball ; le 21 ou le 22 mai 1772, il épousa à Fulham (maintenant partie de Londres) lady Maria Howard, troisième fille du 2e comte d’Effingham, et ils eurent 11 enfants ; décédé le 10 novembre 1808 à Stubbings House, près de Maidenhead, Angleterre, et inhumé dans l’église St Swithun, à Nately Scures, Angleterre.
Originaires du comté de Cumberland, en Angleterre, mais habitant l’Irlande depuis le début du xviie siècle, les Carleton appartenaient à cette classe dirigeante protestante qui a si bien servi l’armée et l’administration coloniale britanniques. Le père de Guy Carleton était un propriétaire foncier modeste, selon les critères irlandais, qui mourut lorsque Guy avait environ 14 ans. L’année suivante, sa mère épousa le révérend Thomas Skelton, qui surveilla l’éducation du jeune garçon. Le 21 mai 1742, Carleton, âgé de 17 ans, reçut une commission d’enseigne dans le 25e d’infanterie (régiment de Rothes) et, trois ans plus tard, il y fut promu lieutenant. Le 22 juillet 1751, il se joignit au 1 st Foot Guards comme lieutenant (avec le grade de capitaine dans l’armée). Devenu aide de camp du duc de Cumberland, il reçut, le 18 juin 1757, le grade de lieutenant-capitaine dans son régiment (et celui de lieutenant-colonel dans l’armée) ; le 24 août 1758, il fut nommé lieutenant-colonel d’un nouveau régiment, le 72e d’infanterie. Entre-temps, James Wolfe* avait pris fait et cause pour lui et, en 1752, il l’avait recommandé comme précepteur militaire du jeune duc de Richmond. Six ans plus tard, Wolfe demanda les services de Carleton pour le siège de Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton). Apparemment agacé par le fait que Carleton avait dénigré les mercenaires allemands, George II s’y opposa et il fallut l’intervention de William Pitt et celle du commandant en chef, lord Ligonier, avant que Wolfe ne puisse obtenir, dans la personne de Carleton, les services du quartier-maître général et de l’officier du génie qu’il voulait pour donner l’assaut sur Québec.
Durant cette campagne, Carleton, qui avait reçu sa nomination et le grade de colonel en Amérique du Nord le 30 décembre 1758, fut chargé d’établir une base avancée à l’île aux Coudres et un dépôt d’approvisionnement fortifié à l’île d’Orléans. Il conduisit aussi une opération amphibie à Pointe-aux-Trembles (Neuville), d’où il revint avec des renseignements, quelques provisions et plus de 100 civils canadiens qui avaient été évacués de Québec. À la bataille des plaines d’Abraham, il commanda le 2e bataillon des Royal Americans (60e d’infanterie), l’un des trois bataillons déployés sous les ordres du général de brigade George Townshend, à la gauche de la ligne de bataille britannique. La blessure qu’il reçut à la tête tandis qu’il poursuivait l’ennemi peut expliquer son départ de la colonie en octobre 1759. Sans se comporter de façon spectaculaire, il avait fait bonne figure, conservant l’estime de Wolfe et acquérant un autre protecteur en la personne du vice-amiral Charles Saunders*.
De 1759 à 1763, Carleton participa à deux autres campagnes. Il fut gravement blessé le 8 avril 1761, au cours de l’attaque menée contre Port-Andro, à Belle-Île-en-Mer, au large de la côte nord-ouest de la France. Le 22 juillet 1762, pendant qu’il servait à Cuba comme quartier-maître général de l’armée sous les ordres du comte d’Albemarle, il reçut une autre blessure au cours du siège de La Havane. Il avait été promu colonel le 19 février 1762 ; deux ans plus tard, il passa du 72e d’infanterie au 93e et, le 3 octobre 1766, il reçut le grade de général de brigade en Amérique du Nord. Il avait été nommé « lieutenant-gouverneur et administrateur » de Québec le 7 avril de la même année, mais comme le gouverneur James Murray*, rappelé à Londres, restait officiellement en fonction, Carleton ne fut nommé « capitaine général et gouverneur en chef » que le 12 avril 1768.
On s’explique difficilement cette nomination, puisque Carleton ne possédait aucune expérience du gouvernement civil et n’avait qu’une connaissance restreinte de ce qui se passait à Québec. Mais, d’autre part, il avait des relations influentes. George III, qui se réjouissait de la nomination d’un « homme [aussi] gallant et sensé », le favorisa tout au long de sa carrière. ; Henry Seymour Conway, qui, en tant que secrétaire d’État au Département du Sud, l’avait choisi, jouissait d’une grande influence dans le gouvernement de Rockingham ; et le duc de Richmond, son ancien élève, n’allait pas tarder à remplacer Conway au Département du Sud. Plusieurs membres des gouvernements de Grafton et de North allaient aussi lui donner leur appui, en particulier lord Shelburne qui succéda à Richmond au poste de secrétaire d’État, sir Charles Saunders qui servit quelque temps comme premier lord de l’Amirauté, et les lords Hillsborough et Dartmouth qui occupèrent successivement le poste de secrétaire d’État aux Colonies américaines après sa création en 1768. Ainsi, malgré une vive dissension, qui par la suite se révéla paralysante, avec leur successeur au secrétariat d’État aux Colonies, lord George Germain, Carleton bénéficia d’un avantage inestimable qui avait manqué à Murray : une base politique solide dans la métropole.
La situation était tout aussi propice à Québec. Comme le nouveau gouverneur avait le commandement indiscutable de toutes les troupes de la colonie, le désaccord qui avait caractérisé les relations de son prédécesseur avec Ralph Burton* lui fut épargné. Il pouvait avoir toute confiance en Hector Theophilus Cramahé*, qui conserva son poste de secrétaire civil et qui, grâce à Carleton, allait devenir receveur général intérimaire, juge de la Cour des plaids communs, président du Conseil de Québec, administrateur de la colonie et, enfin, lieutenant-gouverneur. Le premier juge en chef, William Hey*, ainsi que le procureur général, Francis Maseres*, étaient des avocats de talent qui appuyèrent la politique de Carleton à ses débuts, même si, par la suite, ils s’opposèrent à ses recommandations. Les relations de Carleton avec le deuxième juge en chef, Peter Livius*, allaient se révéler difficiles, tandis qu’un autre procureur général, William Grant*, lui apporterait une aide efficace. Enfin, facteur le plus favorable de tous, les marchands, dont beaucoup avaient manifesté du mécontentement envers le gouvernement colonial dirigé par Murray, montraient maintenant de la bonne volonté.
On ne sait si Carleton fut véritablement sensible aux intérêts des marchands, mais il fit quelques gestes en leur faveur. Peu après son arrivée à Québec, le 23 septembre 1766, il accepta d’étudier les demandes pressantes de ceux qui, tel John McCord, voulaient une diminution des restrictions concernant la traite des fourrures et les pêcheries, et il ne tarda pas à recommander la suppression de ces restrictions dans la région de l’Ouest. Il suspendit l’introduction des lois anglaises sur la faillite, à laquelle plusieurs marchands s’étaient opposés, et appuya la location des forges du Saint-Maurice à un groupe d’hommes d’affaires qui comprenait des mécontents notoires comme James Johnston* et George Allsopp. Non seulement suggéra-t-il, en vain, que le premier soit nommé conseiller, mais il insista aussi pour qu’Allsopp soit rétabli dans ses fonctions de sous-secrétaire de la province et de greffier adjoint du bureau provincial des registres et du Conseil de Québec, postes dont Murray l’avait suspendu. En même temps, Carleton semblait vouloir se distancier de certains des conseillers les plus proches de Murray, que ce soit pour des raisons de politique ou en réaction au ressentiment qu’ils éprouvaient devant sa succession. De toute façon, Carleton était déterminé à établir son autorité sur le conseil, qui avait en fait remplacé l’assemblée promise dans la Proclamation royale du 7 octobre 1763.
Carleton en eut bientôt l’occasion grâce à un conflit portant sur les territoires de traite connus sous le nom de postes du roi, loués exclusivement à Thomas Dunn, à William Grant (1744–1805) et à John Gray. Le 8 août 1766, avant l’arrivée de Carleton, le conseil avait ordonné la destruction de postes non autorisés, construits dans ces territoires par Allsopp et ses associés, Edward Chinn et Joseph Howard*. Cependant, Carleton considérait les restrictions apportées à la traite des fourrures aux postes du roi « tellement dérisoires » qu’il suspendit l’ordre « injuste », avec la connivence de cinq conseillers, Hey, Cramahé, James Goldfrap, Thomas Mills* et Paulus Æmilius Irving*. Puis, quand quatre des conseillers qu’il n’avait pas consultés (Adam Mabane*, François Mounier*, James Cuthbert* et Walter Murray*) protestèrent avec Irving contre « la liberté que [Carleton] av[ait] prise peu auparavant de ne réunir qu’une partie des membres du Conseil », il leur répondit qu’il avait l’intention de s’entretenir avec tous ceux qu’il lui plairait de choisir, à la seule condition que ce soient des « personnes [...] dont [il] connaîtr[ait] le jugement sûr, la sincérité, la droiture et l’esprit de justice ».
Un deuxième incident permit à Carleton de renforcer son autorité. En novembre, Thomas Walker* était parvenu à faire rouvrir son procès à la suite de ses protestations concernant l’acquittement de ses assaillants dans l’épisode qui avait précipité le rappel de Murray. Puis, ayant convaincu les autorités d’arrêter six nouveaux suspects, dont le juge John Fraser, il refusa de donner son consentement à leur mise en liberté sous caution. En plus de signer une pétition demandant au gouverneur d’intervenir, certains conseillers participèrent à une manifestation publique ; Carleton profita alors de l’occasion pour les mettre au pas. Il destitua Mabane et Irving, qu’il ait ou non vraiment jugé nécessaire, comme il l’expliqua à Shelburne, « de faire quelque exemple et ainsi de dissuader tout le monde de créer de tels désordres, et en particulier de convaincre les Canadiens que de telles pratiques [étaient] contraires aux lois et coutumes [britanniques] ». Le résultat comblait ses espérances et correspondait probablement à ce qu’il avait essayé d’obtenir : la docilité d’un conseil effrayé et la possibilité d’imprimer une nouvelle direction à la colonie.
Cependant, malgré ses préventions contre les partisans de Murray, Carleton ne tarda pas à apprécier à sa juste valeur le raisonnement de son prédécesseur. Dès le 25 novembre 1767, il informa Shelburne que la plupart des « anciens sujets », qui se composaient, selon sa propre description, « d’officiers, de soldats licenciés et de ceux que l’armée traînait à sa suite [...], des trafiquants de hasard ou des gens qui ne pouv[aient] plus demeurer [chez eux] », quitteraient probablement la province d’ici « à quelques années ». Par contraste, les « nouveaux sujets », qui « se multipli[aient] chaque jour », deviendraient relativement encore plus nombreux, de sorte que, « s’il ne surv[enait] aucune catastrophe qu’on ne saurait prévoir sans regret, la race canadienne [devrait, jusqu’à la fin des temps], peupler ce pays ».
Mais ce n’était ni les proportions numériques, ni les différences culturelles, ni même les valeurs sociales qui préoccupaient Carleton ; à cette époque, sa principale inquiétude semble plutôt avoir été la sécurité. Il craignait un retour possible des Français, appréhendait une révolte des habitants et s’alarmait de la dissension croissante dans les Treize Colonies, n’ayant, selon ses propres calculs, que 1 627 soldats et 500 immigrants britanniques à opposer aux 76 675 habitants conquis (y compris quelque 7 400 Indiens). Ce n’était donc pas seulement juste mais diplomatique que de gouverner la colonie d’une façon satisfaisante pour l’écrasante majorité, de sorte que les Canadiens témoignent « un attachement et un dévouement sincères envers le gouvernement du roi ». Comme Murray l’avait constaté, la façon la plus sûre d’atteindre ce but était de les gouverner indirectement, par l’intermédiaire de leurs chefs « naturels », les seigneurs et le clergé.
Par conséquent, Carleton fit tout pour se concilier les seigneurs, proposant de les admettre au conseil, de leur donner des postes dans le gouvernement, de leur offrir des commissions dans « quelques compagnies canadiennes d’infanterie » et même de les indemniser (par une hausse du prix des permis d’alcool) de l’arrêt du paiement de leurs traitements par la France. Il appuya en particulier ceux qui, comme Joseph Deguire*, dit Desrosiers, sentaient qu’on les escroquait, il recommanda le versement de pensions pour d’autres, tel Jean-Baptiste-Marie Blaise Des Bergères de Rigauville, que Murray avait nommés à certaines fonctions, et il obtint des postes pour ceux qui voulaient servir la couronne britannique, notamment Blaise Des Bergères de Rigauville, Gaspard-Joseph Chaussegros* de Léry, Joseph Fleury* Deschambault, Louis-Joseph Godefroy* de Tonnancour, Luc de La Corne*, Claude-Pierre Pécaudy* de Contrecœur, François-Marie Picoté* de Belestre, Charles-François Tarieu* de La Naudière et Thomas-Ignace Trottier* Dufy Desauniers.
Carleton prolongea aussi le concordat conclu entre Murray et Mgr Briand* ; de cette façon, non seulement il s’acquit la coopération de la hiérarchie catholique, mais il exerça aussi une certaine influence sur les affaires ecclésiastiques. Il s’était « fait un devoir d’être attentif aux propositions de tout le clergé, tant séculier que régulier, et d’étudier le caractère des hommes ». C’est ainsi qu’il encouragea Jean-Baptiste Curatteau* lequel avait ouvert en 1767 l’école secondaire qui allait devenir le petit séminaire de Montréal, qu’il aida sœur de l’Assomption [Marie-Josèphe Maugue-Garreau*] à acheter le fief de Saint-Paul pour la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, et qu’il défendit les jésuites contre les accusations lancées par l’ex jésuite Pierre-Joseph-Antoine Roubaud*, selon lesquelles ceux-ci faisaient parvenir des « sommes considérables » à la France. Chose plus importante encore, Carleton assura réellement la continuité de l’épiscopat en approuvant la nomination d’un coadjuteur, malgré le refus de Hillsborough d’autoriser ce type de nomination, et au prix de la désapprobation ultérieure de Dartmouth. En effet, son candidat, Louis-Philippe Mariauchau* d’Esgly, devint, le 12 juillet 1772, le premier évêque né au pays, en accord avec le souhait de Carleton d’accorder la préférence à des Canadiens.
Cependant, pour rendre le Régime anglais acceptable, il fallait aussi s’occuper des Canadiens ordinaires. Afin de venir en aide à l’économie, Carleton favorisa la production des céréales, du chanvre, du lin, de la potasse et du fer ; il s’opposa à l’interdiction faite aux Canadiens de fabriquer des produits manufacturés, laquelle fabrication, selon certains marchands, réduirait la vente de marchandises britanniques ; il obtint que des trafiquants de fourrures, tel Daniel-Marie Chabert* de Joncaire de Clausonne, puissent avoir la permission de se rendre chez les Indiens ; il recommanda d’employer des Canadiens comme guides et interprètes dans des expéditions d’exploration ; il fit droit à leurs revendications concernant la pêche hivernale au phoque au large de la côte nord du Saint-Laurent ; et il insista pour qu’ils aient droit, au même titre que les Britanniques, au dédommagement pour la monnaie de papier émise par le gouvernement français avant la Conquête. Il s’intéressa aussi aux réformes sociales : sous sa direction, le conseil adopta des ordonnances concernant la réparation des routes, la lutte contre les incendies et leur prévention, la réglementation des métiers de boulanger et de pilote fluvial, l’octroi de licences aux tavernes et la limitation du crédit offert par les aubergistes. À la suite d’une recommandation de Carleton à Shelburne en décembre 1767, de la préparation d’une ébauche d’ordonnance et du renouvellement de la recommandation en mars 1768, les autorités britanniques acceptèrent, en juillet 1771, que toutes les nouvelles concessions de terre soient accordées en tenure seigneuriale seulement. Enfin, on limita à la fois la perception d’honoraires par les fonctionnaires et l’exercice du pouvoir par les juges de paix.
Carleton s’opposait fortement au système britannique des honoraires, selon lequel ceux-ci venaient s’ajouter aux salaires, en paiement de services particuliers. Il déclara : « étant donné que le fait d’exiger des honoraires en toute occasion s’accompagne d’une certaine forme de saleté et d’une sorte de mesquinerie qui semblent accrues à cause de la nouveauté de cette pratique et en comparaison avec le gouvernement précédent, je pense qu’il faut pour le service du roi que l’on croit au moins son représentant sans souillure », et il renonça publiquement à toutes les gratifications qui s’attachaient à son propre poste. Puis, en décembre 1767, il expliqua à Shelburne : « Il me paraît non moins essentiel d’empêcher tous les principaux fonctionnaires de la justice et du gouvernement, y compris le gouverneur, les juges, le secrétaire, le grand prévôt et le greffier du Conseil, de recevoir des honoraires, des récompenses ou des présents. » Indépendamment de la question de savoir si on pouvait modifier légalement cette pratique par un acte de l’exécutif, son abolition aurait entraîné le versement de salaires beaucoup plus élevés, que le gouvernement britannique ne pouvait tout simplement pas payer. Mais malgré l’impuissance de Carleton à supprimer cette pratique, il réussit à la restreindre en obtenant de Hillsborough l’autorisation de « réduire le montant des honoraires dans certaines limites déterminées », en persuadant le conseil de fixer ces montants, en révoquant des fonctionnaires qui demandaient des honoraires excessifs, et même en convainquant les autorités de la métropole d’augmenter les salaires.
À la suite de plaintes concernant les juges de paix, Carleton nomma une commission d’enquête qui confirma que ceux-ci outrepassaient souvent leur autorité et étaient particulièrement enclins à saisir des terres ou même à envoyer des gens en prison « pour effectuer le paiement de toute dette, quelque minime qu’elle soit ». Le 1er février 1770, le conseil adopta donc une ordonnance selon laquelle toutes les causes relatives à la propriété privée ainsi que les litiges concernant des sommes de moins de £12 passaient de la juridiction des juges de paix à celle de la Cour des plaids communs. Cette loi donna aussi à Montréal sa propre Cour des plaids communs, remplaça la coutume anglaise selon laquelle la loi fixait les sessions par la tradition française des séances continues, réglementa les saisies portant sur la propriété dans les procès pour dettes et limita les honoraires des huissiers. Cependant, les juges de paix (notamment Pierre Du Calvet*, qui avait critiqué auparavant ses collègues) s’offensèrent de ces décisions. Ces réactions ainsi que la protestation que Charles Grant rédigea le 21 avril 1770 démontraient qu’il fallait faire une enquête générale sur l’administration de la justice.
Il semble que Carleton avait déjà conclu à cette époque que la politique d’anglicisation contenue implicitement dans la Proclamation de 1763 devait être adoucie sinon abandonnée. Dès décembre 1767, il déclara à Shelburne que Murray était allé trop loin avec son ordonnance du 17 septembre 1764 établissant le système judiciaire anglais, et qu’il serait judicieux de « maintenir [...] les lois canadiennes presque intactes ». Deux ans plus tard, en septembre 1769, se fondant sur des comptes rendus de Maurice Morgann, envoyé d’Angleterre pour étudier la situation, et du juge en chef Hey, qui n’était pas d’accord avec certaines des conclusions de Morgann, Carleton rejeta l’opinion de Maseres, selon laquelle il fallait hâter l’anglicisation. À la place, il préconisa exactement le contraire : certaines lois et coutumes anglaises (le droit criminel, l’habeas corpus, les jugements par jury dans le cas des actions personnelles, la « coutume des marchands » dans les causes commerciales et les lois sur le commerce et la navigation) pourraient continuer de s’appliquer, mais pour le reste les lois françaises devraient être rétablies. De plus, il fallait destituer les huissiers, rendre aux officiers de milice leur autorité civile, nommer des magistrats de police dans toutes les villes. La cour devait tenir des séances hebdomadaires dans tous les districts, et il était nécessaire d’affirmer et d’étendre l’autorité législative du gouverneur et du conseil. À l’appui de ces idées, Carleton envoya aux autorités de la métropole un abrégé des lois françaises préparé par son secrétaire de langue française, François-Joseph Cugnet*, lequel avait rédigé un résumé préliminaire à la fin de 1767 ou au début de 1768 et qui, à la demande du gouverneur, collaborerait plus tard avec Joseph-André-Mathurin Jacrau* et Colomban- Sébastien Pressart* à la compilation de ce qu’on appela dans la colonie l’« Extrait des Messieurs », publié à Londres en 1772–1773.
La réforme judiciaire, ou ce que certains voyaient comme une réaction dans le domaine judiciaire, constituait la principale réponse de Carleton aux problèmes des institutions de la province de Québec. Comme il l’expliqua à Shelburne en novembre 1767, le « système de lois » devrait être « la base de tout, sans quoi tout projet ne val[ait] guère mieux que châteaux en Espagne ». L’autre remède proposé – l’établissement d’un gouvernement représentatif – ne l’intéressait pas du tout. Au contraire, il l’alarmait positivement. Comme il l’écrivit à Shelburne en janvier 1768, quelles que soient les revendications des marchands, « les Canadiens qui appart[enaient] à la classe élevée ne craign[aient] rien tant que les assemblées populaires, qu’ils ne cro[yaient] bonnes qu’à rendre le peuple insoumis et insolent ». Convaincu que « la forme de gouvernement britannique implantée sur ce continent ne produira[it] jamais les mêmes résultats qu’en Angleterre », il fit cette mise en garde : « une chambre d’assemblée qui saurait faire valoir toute sa force dans un pays où les hommes sont presque tous égaux devrait donner une forte impulsion aux principes républicains ». Il ajouta que de toute façon « la situation du Canada était telle, qu’après avoir étudié ce projet maintes fois, [il] n’avai[t] encore pu élaborer un plan qui ne présentait pas quelque inconvénient et quelque danger ».
À ce stade, les autorités de la métropole ne semblaient pas être entièrement d’accord avec Carleton. L’opinion que Fletcher Norton et William de Grey exprimèrent le 10 juin 1765, la recommandation que firent Charles Yorke et de Grey le 14 avril 1766 et les instructions au gouverneur préparées en juin 1766, mais non envoyées, révèlent toutes qu’à Londres on avait aussi envisagé d’utiliser davantage les lois et les coutumes françaises, mais on paraissait avoir des opinions différentes sur la question du gouvernement représentatif. En mai 1767, Shelburne conseilla de convoquer une assemblée ; les instructions que Carleton reçut en 1768 lui ordonnaient de faire cette convocation « dès que les affaires les plus pressantes du gouvernement [...] le permettr[aient] » ; de plus, en juillet 1769, le Board of Trade jugea que « dans l’état [où se trouvait la province] de Québec, il [était] nécessaire d’établir une législature complète ». Là-dessus, Carleton résolut d’aller en personne faire valoir ses arguments. Il laissa l’administration à Cramahé et, le 1er août 1770, il s’embarqua pour Londres, où il passa les quatre années suivantes à faire des pressions pour l’adoption d’une constitution qui « préserverait la bonne humeur et l’harmonie parfaite » dans la colonie.
Le gouvernement britannique répondit en adoptant l’Acte de Québec de 1774 (14 George III, chap. 83) ainsi que la loi sur le revenu de Québec (14 George III, chap. 88), et publia trois séries d’instructions en 1775. La différence frappante entre ces lois et la Proclamation de 1763 réside dans le fait qu’on refusait maintenant de donner une assemblée à la colonie. À la place, on la dotait d’un « Conseil législatif », dont les membres seraient nommés par le gouverneur, qui pourrait les destituer. Celui-ci pourrait rejeter les projets de loi présentés par ce conseil ou les suspendre pour que les autorités de la métropole les étudient. Enfin, les pouvoirs du conseil en matière d’impôts se limitaient au financement indirect des routes et des édifices publics. En outre, la politique d’anglicisation ne devait pas seulement être retardée, mais oubliée. On assurait les Canadiens qu’ils pourraient « conserver et jouir de leurs propriétés et biens, et des coutumes et usages qui se rattach[aient] à ceux-ci, ainsi que de leurs autres droits civils » ; quant aux litiges concernant « la propriété et les droits civils », on aurait recours aux « lois du Canada » seulement ; on permettrait aux catholiques de remplir des fonctions publiques ; et « les dus et redevances ordinaires » de l’Eglise de Rome (et ceux des seigneurs, par déduction) seraient respectés. Finalement, on restituait à la colonie une grande partie de l’empire commercial qu’on lui avait enlevé en 1763 : la province de Québec comprendrait une fois encore les pêcheries au large de la côte du Labrador, ainsi que les territoires de traite des fourrures situés à l’Ouest, dans l’arrière-pays, jusqu’au confluent de l’Ohio et du Mississippi.
Il est impossible d’évaluer quelle fut la part de Carleton dans l’adoption de ces mesures. Celles-ci correspondaient aux idées générales qu’il avait exposées depuis quelque temps, ainsi qu’aux opinions particulières qu’il exprima dans sa déclaration devant la chambre des Communes, les 2 et 3 juin 1774. On peut cependant retrouver nettement son influence par un côté négatif : la décision d’omettre dans le projet de loi une disposition qui apparaissait dans la troisième ébauche, autorisant expressément des conversions de la tenure seigneuriale en franche tenure. Mais d’autres dignitaires jouèrent aussi un rôle, et il ne faut pas mésestimer la contribution des lords Dartmouth, Hillsborough et Mansfield, et plus particulièrement celle des légistes de la couronne, James Marriott, Edward Thurlow et Alexander Wedderburn. En outre, par certains de ses aspects fondamentaux, l’Acte de Québec allait à l’encontre des orientations de Carleton. Les déclarations de Hey et de Maseres avaient fait naître des inquiétudes que partageaient beaucoup d’hommes d’État de premier plan, dont lord Chatham, lord John Cavendish, Edmund Burke, Charles James Fox, Thomas Townshend, Isaac Barré, John Dunning et John Glynn, de même que lord Effingham et sir Charles Saunders. En conséquence, on devait rendre obligatoire l’utilisation du droit criminel anglais, que Carleton avait commencé à contester, et dont il regrettera plus tard l’usage ; on pourrait invoquer le droit foncier anglais et concéder des terrains en franc et commun socage ; le gouverneur et le conseil pourraient adopter des ordonnances modifiant les « droits et coutumes du Canada » ; et on pourrait prendre des dispositions pour « l’entretien et le maintien d’un clergé protestant dans ladite province, pour l’encouragement de la religion protestante ». Comme on le verra, la teneur anglicisante de ces mesures est encore plus apparente dans les instructions au gouverneur, lesquelles auraient été beaucoup moins favorables aux Canadiens que les mesures souhaitées par Carleton ou que celles que l’Acte de Québec est souvent présumé avoir mises en vigueur.
Carleton n’avait pas l’habitude d’expliquer ses objectifs, et on ne peut que s’interroger sur les raisons qui motivèrent sa ligne de conduite. Il se peut qu’il ait essayé de donner à la colonie des lois et des institutions convenant, selon lui, à une société qui serait toujours à prédominance canadienne. Il est possible qu’il ait espéré éviter le genre de différend qui s’était produit dans le cas des Treize Colonies. Il a peut-être craint que les immigrants britanniques acquièrent un pouvoir législatif dont ils se serviraient contre les Canadiens. On peut penser qu’il a eu l’intention de faire respecter l’ordre dans l’Ouest, ou de cultiver ses relations avec les Indiens, ou encore de freiner la colonisation américaine. Et sa stratégie globale aurait pu avoir pour but d’assurer au moins l’inertie des Canadiens dans le cas d’une tentative de la France pour reprendre Québec ou d’une révolution éclatant au sud de la frontière.
Quelles qu’aient été les raisons de la politique de Carleton, elle eut certaines conséquences aussi fâcheuses qu’imprévues, ou tout au moins sous-estimées. Les seigneurs et le clergé obtenaient satisfaction, mais les habitants, contraints encore une fois de payer les redevances seigneuriales ainsi que les dîmes, étaient réellement inquiets. Quant aux marchands, à qui on avait refusé l’introduction du droit anglais et l’établissement d’un gouvernement représentatif, ils considéraient l’Acte de Québec « avec horreur » et accusaient Carleton d’être « le premier auteur et le grand instigateur de ce fléau ». D’autre part, bien que des habitants canadiens et certains marchands britanniques aient rejoint les rangs des rebelles américains, la majorité restait passive, comportement peut-être dû en partie aux bénéfices indiscutables que les deux groupes avaient reçus. La plupart des Canadiens se rendirent probablement compte que leurs droits de propriété et leurs droits civils, de même que leur religion, auraient été beaucoup moins assurés sous la domination des Américains que sous celle des Britanniques, et la majorité des marchands a dû savoir que ses intérêts naturels, favorisés par le recul des frontières, la plaçaient aussi du côté de la loyauté. Après tout, il se peut bien que l’Acte de Québec ait contribué à garder le Canada dans le giron britannique.
Après son retour à Québec, le 18 septembre 1774, Carleton se heurta à des difficultés avec le Conseil de Québec, où les marchands avaient renforcé leur position, et avec le gouvernement britannique qui cherchait à clarifier sa politique d’anglicisation, ou peut-être à la modifier. L’un des premiers gestes de Carleton fut de nommer au poste de conseiller sept seigneurs catholiques et plusieurs membres du French party, notamment Adam Mabane qu’il avait destitué en 1766. Mais, tandis que les autorités de la métropole ratifiaient toutes ces nominations dans les instructions du 3 janvier 1775, elles ordonnaient aussi de faire un certain nombre de concessions aux colons britanniques. Le nouveau Conseil législatif devait introduire l’ordonnance d’habeas corpus et envisager de faire du droit anglais, « sinon entièrement, du moins en partie, la règle » pour les causes relatives aux contrats et aux dommages ; il fallait réorganiser complètement les tribunaux et y assurer une prédominance britannique, même à la Cour des plaids communs ; et on devait faire des tentatives sérieuses pour favoriser « l’Église protestante d’Angleterre », seul organisme habilité à avoir les pouvoirs et les privilèges d’une « Église établie ».
Carleton réagit de façon typiquement arbitraire à ces instructions. Il ne respecta pas l’ordre de Dartmouth « de persuader les sujets nés britanniques de la justice et de l’opportunité de la présente forme de gouvernement et de la considération qui a[vait] été accordée à leurs intérêts », et décida non seulement de garder ses ordres secrets, mais de résister à tout mouvement d’anglicisation. En conséquence, quand le conseil, réuni pour la première fois le 17 août 1775, aborda la question des propositions de Hey concernant la réforme du système judiciaire, Carleton se rangea du côté des seigneurs et du French party contre l’introduction de l’habeas corpus, du jugement par jury dans les causes civiles et contre l’usage limité du droit commercial anglais. Puis il prorogea le conseil et, à partir de 1776, il gouverna la province en prenant avis d’un « comité du conseil », dont la formation avait été autorisée dans ses instructions afin de traiter des affaires, « à la seule exception des actes législatifs ». Carleton nomma à ce comité, connu sous le nom de « conseil privé » du gouverneur, cinq conseillers à qui il croyait pouvoir faire confiance : Cramahé, Mabane, Thomas Dunn, John Collins* et Hugh Finlay.
Préoccupé, de toute évidence, par les concessions prévues pour les colons britanniques, Carleton modifia aussi le système judiciaire projeté par les autorités de la métropole. Selon leurs instructions, il créa de nouvelles Cours des plaids communs pour les districts de Québec et de Montréal et fit en sorte qu’à chacune d’elles siègent deux juges britanniques et un juge canadien. Cependant, son choix des candidats à ces postes révèle ses propres tendances : à Mabane et à Dunn, qui avaient siégé à l’ancien tribunal, vint s’adjoindre Jean-Claude Panet* à la cour de Québec, tandis que Gabriel-Elzéar Taschereau était nommé à la cour de Montréal, en compagnie de Peter Livius et de William Owen qui avaient reçu leur commission de juge en Angleterre. Puis, afin d’imposer la tenue de procès civils, Carleton créa six postes de « gardien de la paix », choisissant encore une fois des hommes sur qui il pouvait compter pour comprendre les Canadiens : en plus de Mabane, Dunn, Panet et John (Jean) Marteilhe, il nomma deux autres juges de l’ancienne Cour des plaids communs, John Fraser et René-Ovide Hertel* de Rouville. Pour la première fois sous le Régime anglais, des catholiques devenaient juges de paix.
Carleton agit avec encore plus de liberté dans l’application de ses instructions concernant les affaires ecclésiastiques. Pour rassurer Briand, troublé par la mention « suprématie du roi » dans l’Acte de Québec, il interpréta cette expression comme ne constituant pas un rejet implicite du statut du pape en tant que chef de l’Église. Carleton n’accéda pas à la demande d’Étienne Montgolfier*, supérieur des sulpiciens de Montréal, qui souhaitait que les séminaires soient autorisés à recruter des membres en France, mais il permit à deux Français, Arnauld-Germain Dudevant* et Jean-Baptiste Lahaille, d’immigrer en 1775, pour se joindre au séminaire de Québec, et de rester dans la province après leur ordination. Il attacha peu d’importance à son devoir de restreindre les pouvoirs des évêques, de surveiller les nominations aux bénéfices et d’inspecter les communautés religieuses. Au lieu de supprimer l’ordre des jésuites, il établit de bonnes relations avec son supérieur général, Augustin-Louis de Glapion*, fermant effectivement les yeux sur le maintien de cet ordre au Canada, en dépit de sa dissolution par le pape. Il ne prit pas au sérieux, au point d’être négligent, la demande de « favoriser » l’Église d’Angleterre. En fait, bien qu’il ne pût éviter la collation de deux ministres anglicans, celle de l’ancien récollet Leger-Jean-Baptiste-Noël Veyssière*, à Trois-Rivières, et celle du Suisse protestant David François de Montmollin, à Québec, il empêcha cependant ce dernier de percevoir des dîmes, évitant ainsi de créer un précédent. Par suite de toute cette tolérance, la hiérarchie catholique, qui aurait pu faire obstacle à la politique de Carleton, ne se contenta pas d’être neutre, mais devint une alliée.
Avec le début de la rébellion américaine et la menace d’invasion qui en découla, Carleton eut besoin de toute l’aide qu’il put trouver. Il avait envoyé deux de ses cinq régiments à Boston en septembre 1774, en conformité avec une requête du major général Thomas Gage*, commandant en chef, mais cela avait sérieusement affaibli les défenses de la colonie. On leva un régiment de colons britanniques, le Royal Highland Emigrants, et Carleton ressuscita son projet d’un corps canadien, qui encore une fois ne parvint pas à se matérialiser. Il fondait cependant son plus grand espoir sur la milice, à laquelle le peuple devait se rallier, comme il en assura Gage ainsi que les autorités de la métropole. Mais le peuple ne répondit pas aux attentes de Carleton, qui essaya en vain de rassembler le contingent de 6 000 hommes exigé par Dartmouth, en proclamant la loi martiale en juin 1775. Deux ans plus tard, à la suite d’une enquête sur la déloyauté dans la milice [V. François Baby ; Edward William Gray], le conseil adopta une ordonnance destinée à renforcer l’autorité du gouvernement en imposant le service militaire. Mais tandis qu’on augmentait l’effectif de la milice, qui en définitive se révéla plus qu’utile, les Canadiens ne donnèrent jamais leur appui tant attendu. En fait, de nombreux nouveaux sujets, comme Maurice Desdevens* de Glandons, Clément Gosselin et Philippe Liébert, de même que certains colons britanniques et américains, tels Moses Hazen, James Livingston, Zachary MacAulay* et Thomas Walker, appuyèrent activement les rebelles, au point de rejoindre leur armée dans certains cas.
Profondément désabusé, Carleton conçut une méfiance frôlant le mépris pour les Canadiens. Il fit cette observation amère à Germain en septembre 1776 : « je crois qu’il n’y a rien à craindre de leur part aussi longtemps que nous serons dans la prospérité, et rien à espérer dans un temps de détresse. Je parle de ce peuple d’une manière générale ; il s’en trouve quelques-uns qui sont guidés par des sentiments d’honneur, mais la multitude n’est influencée que par l’appât du gain ou la crainte des punitions. » Il déclina aussi toute responsabilité pour leur piètre comportement et, en agissant ainsi, il annonça sa future ligne de conduite. Dans une lettre au major général John Burgoyne*, en date du 29 mai 1777, il éleva la protestation suivante : « Si le gouvernement a compté tant soit peu sur l’aide des Canadiens pour supporter la présente guerre, il ne s’est certainement pas fondé pour cela sur les renseignements que je lui ai transmis. L’expérience aurait dû lui démontrer que-ce dont je n’ai pas eu besoin pour me convaincre – ce peuple n’a pas été gouverné d’une manière assez ferme depuis plusieurs années, qu’il s’est trop pénétré des idées américaines d’émancipation et d’indépendance propagées par les nombreux adeptes d’une faction turbulente de cette province, pour le faire revenir promptement à la pratique d’une juste et désirable subordination. »
Quant aux autres alliés possibles, les Indiens, le major général Charles Lee accusa Carleton de les pousser à « déterrer la hache de guerre contre les colonies ». En fait, tout en convenant que les Indiens pourraient jouer un rôle d’appui et qu’on devait les maintenir dans de bonnes dispositions, Carleton refusa inflexiblement de les lancer contre les colons américains. Gage avait encouragé leur emploi depuis septembre 1774, et Germain se rendit à cette idée en mars 1777. Un certain nombre de fonctionnaires en poste dans la colonie – en particulier Edward Abbott, lieutenant-gouverneur de Vincennes (Indiana) – soutenaient que les Indiens pourraient sauver la vie des Britanniques, et la faction Johnson au département des Affaires indiennes – notamment Guy Johnson*, Christian Daniel Claus* et Joseph Chew* – était en faveur d’une guerre menée par les Indiens. Cependant, Carleton stipula qu’on devait seulement employer les Indiens « de concert avec des troupes », où ils seraient « sous une direction appropriée ». Il rencontra les Six-Nations à Oswego (New York) en juillet 1775, et leur interdit de prendre le sentier de la guerre. En juillet 1776, il renvoya un groupe d’Outaouais qui s’étaient rendus à Montréal pour y offrir leurs services ; en août, il ordonna à Burgoyne de renvoyer les Indiens qui se trouvaient sous son commandement, et, en février 1777, il pria le major John Butler* et le capitaine Richard Berrenger Lernoult d’empêcher leurs guerriers de se lancer seuls dans des sorties. Il justifia officiellement ces décisions en affirmant qu’on ne pouvait compter sur les Indiens. Mais on peut discerner la principale raison de ces ordres dans l’explication qu’il fournit à Lernoult : « Même s’il est approprié et justifiable d’employer les Indiens dans une guerre défensive ou pour punir les vrais criminels, la véritable politique, ainsi que l’humanité, interdit cependant de permettre une attaque aveugle, telle que les Sauvages ont l’intention de déclencher, dans laquelle les femmes et les enfants, les vieillards et les infirmes, les innocents de même que les coupables seraient indifféremment exposés à leur violence. »
Le 27 juin 1775, le deuxième Congrès continental décida d’envahir la province de Québec. En accord avec les ordres de Gage, selon lesquels il fallait défendre la vallée du Richelieu, route historique d’invasion, Carleton envoya d’urgence la plupart de ses troupes de Québec à Montréal, où il établit son quartier général. Au fort Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu), de même qu’au fort Chambly, il tint le général de brigade Richard Montgomery* à distance jusqu’au début de novembre. Il fut alors forcé de se replier jusqu’à la capitale, menacée par une autre armée d’invasion qui, celle-là, avait traversé le Maine et que commandait Benedict Arnold. Durant le siège qui suivit et qui allait se prolonger six mois, le seul assaut contre Québec, au petit matin du 31 décembre, fut repoussé avec seulement 20 pertes de vie du côté britannique, alors que de 60 à 100 Américains furent tués ou blessés et environ 400 capturés. Certaines personnes ont critiqué Carleton pour ne pas avoir lancé immédiatement une contre-attaque, tandis que d’autres l’ont félicité pour avoir attendu jusqu’à l’arrivée d’une flottille qui apportait des renforts, le 6 mai 1776 [V. sir Charles Douglas*].
La façon dont Carleton poursuivit les envahisseurs en fuite a également provoqué une controverse et a soulevé quelques questions. À trois reprises – près de Trois-Rivières où le général de brigade William Thompson se retrouva immobilisé entre deux armées, l’une à l’est et l’autre à l’ouest ; au fort Saint-Jean, où Carleton tint à sa merci le général de brigade John Sullivan ; au lac Champlain, où il refusa d’attaquer le fort Ticonderoga (près de Ticonderoga, New York), même après avoir détruit la flotte d’Arnold – Carleton ne voulut pas exploiter à fond un avantage apparent. On s’interrogea sur les raisons de cette conduite « extraordinaire », comme Alfred Leroy Burt la qualifia, et, à cause d’allusions à la sollicitude singulière qu’il manifestait envers ses prisonniers, on soupçonna que Carleton essayait de montrer par son comportement que les insurgés pourraient bénéficier de clémence s’ils voulaient seulement revenir à la raison. Qu’il ait été charitable et diplomate, ou tout simplement lent et trop prudent, son attitude eut un résultat que Burt décrit ainsi : « L’inaction de Carleton, au moment où les Américains se précipitaient pour sortir du pays, ruina la campagne de 1776 et changea possiblement l’issue de la guerre. »
Les autorités de la métropole, selon toute apparence, étaient à peu près du même avis. Quand le gouvernement proposa de donner à Carleton le titre de chevalier, qu’il reçut le 6 juillet 1776, sept membres du cabinet ne purent s’empêcher d’observer que « certains aspects de sa conduite étaient ambigus ». Le roi lui accorda par la suite le « gouvernement de Charlemount », en Irlande, comme sinécure pour « sa défense méritoire de Québec », mais il admit que Carleton était « peut-être trop froid et pas aussi actif qu’on [aurait pu] le souhaiter ». Il ajouta ce commentaire : « il [serait] peut-être recommandable de remettre le commandement de la partie de l’armée canadienne qui doit tenter de rejoindre le général Howe [sir William Howe] à un commandant plus entreprenant ». Cette réaction bouleversa Carleton qui, ayant été promu général en Amérique du Nord le 1er janvier 1776, apprenait alors que sa stratégie visant à séparer la Nouvelle-Angleterre des autres colonies serait mise à exécution par Burgoyne, son commandant en second. Offensé et mécontent, il donna sa démission le 27 juin 1777, laquelle fut immédiatement acceptée. Cependant, comme Haldimand, son successeur, ne pouvait arriver que l’année suivante, Carleton resta en poste à Québec jusqu’au 27 juin 1778.
Dans l’intervalle, Carleton s’était disputé avec lord George Germain, qui avait remplacé Dartmouth au poste de secrétaire d’État aux Colonies américaines le 10 novembre 1775 et qui critiquait alors la conduite de la guerre. Germain espérait pouvoir influencer la stratégie et était résolu à exercer son favoritisme ; il s’efforça de faire rappeler Carleton, contribua à donner à Burgoyne le commandement de l’invasion projetée et recommanda fortement certaines nominations, notamment celle de Livius au poste de juge en chef, auquel celui-ci accéda le 21 août 1776. Carleton répliqua à ces manifestations d’« hostilité et [de] ressentiment privés » de manière si violente que même le roi, comme il l’écrivit en mars 1778, le jugeait « grandement dans son tort en permettant à sa plume d’exprimer une si grande rudesse à un secrétaire d’État », et il ajoutait que c’était la raison pour laquelle « on lui avait retiré le gouvernement du Canada ».
Des difficultés surgirent aussi au Conseil législatif, que Carleton avait finalement convoqué de nouveau en janvier 1777. Trois ordonnances traitant de l’administration de la justice inquiétèrent beaucoup les colons britanniques, même si le procureur général, William Grant, les avait approuvées. On différait encore l’introduction du droit commercial anglais, celle des jugements par jury dans les causes civiles et de l’ordonnance d’habeas corpus. En outre, l’organisation judiciaire avait été encore plus « francisée ». la Cour du banc du roi ne devait exercer sa juridiction que dans les causes criminelles, alors que la Cour des plaids communs connaîtrait seule des procès civils (bien que l’on pût faire appel auprès du conseil), et la procédure dans tous les tribunaux civils devait suivre les formes françaises (malgré l’application de la loi anglaise de la preuve dans les causes commerciales). Cela vexa particulièrement le juge en chef Livius, qui protesta aussi contre la confiance prolongée de Carleton dans son conseil privé et contre son refus de rendre publiques les délibérations de ce dernier, ainsi que les instructions que les conseillers avaient le droit de connaître. Mais l’exposé de ses griefs n’eut d’autre résultat que sa propre destitution et une autre prorogation du Conseil législatif. Malgré sa déception à l’endroit des Canadiens, le gouverneur continua de résister à l’anglicisation du système judiciaire de la province de Québec.
Carleton quitta le Canada le 30 juillet 1778. En mai 1780, North le nomma membre de la commission des comptes publics chargée d’examiner l’administration financière du gouvernement. Deux ans plus tard, le 2 mars 1782, suivant la recommandation du roi qui le décrivit comme « l’homme qui serait en général considéré par l’armée comme le meilleur officier », Carleton succéda à sir Henry Clinton au poste de commandant en chef en Amérique du Nord. Germain subissait maintenant un juste châtiment : puisqu’il ne pouvait accepter cette nomination sans une rétractation de Carleton ou sans qu’on enquête sur les accusations que ce dernier avait portées contre lui, il fut virtuellement forcé de donner sa démission. Par la suite, Carleton demanda à être relevé de son commandement ; il informa Conway, commandant en chef durant le mandat des gouvernements de Rockingham et de Shelburne, qu’il n’était pas préparé « à n’être employé que comme simple inspecteur des embarcations » et qu’il « ne servira[it] plus hors de l’Europe ». Cependant, Thomas Townshend, qui en tant que secrétaire d’État à l’Intérieur dans le gouvernement de Shelburne s’occupait maintenant des affaires coloniales, le convainquit de rester.
Son insuccès comme négociateur avait probablement rendu Carleton irritable. Le 21 mars, il avait été nommé, ainsi que le contre-amiral Robert Digby, membre d’une commission « chargée de rétablir la paix et d’accorder le pardon aux provinces révoltées d’Amérique » ; les deux commissaires avaient instructions « de réconcilier et de réunir les affections et les intérêts de la Grande-Bretagne et des colonies ». Le ministre français en poste à Philadelphie s’alarma et déclara : « Sir Gui Carleton étoit le meilleur choix que l’Angre pût faire pour ramener les Américains ; il est très respecté ici à cause de la conduite humaine et généreuse qu’il a tenue, lorsqu’il étoit Gouverneur du Canada. » Mais cet ambassadeur n’avait pas besoin de s’inquiéter : les Américains se méfiaient trop de l’« union fédérale » projetée par Shelburne, et le Congrès repoussa les ouvertures de Carleton, dans lesquelles il discernait « des démarches insidieuses » qui porteraient atteinte à l’alliance avec la France. La question de savoir si Carleton et Maurice Morgann, envoyé pour l’aider, auraient pu se comporter de manière plus efficace est discutable, mais il semble vraisemblable que le projet était voué à l’échec dès le début.
Durant son séjour à New York, de mai 1782 à novembre 1783, Carleton avait une autre préoccupation importante : faire évacuer quelque 30 000 soldats et jusqu’à 27 000 réfugiés. Ces derniers comprenaient quelques milliers d’anciens esclaves qu’on aida, malgré les protestations de George Washington, à immigrer aux Antilles et en Nouvelle-Écosse, où environ 1 200 s’installèrent près de Halifax [V. Boston King]. Carleton pressa aussi le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, sir Andrew Snape Hamond, puis le nouveau gouverneur, John Parr*, d’accorder gratuitement des terres et des provisions pour une année aux Loyalistes. Carleton invita Haldimand à faire la même chose pour ceux qui entraient au Canada.
Au début de décembre 1783, Carleton s’embarqua pour l’Angleterre, où il passa les trois années suivantes. Durant cet intervalle, Haldimand démissionna de son poste et le lieutenant-gouverneur Henry Hamilton* puis son successeur Henry Hope* gouvernèrent la province de Québec. En avril 1786, Townshend (devenu lord Sydney), secrétaire d’État à l’Intérieur dans le premier cabinet de William Pitt, avait accepté l’idée d’un gouverneur général pour l’ensemble de l’Amérique du Nord britannique afin de donner une base à une union des colonies britanniques restantes. C’était là une suggestion de Carleton et de William Smith*, ancien juge en chef de la colonie de New York qui allait bientôt devenir juge en chef de la province de Québec. Par la suite cependant, le gouvernement décida de ne créer qu’un poste « multiple » de gouverneur en chef, avec des commissions distinctes de gouverneur de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (chaque province devant aussi avoir son propre lieutenant-gouverneur). Le gouverneur ne pourrait exercer son autorité sur l’une de ces colonies que lorsqu’il y résiderait. Carleton regretta cette réduction de pouvoir et, en 1790, puis en 1793, il réitéra sa demande pour un poste de gouverneur général véritable. Néanmoins, il accepta de revenir en Amérique du Nord avec des commissions distinctes, datées du 22 et du 27 avril 1786 ; il avait aussi le poste de commandant en chef des trois provinces ainsi que de Terre-Neuve, et le titre de baron Dorchester qui fut créé pour lui le 21 août 1786.
La réputation de Carleton à titre de soldat et d’homme d’État avait subi des atteintes, mais il pouvait encore compter sur certains appuis politiques. Le roi, même légèrement déçu, restait l’un de ses protecteurs, Rockingham, Shelburne, Conway et Richmond continuaient de l’appuyer, et, en dépit de ses rapports plutôt froids avec William Wyndham Grenville et sa quasi-rupture avec Henry Dundas, Dorchester devait s’entendre assez bien avec les autres secrétaires d’État à l’Intérieur – Sydney, qui fut son premier supérieur, et le duc de Portland, son dernier. D’autre part, sa position à Québec était en soi instable. Plusieurs de ses anciens partisans – Mabane, Fraser, Paul-Roch Saint-Ours, Panet, Baby – étaient toujours aussi opposés à tout ce qui sentait l’anglicisation, et le lieutenant-gouverneur Hope partageait leur avis. D’autres, dont Grant (1744–1805), Collins et Samuel Johannes Holland, en étaient venus à accepter la nécessité d’un système judiciaire plus anglais et se rangeaient souvent du côté des partisans de l’anglicisation, tels Smith, Henry Caldwell, sir John Johnson* et le procureur général James Monk*. Malgré la forte influence exercée par Smith, Dorchester n’était pas complètement convaincu, et ses tentatives d’équilibre entre les deux groupes devaient se révéler démoralisantes.
Dorchester avait changé, tout comme la colonie, durant les huit années qu’avait durées son absence. Pour sa part, il était devenu beaucoup moins sensible à la situation des Canadiens, ou peut-être ceux-ci le rendaient-ils inquiet, et il avait maintenant beaucoup plus de compréhension et de respect pour les colons britanniques. Quant à la province, l’apparition de trois groupes avait créé des alliances et des besoins différents. Ceux des marchands qui prévoyaient un commerce lucratif avec les Antilles britanniques, d’où les Américains seraient selon toute vraisemblance exclus en vertu des lois sur le commerce et la navigation, et qui espéraient faire le commerce des matières premières autres que la fourrure, souhaitaient particulièrement l’introduction du droit anglais et l’établissement d’une assemblée. Ils considéraient cela comme une condition préalable à l’obtention de ce dont ils avaient besoin : routes, canaux, ports, banques, crédits et impôts. Pendant ce temps, la bourgeoisie canadienne montante, tout en étant résolue à garder ses droits de propriété et ses droits civils, avait fini par appuyer les demandes pour la mise sur pied d’un gouvernement représentatif – mais pour des raisons bien différentes. Enfin, les Loyalistes, qui ne semblaient pas aussi intéressés que les marchands par une assemblée, désiraient protéger leurs terres en les plaçant sous le régime du franc et commun socage.
Le 16 mars 1784, Dorchester avait exprimé son opinion concernant les perspectives économiques du Canada devant le Committee for Trade, auquel Pitt avait demandé d’examiner l’opportunité de permettre les expéditions américaines aux Antilles britanniques et d’y laisser entrer leurs produits. Dorchester partageait l’opinion des néo-mercantilistes, tels lord Sheffield, William Knox et George Chalmers, pour qui la sécurité nationale exigeait qu’on réserve le commerce de transport colonial à la marine marchande britannique, qui servait à la fois de milieu d’entraînement et de réserve pour la marine royale. Mais il ajouta qu’il n’y avait aucune raison pour que les Antilles britanniques importent des produits des États-Unis, car les provinces de Québec et de la Nouvelle-Écosse pourraient les approvisionner « complètement, à la fois en bois de construction et en provisions, avant la fin de 1785 ». Impressionné par la justesse de ce jugement, le Committee for Trade recommanda qu’on exclut des Antilles britanniques tous les navires américains ainsi que tous leurs produits, à condition que l’on puisse se procurer des produits similaires « en quantités suffisantes et à des prix raisonnables » à l’intérieur de l’Empire britannique. En conséquence, le gouvernement de Pitt décida de ne pas poursuivre la politique de libéralisation de Shelburne et de revenir aux principes exclusifs de l’ancien système colonial.
Mais, comme les événements le montrèrent, on ne pouvait empêcher le commerce direct entre les États-Unis et les Antilles britanniques. Dorchester avait-il surestimé les ressources de l’Amérique du Nord britannique, ou sa déclaration comportait-elle d’autres visées ? À longue échéance, l’essor de l’agriculture dans l’ouest de la province de Québec permit de produire une quantité de matières premières. Mais que Dorchester ait ou non prévu ce résultat, son affirmation selon laquelle il y aurait des approvisionnements suffisants en deux ans laisse supposer autre chose : il comptait à court terme sur le transbordement de produits américains par le Saint-Laurent. En d’autres mots, il se peut qu’il ait adhéré à une politique restrictive concernant la côte est, parce qu’il préconisait une politique libérale dans l’arrière-pays, à l’ouest. Il tentait ainsi de donner son appui aux pratiques mercantilistes dont dépendait la puissance maritime britannique, tout en essayant de préserver l’intégrité économique du bassin de l’Ohio et du Mississippi.
Pour arriver à ces fins, Dorchester limita effectivement la portée de l’arrêté en conseil du gouvernement britannique du 24 mars 1786, qui interdisait l’importation de produits américains dans « tout port de la province de Québec », en donnant à ce terme le sens de port de mer. Puis, le 18 avril 1787, il rendit public un décret qui permettait la libre exportation de tous les produits canadiens (à l’exception des fourrures) aux États-Unis et la libre importation de certains produits américains (bois de construction, approvisionnements pour la marine et quelques denrées alimentaires) dans la province de Québec, par le lac Champlain et William Henry (Sorel). Le 27 avril 1787, le conseil adopta une ordonnance selon laquelle on pourrait importer librement par la même route de la potasse et de la perlasse, ainsi que du tabac. Après que les autorités de la métropole eurent décidé de laisser la réglementation du commerce intérieur au gouvernement colonial, une nouvelle ordonnance de Dorchester vint confirmer, le 14 avril 1788, son ordonnance de l’année précédente, et, le 12 avril 1790, une troisième ordonnance ajouta la fonte brute à la liste des importations exemptes de droits. Finalement, à la suite d’une demande du gouverneur et du conseil pour qu’on autorise le libre accès aux marchés de l’Empire à tous les produits importés librement des États-Unis dans la colonie, Westminster promulgua une loi (30 George III, chap. 29, 1790) qui considérait les produits américains expédiés par le Saint-Laurent en Grande-Bretagne comme étant d’origine canadienne. Mais c’est tout ce que Dorchester obtint : on ne lui accorda pas la concession primordiale du libre accès de ces produits aux Antilles et c’est en partie pour cette raison – bien que ce soit surtout, sans doute, à cause de l’éloignement et de l’isolement des marchands de la province, de leur inexpérience et de leur incompétence – que son magnifique projet d’un monopole dans les Antilles demeura une chimère.
Cependant, sur une échelle plus modeste, on fit beaucoup pour améliorer les conditions économiques et sociales. On leva certaines des restrictions touchant le transport par les Grands Lacs ; on prit des dispositions pour rembourser des dettes contractées durant la guerre ; on imposa un embargo sur l’exportation de céréales et d’autres denrées alimentaires durant la disette de 1788–1789, provoquée par de maigres récoltes ; on fonda la Société d’agriculture afin d’inculquer de meilleures méthodes de culture ; on détourna vers le Nouveau-Brunswick et Halifax le service postal à destination de Londres, privé de sa liaison avec New York durant la Révolution américaine ; on construisit un pont sur la rivière Saint-Charles ; et, à la suite du rapport de trois comités créés par le gouverneur à l’automne de 1786, on adopta des ordonnances qui réglementèrent le fonctionnement de la milice et de la police, ainsi que la profession médicale, les métiers de pilote fluvial, de fournisseur de chevaux et de voitures, de détaillant de vins et de spiritueux. Même si Dorchester ne fut peut-être pas l’auteur direct de toutes ces réalisations – certaines furent clairement inspirées par d’autres [V. Hugh Finlay ; David Lynd] – du moins les sanctionna-t-il. Il continua d’encourager les Loyalistes en mettant sur pied des districts administratifs dans la région située au sud-ouest de Montréal, en affectant à chacun d’eux des juges salariés et un conseil des terres chargé de surveiller la colonisation, et, chose plus étonnante quand on considère son ancienne ligne de conduite, il pressa les autorités de la métropole d’autoriser les concessions de terre en franche tenure, ouvrant ainsi la voie à la réintroduction de la tenure anglaise en 1791.
Dorchester poursuivit sa politique concernant l’Église selon les principes qu’il avait établis durant son précédent gouvernement et contribua au bien-être ou du moins à la stabilité de la colonie. Il est vrai qu’en désignant Charles-François Bailly* de Messein comme coadjuteur en 1788, après que Mgr Hubert* eut succédé à d’Esgly, il provoqua une certaine discorde au sein de la hiérarchie catholique et qu’il semble avoir été particulièrement déçu par l’échec du projet d’une université non confessionnelle, proposé par Smith et approuvé par Bailly. D’autre part, en autorisant un certain nombre de prêtres émigrés de France à entrer dans la colonie après 1791, le gouverneur gagna un appui influent au Régime anglais, tout en aidant le clergé, considérablement réduit, à accomplir sa mission sociale et religieuse.
Par contraste avec sa participation dans les affaires économiques et sociales, Dorchester se désintéressa singulièrement, jusqu’à l’inertie, de la question de la réforme judiciaire. Déçu, incertain et hésitant, il laissa apparemment le comité chargé de l’administration de la justice, qu’il avait aussi formé à l’automne de 1786, se débattre avec ce problème. D’un côté, se trouvaient Smith et Finlay, de l’autre, Mabane, Saint-Ours et Thomas Dunn, et, entre ces deux groupes, se tenait John Fraser. Le scandale provoqué par le jugement que rendit Smith le 29 décembre 1786 dans la cause opposant William Grant (1744–1805) et Alexander Gray démontrait bien la divergence des opinions. De façon générale, Smith alléguait que l’Acte de Québec « n’avait pas l’intention d’exclure le droit anglais », qui devait donc régir les causes entre les « sujets nés britanniques » ; bien plus, maintenant que l’ordonnance d’habeas corpus et que le jugement par jury dans les causes civiles avaient été institués – respectivement sous Haldimand en 1784 et Hamilton en 1785 – il était temps d’angliciser davantage le système judiciaire, en commençant par les causes commerciales. Les tenants de la théorie selon laquelle l’Acte de Québec constituait une charte n’étaient pas d’accord : pour eux, le Canada devait rester aussi canadien que possible, à l’exception probable des districts loyalistes de l’Ouest ; en effet, il ne fallait pas seulement réaffirmer les principes essentiels de la jurisprudence française, mais cesser d’utiliser la loi anglaise de la preuve dans les causes commerciales et le droit au jugement par jury dans les procès civils.
En avril 1787, le procureur général Monk poussa à l’extrême ces différences qui avaient amené Smith et Saint-Ours à proposer des projets de loi contradictoires le mois précédent, au moment où l’ordonnance autorisant les jugements par jury devait expirer. Il prôna ouvertement l’anglicisation dans les domaines judiciaire et gouvernemental, et critiqua publiquement certains juges, ce qui incita Mabane, Fraser et Panet, pleins d’indignation, à faire appel au gouverneur. Dorchester dut intervenir – mais pas avant d’avoir renouvelé l’ordonnance, modifiée par Smith, autorisant les jugements par jury. L’enquête ordonnée par le gouverneur fournit de nombreuses preuves de la complexité et de l’imprécision de la loi, et établit que certains juges avaient un comportement arbitraire, mais elle n’eut aucune suite. Dorchester se contenta de transmettre les rapports à Sydney, qui, en dépit des protestations d’Adam Lymburner*, porte-parole des marchands, se borna à remplacer Monk par Alexander Gray au poste de procureur général.
Dès lors, il devenait évident qu’une révision fondamentale du régime gouvernemental de la province de Québec était inévitable. Les demandes pour obtenir une assemblée étaient plus pressantes que jamais, et les autorités de la métropole étaient prédisposées à les écouter. Leur attitude, qui sans doute comportait certains principes politiques, était plus vraisemblablement dictée par des considérations économiques. Le gouvernement du Canada coûtait à la Grande-Bretagne plus de £100 000 par an, les bénéfices obtenus en vertu de la loi sur le revenu de Québec étaient insuffisants, et, à cause du désaveu contenu implicitement dans le Colonial Tax Repeal Act de 1778 (18 George III, chap. 12), il était inacceptable d’assujettir directement une colonie à l’impôt ; une assemblée était donc indispensable. Mais il fallait d’une façon ou d’une autre la rendre acceptable à la fois à ces Canadiens qui craignaient qu’on ne puisse contenir convenablement les colons britanniques, à ces colons britanniques (notamment Monk) qui, au contraire, redoutaient que les Canadiens ne puissent être maîtrisés, et à tous ceux qui s’opposaient à l’accroissement des impôts. Au-dessus de toutes ces considérations, planait l’ombre de la Révolution américaine qui avait semblé prouver qu’une colonie possédant un gouvernement représentatif devenait de plus en plus insoumise et finalement indépendante.
Le gouvernement britannique essaya de résoudre cette situation difficile en adoptant l’Acte constitutionnel de 1791 (31 George III, chap. 31). Cet acte se fondait sur un expédient qui devint la norme courante pour les colonies où existaient des différences sociales inconciliables : la partition. La province de Québec serait divisée en deux : le Bas-Canada pour les Canadiens, le Haut-Canada pour les colons britanniques. Chaque groupe aurait ainsi l’assurance de ne pas être dominé par l’autre et pourrait posséder une assemblée capable de lever des impôts. En même temps, afin d’empêcher ces assemblées de devenir des Parlements trop puissants, comme ceux qui avaient fomenté la révolte des Treize Colonies, elles seraient soumises au système de contrepoids mis en pratique à Westminster. On imposerait des chambres hautes qui auraient le pouvoir de refuser les projets de loi, les gouverneurs auraient aussi le pouvoir de bloquer ces mêmes projets de loi et seraient dotés de sources de revenu assurées et de vastes pouvoirs de favoritisme, tandis que le gouvernement britannique détiendrait lui aussi un troisième droit de veto. En outre, on assimilerait socialement les deux Canadas à la Grande-Bretagne. Au Bas-Canada, on pourrait appliquer la franche tenure tout en conservant les coutumes et le droit français ; dans le Haut-Canada, seule la common law serait utilisée. On encouragerait la religion « protestante » dans les deux provinces par la constitution de « réserves du clergé » et la dotation de cures de l’Église d’Angleterre. Enfin, on prendrait les dispositions nécessaires pour donner des sièges héréditaires aux chambres hautes et assurer ainsi la création d’une aristocratie en Amérique du Nord britannique.
Dorchester n’apporta qu’une piètre collaboration aux autorités de la métropole dans la conception de ces solutions. À cause de sa méfiance envers les Canadiens, de sa circonspection à l’endroit des colons britanniques, de son aversion pour le gouvernement représentatif ou en raison de sa préférence pour le gouvernement par conseil, il se contenta de suggérer une modification du régime existant. Il confia à Sydney, en juin 1787 : « je confesse ne savoir encore moi-même quel plan offrirait le plus d’avantages à un peuple placé dans la situation où nous sommes à cette heure », et il ajouta, en novembre 1788, que la partition n’était « en aucune façon opportune à cette heure ». Si elle devait se faire, il « ne con[cevait] pas pourquoi l’on priverait les habitants de ces districts occidentaux d’une assemblée aussitôt qu’elle pourrait] s’organiser sans nuire à leurs affaires personnelles, ni pourquoi on leur refuserait les avantages de telles parties du système de lois anglaises qui s’appliqueraient à leurs conditions locales ». Mais il ne croyait pas que l’une ou l’autre de ces innovations puisse convenir au reste du Canada et il fit la remarque que même à l’ouest « il faudra[it] exercer un soin particulier à protéger la propriété et les droits civils des colons canadiens de Detroit ». Face à une attitude si indéterminée et si prudente, William Wyndham Grenville, qui remplaça Sydney au poste de secrétaire d’État à l’Intérieur en juin 1789, décida d’agir seul et, peut-être sous l’influence de Lymburner et de Maseres, conçut un projet de loi, ébauche de l’Acte constitutionnel.
Cependant, Dorchester ne demeura pas tout à fait à l’écart des discussions, et il se peut que sa contribution aux développements d’ordre constitutionnel de 1791 ait été autant sous-estimée que son influence sur l’Acte de Québec de 1774 a été exagérée. Le 8 février 1790, il abandonna ses premières réticences et offrit ses conseils sur un certain nombre de sujets, dont la répartition des sièges dans les assemblées, les conditions requises pour devenir député et électeur, la mise en pratique de la franche tenure, la conversion de la tenure en fief, la réserve de terres de la couronne, le règlement de la question du district de Gaspé et l’union de l’Amérique du Nord britannique sous l’autorité d’un gouverneur général. En outre, il semble avoir été en partie à l’origine de deux décisions d’une certaine importance. En novembre 1788, il avait suggéré à Sydney que si la partition était inévitable on devrait tracer la ligne de séparation le long de la rivière des Outaouais, de sorte que non seulement les seigneuries situées à l’ouest, mais aussi Montréal, se retrouveraient dans la province inférieure, et, en février 1790, il expliqua à Grenville qu’il était alors inopportun de créer une chambre haute dont les sièges seraient héréditaires, vu « l’état fluctuant de la propriété dans ces provinces ». Il ajouta : « il semble donc pour le moment de meilleure politique de nommer les conseillers à vie en raison de la bonne conduite et de la résidence dans la province ». L’acceptation par le gouvernement britannique de ces deux changements entraînait pour les habitants du Haut-Canada la privation d’un port de mer (donc de la possibilité de percevoir leurs propres droits sur les marchandises importées par mer) et donnait à la société du Bas-Canada une minorité britannique économiquement, socialement et politiquement dominante. Mais au moins on avait épargné à l’Amérique du Nord britannique une aristocratie artificielle, même si on lui imposait une oligarchie naturelle.
Le 18 août 1791, avant l’entrée en vigueur de l’Acte constitutionnel (le 26 décembre), Dorchester partit en congé pour l’Angleterre ; il confia l’administration du Bas-Canada au lieutenant-gouverneur sir Alured Clarke* jusqu’à son retour, qui survint deux ans plus tard, le 24 septembre 1793. Dans l’intervalle, Simcoe était devenu lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, ce qui faisait de lui le subordonné de Dorchester, qui était commandant en chef et gouverneur en chef (bien que cette dernière fonction ait été moins clairement définie). Les deux hommes, aux tempéraments incompatibles, ne tardèrent pas à être à couteaux tirés sur des sujets allant de la surveillance des Indiens à l’administration du commissariat de l’armée britannique, du choix d’une capitale pour la province de l’Ouest aux manières indépendantes du lieutenant-gouverneur et à son habitude de faire directement appel aux autorités de la métropole. Cependant, la politique de défense constituait la principale pomme de discorde. Simcoe rattachait la défense à la colonisation, dans son projet d’une ligne de villes fortifiées. Avançant divers arguments – coûts trop élevés, inquiétude possible des Américains et dangereux affaiblissement des défenses de la ville de Québec –, Dorchester fit échouer ce projet en refusant de fournir à Simcoe les troupes nécessaires.
Dorchester intensifia ses propres mesures de défense après que la France eut déclaré la guerre à la Grande-Bretagne en février 1793 et que l’envoyé français aux États-Unis, Edmond-Charles Genêt, eut commencé à comploter avec les Canadiens, comme avec les Américains. Le gouverneur ordonna à tout le monde « de découvrir et d’emprisonner » les séditieux ; il renforça les règlements militaires et fit respecter la discipline ; il convainquit le Parlement du Bas-Canada d’adopter une loi sur la milice, ainsi qu’une loi sur les étrangers (qui suspendait l’ordonnance d’habeas corpus) ; il demanda à la Grande-Bretagne d’autres troupes régulières ; il renouvela ses demandes pressantes pour la construction d’une « citadelle convenable » à Québec ; il ordonna à Simcoe de construire un nouveau fort Miamis (Maumee, Ohio) et d’y placer une garnison ; et il encouragea les relations avec les Indiens qui, il l’espérait, constitueraient une barrière à l’expansion des Américains dans la région de l’Ohio. Mais, à ce sujet, il alla trop loin : le 10 février 1794, dans un discours qu’il supposait privé et qu’il adressait à une délégation des tribus de l’Ouest, il dénonça les incursions des Américains dans leur territoire et ajouta : « Je ne serai pas surpris si nous entrons en guerre avec eux dans le cours de la présente année et, si nous le faisons, les guerriers du roi devront alors s’ériger en une ligne de défense. » Cette déclaration transpira dans la presse américaine, qui l’exagéra, sans tenir compte de tout ce que Dorchester avait recommandé concernant les Indiens. Le gouvernement des États-Unis considéra que ces commentaires étaient suffisamment incendiaires pour justifier l’envoi d’une protestation à Londres. Henry Dundas, qui avait succédé à Grenville au poste de secrétaire d’État à l’Intérieur en 1791, conseilla à Dorchester un peu plus de mesure. C’en était trop pour le gouverneur, que l’apparente indulgence du gouvernement pour l’insoumission de Simcoe faisait bouillir de rage. Il déclara qu’il en avait assez de la « grippe politique actuelle » sévissant dans la métropole. Le 4 septembre 1794, il demanda à être relevé de ses fonctions de gouverneur, conseillant par la suite qu’elles soient « confiées à un fonctionnaire aux capacités et au jugement supérieurs aux [siens], qui, [il] l’espér[ait], aura[it] en même temps suffisamment d’autorité pour continuer à servir le roi dans les domaines civil et militaire ».
Malgré plusieurs demandes que Portland, stupéfait, lui adressa (il avait remplacé Dundas en juillet), Dorchester refusa de reconsidérer sa démission. Mais deux années passèrent avant l’arrivée de son successeur, le lieutenant général Prescott, et, en dépit de son intention déclarée de « restreindre [son] intervention dans des limites aussi étroites que possible », son influence continua de se faire sentir. Il ne se trouva pas directement engagé dans les négociations qui aboutirent au traité Jay – qui refléta sa politique de libre-échange à l’intérieur du pays et de mercantilisme sur les côtes –, mais il fut chargé de le mettre à exécution. Il surveilla ainsi l’évacuation des forts de l’Ouest et la réinstallation des Indiens qui souhaitaient vivre en territoire britannique. En septembre 1795, il essaya encore une fois de soulager la misère résultant des mauvaises récoltes en décrétant un embargo sur l’exportation de denrées alimentaires ; l’année suivante, il créa un précédent en présentant au Parlement du Bas-Canada un mémoire sur le revenu provincial et les dépenses annuelles de la couronne ; il commença enfin à élaborer un projet pour l’entretien d’un clergé protestant ; et il fit un certain nombre de nominations, notamment celle de William Osgoode*, qui devint le nouveau juge en chef, et celle de James Monk, comme juge de la Cour du banc du roi à Montréal (tous deux avaient renoncé aux honoraires habituels). Puis, le 9 juillet 1796, Dorchester quitta le Canada pour toujours.
Durant les dernières années de sa vie, Dorchester maintint ses liens avec l’armée. Il avait été promu major général le 25 mai 1772, et lieutenant général le 29 août 1777, puis il était devenu général d’armée le 12 octobre 1793. Le 2 avril 1772, il avait aussi reçu le grade de colonel du 47e d’infanterie qu’il quitta pour le 15th Dragoons le 16 juillet 1790. De retour en Angleterre, il rejoignit le 27th Dragoons, le 18 mars 1801, puis le 4th Dragoons, le 14 août 1802. Cependant, la plupart du temps, il résidait à la campagne où il avait acheté trois demeures : Greywell Hill, à Basingstoke, où habite encore la famille Carleton, Kempshot House, proche de Basingstoke, et Stubbings House, près de Maidenhead, où il mourut dans sa 85e année. Le titre de baron Dorchester disparut avec la mort du quatrième baron, le 18 novembre 1897, et bien qu’un autre titre fût créé le 2 août 1899 pour Henrietta Anne Carleton, cousine du quatrième baron, ce dernier titre s’éteignit aussi avec la mort du second baron, le 20 janvier 1963.
Les commentateurs nous ont laissé des impressions confuses de la personnalité de Guy Carleton. De son temps, on le décrivit comme un homme froid, sévère, revêche et morose, mais aussi calme, intrépide, incorruptible et désintéressé. Des biographes ont ajouté que Carleton était arbitraire, réactionnaire, impitoyable et vindicatif, de même que bienveillant, honorable, humain et juste. Le lieutenant William Digby, du 53e d’infanterie, trouvait qu’il était « l’un des hommes les plus distants et réservés au monde » et se plaignait de la « rigide sévérité, très déplaisante, de ses manières, avec laquelle il trait[ait] même ses amis et connaissances les plus intimes ». Cependant, quand North recommanda Carleton pour occuper le poste de commandant en chef en 1779, il soutint que ce dernier était « d’abord un soldat, et très peu un homme politique, [qu’il était] si résolu, si honnête et un sujet tellement fidèle et obéissant qu’il [North] avou[a] souhaiter qu’on lui confie une partie de [la] défense dans ce moment critique ». Carleton apparut à ses premiers biographes, Arthur Granville Bradley et William Charles Henry Wood, comme un personnage héroïque : pas simplement « le père du Canada britannique », mais aussi « le grand justificateur de l’autorité britannique au delà des mers ». Des écrivains ont détruit ultérieurement cette image élogieuse : « Bien qu’il ait été connu comme l’un des plus grands proconsuls de l’histoire de l’Empire britannique, selon l’avis de Burt, il n’avait pas toujours un jugement et un caractère aussi sains qu’on l’a supposé. » Son juge le plus sévère, Donald Grant Creighton*, juxtapose l’homme « trop sûr de [lui] » qu’était Carleton, « si confiant, si volubile, si catégorique », et l’homme « déconcerté » que Dorchester était devenu, « vieux et irritable, et dépourvu d’idées », et résume ainsi sa personnalité : « un tory en politique et un traditionaliste dans le domaine social, professant une croyance pleine de suffisance en sa propre importance et un goût invétéré pour le pouvoir ».
Comme homme d’État, Dorchester restera probablement toujours une figure quelque peu énigmatique. Secret de façon presque maladive – il fit détruire tous ses papiers personnels par sa femme – il fardait tellement ses comptes rendus qu’il est particulièrement difficile de découvrir quels étaient ses plans, et encore plus quels mobiles le poussaient. Pourtant, il est peut-être possible de discerner un schéma général. Il semble que ce soit la préoccupation de Carleton pour la sécurité, durant son premier mandat, de 1776 à 1778, qui l’ait poussé à se prêter aux exigences des Canadiens et particulièrement à celles des seigneurs et du clergé. Mais cette attitude favorable envers eux ne sous-entend pas nécessairement, comme on le suppose généralement, qu’il trouvait, comme Murray, les colons britanniques foncièrement antipathiques ; au contraire, il y a des signes qui nous permettent de croire que Carleton avait ressenti dès le début quelque sympathie pour ces derniers. De toute façon, durant son second mandat de gouverneur, de 1786 à 1796, il avait jugé qu’on ne pouvait compter sur les Canadiens pour appuyer le gouvernement britannique et que la province de Québec ne conserverait pas « éternellement » sa prédominance canadienne. Et c’est peut-être ces convictions, plutôt que quelque conversion, comme on le suppose habituellement, qui le conduisirent non seulement à aider les Loyalistes et les marchands, mais aussi à accepter une certaine anglicisation du système judiciaire. L’introduction d’une assemblée était cependant une tout autre affaire, et, par sa constante opposition à celle-ci, Carleton a peut-être révélé le fond de son caractère et la base de sa politique : c’était un autocrate, opposé d’instinct au gouvernement représentatif – et pas uniquement pour les Canadiens, mais probablement, en dépit de ses dénégations, pour les colons britanniques aussi. Si ce type de gouvernement était inévitable, il devait prendre une forme beaucoup plus traditionaliste et stable que celle du gouvernement des Treize Colonies « abandonnées à la démocratie », comme Smith le déplora. Selon Dorchester, tout irait beaucoup mieux pour tout le monde avec son propre mode de gouvernement par conseil.
Il est encore plus difficile de faire une évaluation de la politique de Carleton que de l’expliquer. On a habituellement fait des tentatives en ce sens quant aux relations entre les « deux peuples fondateurs » du Canada ou en termes d’un combat supposé entre « un capitalisme commercial en progression et un état féodal, absolu et décadent, résistant avec l’énergie du désespoir ». Dans presque tous les cas, les jugements qui en ont découlé tendent à révéler des inquiétudes ultérieures plutôt que contemporaines. Pourtant, on peut encore avancer quelques conclusions générales. Certaines opinions de Carleton se fondaient clairement sur des prémisses erronées : la province de Québec n’était pas une société féodale, et on ne pouvait se concilier ses habitants en donnant satisfaction aux seigneurs et au clergé ; les marchands ne pouvaient exercer leur activité avec efficacité sans lois ni institutions familières, sûres, pratiques et utiles ; et on ne pouvait indéfiniment refuser aux colons britanniques et aux Canadiens une certaine forme de gouvernement représentatif. Les limites de Carleton et ses erreurs dans de tels cas ne diminuent pas cependant sa perspicacité et ses réalisations dans d’autres. La protection et l’appui qu’il offrit aux Loyalistes, sa compréhension des possibilités économiques du Canada, sa vision de l’union de l’Amérique du Nord britannique, tout cela témoigne de son habileté d’homme d’État. Et quoi que les critiques puissent penser de la façon dont il chercha à se concilier les Canadiens, il se pourrait bien, comme les citoyens de Montréal le prétendirent au moment de son départ, que dans l’ensemble sa « prudence et [sa] modération » assurèrent effectivement « la paix interne et la tranquillité ».
L’héritage le plus important et le plus discuté de Carleton fut sans aucun doute l’Acte de Québec, ou plutôt l’organisation gouvernementale qu’il bâtit sur la base de celui-ci. Parmi la variété ahurissante des interprétations imaginées par les historiens, on ne s’accorde qu’à un seul égard : de 1770 à 1786, un tournant se produisit dans l’histoire du Canada et de l’Empire britannique et, pour le meilleur et pour le pire, Carleton en fut dans une large mesure l’artisan. Malgré les essais de Murray pour tenir compte des exigences et des besoins particuliers des Canadiens, il était encore possible, et en 1770 cela semblait probable, que le gouvernement britannique favorise l’anglicisation de Québec, comme il l’avait invariablement fait dans le cas des colonies conquises. Une telle ligne de conduite était-elle préférable à celle que Carleton traça ? Un mélange plus équilibré d’anglicisation et de conservation eût-il pu être possible et meilleur ? Le débat reste ouvert. Mais on ne peut nier que c’est en soutenant les lois françaises, les coutumes et les institutions canadiennes que Carleton permit aux Canadiens non seulement de survivre mais de s’épanouir. Et bien que l’on puisse affirmer que le « côté charte » de l’Acte de Québec a été exagéré, il semble pourtant qu’on avait jeté les bases du statut spécial que de nombreux Canadiens français ont réclamé jusqu’à ce jour. Dans la mesure où l’on peut le considérer comme l’auteur de ces fondements, Carleton peut être loué ou blâmé, selon le cas.
Du point de vue de l’Empire, les conséquences de l’Acte de Québec ont eu aussi une portée considérable et controversée. En encourageant l’utilisation des pratiques et principes français, Guy Carleton étendit le précédent créé par Murray et en fit un modèle pour d’autres colonies où il fallait se concilier les populations étrangères. De plus, son organisation gouvernementale servit de prototype à une nouvelle forme de gouvernement colonial, qu’on appela plus tard « colonie de la couronne ». D’abord instituée à Saint-Domingue (île d’Haïti) en 1794, cette forme de gouvernement devint une pratique courante pour les colonies conquises, mais aussi pour celles qui avaient déjà été colonisées. C’était une solution de rechange pour les colonies que les autorités britanniques considéraient comme n’étant pas préparées pour la mise en place d’un gouvernement représentatif ou pour celles auxquelles cette forme de gouvernement ne convenait pas. Pour d’autres, la voie était libre pour qu’elles évoluent vers un « gouvernement responsable ». Le processus d’évolution par lequel les membres du second Empire britannique accédèrent à l’indépendance doit ainsi quelque chose, bien que de façon paradoxale, au gouvernement de Québec dirigé par Guy Carleton.
APC, MG 23, AI ; A4, 14 ; 16 ; 18 ; A6 ; 20 ; 29–30 ; A8 ; GI, 5 ; GII, 6 ; 9 ; 14, vol. 2 ; 7 ; 15 ; 19, 3 ; HI, 1 ; MG 40, B1, 3, 6–10, 13, 15, 17 ; RG 1, E1, 19 ; 28–31 ; 43 ; 46–47 ; 105–115 ; RG 4, B3, 1 ; B6, 2–6 ; B9, 9 ; RG 7, G5, 1 ; RG 14, A1, 1 ; 3 ; 7 ; A3, 3–7 ; RG 68, 90 ; 93 ; 95.— BL, Add. mss 21697–21700 ; 21743 ; 21806 ; 21808 ; 21864.— Hampshire Record Office (Winchester, Angl.), Reg. of baptisms, marriages, and burials for the parish of Nately Scures, 16 nov. 1808.— Library of Congress (Washington), Continental Congress papers, nos 35, 41–43, 58, 78, 154, 166 (copies aux APC).— PRO, CO 42/26–107 ; PRO 30/55 ; WO 1/11 ; 1/14 (mfm aux APC).— A collection of several commissions, and other public instruments, proceeding from his majesty’s royal authority, and other papers, relating to the state of the province in Quebec in North America, since the conquest of it by the British arms in 1760, Francis Maseres, compil. (Londres, 1772 ; réimpr., [East Ardsley, Angl., et New York], 1966).— Ainslie, Canada preserved (Cohen).— American arch. (Clarke et Force), 4e sér., 3 ; 4.— Annual reg. (Londres), 1758–1791.— « Blockade of Quebec in 1775–1776 by the American revolutionists (les Bastonnais) », F. C. Würtele, édit., Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. docs. (Québec), 7e sér. (1905).— Blockade of Quebec in 1775–1776 by the American revolutionists (les Bastonnais), F. C. Würtele, édit. (Québec, 1906 ; réimpr., Port Washington, N.Y., et Londres, 1970).— British colonial developments, 1774–1834 : select documents, V. T. Harlow et A. F. Madden, édit. (Oxford, Angl., 1953).— «Collection Haldimand », APC Rapport, 1885–1888.— The correspondence of King George the Third from 1760 to December 1783 [...], J. [W.] Fortescue, édit. (6 vol., Londres, 1927–1928 ; réimpr., 1967).— Corr. of Lieut. Governor Simcoe (Cruikshank).— Jacob Danford, « Quebec under siege, 1775–1776 : the « memorandums » of Jacob Danford », J. F. Roche, édit., CHR, 50 (1969) : 68–85.— Docs. relating to constitutional hist., 1759–91 (Shortt et Doughty ; 1907) ; 1791–1818 (Doughty et McArthur ; 1914).— Hugh Finlay, «Journal of the siege and blockade of Quebec by the American rebels, in autumn 1775 and winter 1776 »,Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 4e sér. (1875) : [3]–25.— G.-B., Parl., Debates of the House of Commons in the year 1774, on the bill for making more effectual provision for the government of the province of Quebec, drawn up from the notes of Sir Henry Cavendish [...] (Londres, 1839 ; réimpr., [East Ardsley et New York], 1966) ; The parliamentary register : or history of the proceedings and debates of the House of Commons (and House of Lords) containing the most interesting speeches [...] (112 vol., Londres, 1775–1813).— « Journal par Baby, Taschereau et Williams » (Fauteux), ANQ Rapport, 1927–1928 : 435–499 ; 1929–1930 : 138–140.— Knox, Hist. journal (Doughty) ; The justice and policy of the late act of parliament for making more effectual provision for the government of the province of Quebec [...] (Londres, 1774).— [Francis Maseres], An account of the proceedings of the British, and other Protestant inhabitants, of the province of Quebeck, in North-America, in order to obtain an house of assembly in that province (Londres, 1775) ; Additional papers concerning the province of Quebeck : being an appendix to the book entitled, An account of the proceedings of the British and other Protestant inhabitants of the province of Quebeck in North America en order to obtain a house of assembly in that province (Londres, 1776) ; Maseres letters (Wallace).— Naval documents of the American revolution, W. B. Clarke et W. J. Morgan, édit. (8 vol. parus, Washington, 1964– ) 4–6.— « Ordonnances édictées pour la province de Québec par le gouverneur et le conseil de celle-ci, de 1768 à 1791 [...] », APC Rapport, 1914–1915.— « Ordonnances faites pour la province de Québec par le gouverneur et le conseil de la dite province depuis le commencement du gouvernement civil », APC Rapport, 1913 : 90s.— The parliamentary history of England from the earliest period to the year 1803, William Cobbett et John Wright, compil. (36 vol., Londres, 1806–1820), 17–19.— « Proclamations du gouverneur du Bas-Canada, 1792–1815 », APC Rapport, 1921.— « Proclamations issued by the governor-in-chief [...] », APC Report, 1918.— Reports on the laws of Quebec, 1767–1770, W. P. M. Kennedy et Gustave Lanctot, édit. (Ottawa, 1931).— La Gazette de Québec, 1766–1796.— G.-B., WO, Army list, 1740 ; 1755 ; 1758 ; 1761 ; 1763–1766 ; 1770–1772 ; 1777–1778 ; 1789–1808.— « Papiers d’État – B.-C. », APC Rapport, 1890 ; 1891.— A history of the organization, development and services of the military and naval forces of Canada [...] (3 vol., s.l.n.d.).— Pierre Benoît, Lord Dorchester (Guy Carleton) (Montréal, 1961).— J. G. Bourinot, Canada under British rule, 1760–1900 (Cambridge, Angl., 1900).— A. G. Bradley, Lord Dorchester (Toronto, 1907 ; nouv. éd. parue sous le titre de Sir Guy Carleton (Lord Dorchester), [1966]).— G. S. Brown, The American secretary ; the colonial policy of Lord George Germain, 1775–1778 (Ann Arbor, Mich., 1963).— Michel Brunet, Les Canadiens après la Conquête, 1759–1775 : de la Révolution canadienne à la Révolution américaine (Montréal, 1969).— A. L. Burt, Guy Carleton, Lord Dorchester, 1724–1808, Guy Courtel, trad. (Ottawa, 1973) ; Old prov. of Quebec (1968) ; « The problem of government, 1760–1775 », The Cambridge history of the British empire (8 vol., Cambridge, 1929–1959 ; réimpr. des vol. 1 et 2, 1960–1961), 6 : 146–172 ; The United States, Great Britain and British North America from the revolution to the establishment of peace after the War of 1812 (Toronto et New Haven, Conn., 1940).— Chapais, Cours d’hist. du Canada.— Christie, Hist. of L.C., 1.—Victor Coffin, The province of Quebec and the early American revolution ; a study in English-American colonial history (Madison, Wis., 1896).— Reginald Coupland, The Quebec Act ; a study in statesmanship (Oxford, 1925).— Craig, Upper Canada.— Creighton, Commercial empire of the St. Lawrence.— F.-X. Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours (4 vol., Québec, 1845–1852).— M. H. Gom, « To preserve good humor and perfect harmony : Guy Carleton and the governing of Quebec, 1766–1774 » (thèse de ph.d., Univ. of Southern California, Los Angeles, 1978).— G. S. Graham, British policy and Canada, 1774–1791 ; a study in 18th century trade policy (Londres et New York, 1930) ; Sea power and British North America, 1783–1820 : a study in colonial policy (Cambridge, Mass., 1941).— Lionel Groulx, Vers l’émancipation (première période) ; cours d’histoire du Canada à l’université de Montréal, 1920–1921 (Montréal, 1921).— V. T. Harlow, The founding of the second British empire, 1763–1793 (2 vol., Londres et New York, 1964).— W. P. M. Kennedy, The constitution of Canada ; an introduction to its development and law (Londres, 1922).— William Kingsford, The history of Canada (10 vol., Toronto et Londres, 1887–1898).— P. E. Leroy, « Sir Guy Carleton as a military leader during the American invasion and repulse in Canada, 1775–1776 » (thèse de ph.d., 2 vol., Ohio State Univ., Columbus, 1960).— Duncan McArthur, « The new régime », Canada and its prov. (Shortt et Doughty), 4 : 21–49.— Piers Mackesy, The war for America, 1775–1783 (Cambridge, Mass., 1964).— John Mappin, « The political thought of Francis Maseres, 1766–69 » (thèse de m.a., McGill Univ., Montréal, 1968).— Neatby, Administration of justice under Quebec Act ; Quebec ; The Quebec Act : protest and policy (Scarborough, Ontario, 1972).— John Norris, Shelburne and reform (Londres, 1963).— Ouellet, Bas-Canada ; Hist. économique.— P. R. Reynolds, Guy Carleton : a biography (Toronto, 1980).— J. [W.] Shy, Toward Lexington : the role of the British army in the coming of the American revolution (Princeton, N.J., 1965).— P. H. Smith, « Sir Guy Carleton : soldier-statesman », George Washington’s opponents : British generals and admirals in the American revolution, G. A. Billias, édit. (New York, 1969), 103–141.— C. P. Stacey, Quebec, 1759 : the siege and the battle (Toronto, 1959).— L. F. S. Upton, The loyal whig : William Smith of New York & Quebec (Toronto, 1969).— A. C. Valentine, Lord George Germain (Oxford, 1962).— Rex Whitworth, Field Marshal Lord Ligonier : a story of the British army, 1702–1770 (Oxford, 1958).— W. [C. H.] Wood, The father of British Canada : a chronicle of Carleton (Toronto, 1916).— G. M. Wrong, Canada and the American revolution ; the disruption of the first British empire (New York, 1935).— Elizabeth Arthur, « French Canadian participation in the government of Canada, 1775–1785 », CHR, 32 (1951) : 303–314.— H. R. Balls, « Quebec, 1763–1774 : the financial administration », CHR, 41 (1960) : 203–214.— R. A. Bowler, « Sir Guy Carleton and the campaign of 1776 in Canada », CHR, 55 (1974) : 131–140.— A. L. Burt, « The quarrel between Germain and Carleton : an inverted story », CHR, 11 (1930) : 202–222 ; «Sir Guy Carleton and his first council », CHR, 4 (1923) : 321–332 ; « The tragedy of Chief Justice Livius », CHR, 5 (1924) : 196–212.— Jane Clark, « The command of the Canadian army for the campaign of 1777 », CHR, 10 (1929) : 129–135.— R. A. Humphreys et S. M. Scott, « Lord Northington and the laws of Canada », CHR, 14 (1933) : 42–61.— L. P. Kellogg, « A footnote to the Quebec Act », CHR, 13 (1932) : 147–156.— M. G. Reid, « The Quebec fur-traders and western policy, 1763–1774 », CHR, 6 (1925) : 15–32.— Rev. of Hist. Pubs. relating to Canada (Toronto), 1 (1896) : 68–80.— P. H. Smith, «Sir Guy Carleton, peace negotiations, and the evacuation of New York », CHR, 50 (1969) : 245–264.— William Smith, « The struggle over the laws of Canada, 1763–1783 », CHR, 1 (1920) : 166–186.— F. H. Soward, « The struggle over the laws of Canada, 1783–1791 », CHR, 5 (1924) : 314–335.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
G. P. Browne, « CARLETON, GUY, 1er baron DORCHESTER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/carleton_guy_5F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/carleton_guy_5F.html |
| Auteur de l'article: | G. P. Browne |
| Titre de l'article: | CARLETON, GUY, 1er baron DORCHESTER |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1983 |
| Année de la révision: | 1983 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |