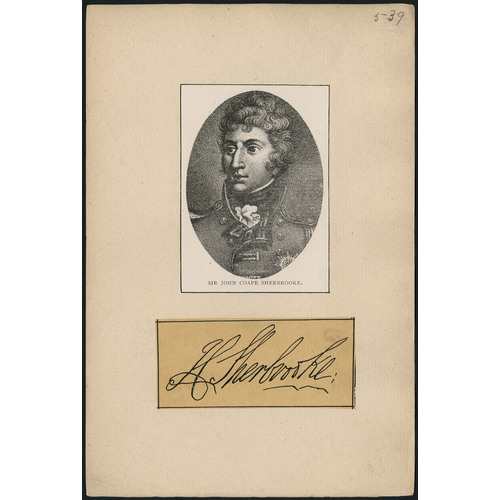Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2909401
SHERBROOKE, sir JOHN COAPE, officier et administrateur colonial, baptisé le 29 avril 1764 à Arnold, Nottinghamshire, Angleterre, fils de William Sherbrooke (Coape) et de Sarah Sherbrooke ; le 24 août 1811, il épousa à Areley Kings, Angleterre, Katherine (Katherina) Pyndar, et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 14 février 1830 à Calverton, Nottinghamshire, et inhumé tout près, à Oxton.
Issu de la gentry terrienne, John Coape Sherbrooke commença sa carrière dans l’armée britannique le 7 décembre 1780 à titre d’enseigne dans le 4th Foot. Promu lieutenant le 22 décembre 1781, il devint en mars 1783 capitaine du 85th Foot, qui fut cependant démobilisé quelques mois plus tard. Le 23 juin 1784, Sherbrooke obtint une compagnie dans le 33rd Foot, qui servait alors en Nouvelle-Écosse. Pendant qu’il était stationné à Sydney, à l’île du Cap-Breton, un incident bizarre se produisit : avec le lieutenant George Wynyard, il crut voir le fantôme du frère de celui-ci qui, apprirent-ils plus tard, était mort à ce moment même en Angleterre.
En 1786, le 33rd Foot rentra en Angleterre, et la carrière militaire de Sherbrooke se poursuivit sans incident jusqu’à ce que la guerre éclate entre la Grande-Bretagne et la France révolutionnaire. Promu major le 30 septembre 1793 et lieutenant-colonel le 24 mai de l’année suivante, Sherbrooke mena son régiment à Ostende en juillet pour faire la campagne des Flandres avec l’armée du duc d’York. De retour en Angleterre en 1795, le 33rd Foot reçut l’ordre d’accompagner un corps expéditionnaire aux Antilles, mais des tempêtes forcèrent les navires à rebrousser chemin. Sherbrooke partit pour l’Inde avec son régiment en avril 1796 et il accosta à Calcutta en février suivant. Élevé au rang de colonel de l’armée le 1er janvier 1798, il participa en 1799 à la guerre du Mysore, et notamment au siège de Seringapatam. En Inde, il connut des problèmes de santé si persistants qu’en janvier 1800 il dut rentrer en Angleterre, où il fut mis à la demi-solde en 1802. Les hostilités contre la France ayant recommencé, Sherbrooke prit en juillet 1803 le commandement du 4th Batallion of Réserve, alors stationné à Norman Cross.
Promu major général le 1er janvier 1805, Sherbrooke s’embarqua en juin pour la Sicile, où il devint en février 1807 commandant du Sicilian Régiment. Comme les forces françaises s’activaient dans le sud de l’Italie et en Méditerranée, il consacra une grande partie de ses énergies à faire des démarches diplomatiques et à confondre les intrigues de la cour de Palerme, manifestant en cela adresse et résolution. En mai 1807, il se rendit en mission diplomatique en Égypte. Un de ses camarades officiers, Henry Edward Bunbury, a laissé de l’homme fougueux qu’était alors Sherbrooke un portrait coloré : quand il arriva en Sicile, « les membres de la brigade qu’il commandait renâclaient un peu sous sa discipline sévère et se vengeaient en plaisantant sur ses excès de langage et son tempérament impétueux [...] C’était un petit homme robuste et carré dont le visage révélait tout de suite la force de caractère et la détermination. Dépourvu de génie et d’éducation, soupe au lait, rude dans ses paroles, [il avait] le cœur bon et généreux ; sincère, direct, méprisant à l’égard des artifices, des ruses et de la mesquinerie, [il] exprim[ait] son mécontentement avec une hâte bouillante et dans les termes les plus crus. En tant qu’officier, [il] débord[ait] d’énergie, pouss[ait] les autres jusqu’à l’épuisement et [il était] infatigable. » À compter du début de 1808, Sherbrooke assuma à titre temporaire le commandement de toutes les troupes britanniques de Sicile puis, en juin, sir John Stuart étant venu prendre la relève, il partit en permission en Angleterre.
Muté au 68th Foot en mai 1809, Sherbrooke se vit attribuer le grade temporaire de lieutenant général et il participa à la campagne d’Espagne en tant que second d’Arthur Wellesley, qui signala plus tard : « Sherbrooke était un très bon officier, mais c’était aussi, je crois, l’homme le plus passionné que j’aie jamais connu. » En septembre 1809, on lui remit la croix de chevalier commandeur de l’ordre du Bain pour le récompenser de ses exploits aux batailles d’Oporto et de Talavera de la Reina. De nouveau malade, il dut rentrer en Angleterre en mai 1810 et aller se reposer à Cheltenham. Le 4 juin 1811, il reçut les pleines attributions du grade de lieutenant général et, le mois suivant, il fut nommé lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse (son mandat commençait le 19 août). Ayant pris le temps de se marier, il quitta Portsmouth le 8 septembre en compagnie de sa femme et de sa belle-sœur. Il débarqua à Halifax le 16 octobre, et se prépara à assumer, outre ses fonctions de lieutenant-gouverneur, le commandement des troupes des provinces de l’Atlantique.
Les cinq années du gouvernement de Sherbrooke furent dominées par la guerre contre les États-Unis, qui éclata en juin 1812, et par l’organisation de la défense de la colonie. Les fortifications y étaient délabrées et les ressources militaires limitées car les besoins du Canada pressaient plus que ceux des Maritimes. Pour protéger contre l’invasion ou les ravages des corsaires américains les villages vulnérables qui s’éparpillaient le long de la côte, Sherbrooke ne put donc guère qu’installer des canons à l’entrée des ports et tenir la milice en état d’alerte. Il dut compter pour le reste sur la protection de la marine : les navires britanniques sillonnaient les mers et, plus tard, bloquèrent le littoral américain. À l’occasion, ils affrontèrent des bâtiments de guerre ennemis, comme en juin 1813, lors du célèbre combat entre le Shannon, commandé par Philip Bowes Vere Broke*, et le Chesapeake. Soucieux d’assurer tant la sécurité de la colonie que la poursuite du commerce, Sherbrooke émit des proclamations dans lesquelles il annonçait que la Nouvelle-Écosse était bien disposée envers ses voisins de la Nouvelle-Angleterre, qui avait très mal accueilli la déclaration de guerre, et désirait poursuivre avec eux ses échanges commerciaux dans le cadre d’un système de permis. À cet arrangement satisfaisant de part et d’autre s’ajoutèrent, tout au long de la guerre, de nombreuses opérations plus clandestines. En définitive, même si Sherbrooke avait d’abord craint une pénurie de numéraire et de vivres, la guerre s’avéra profitable pour la Nouvelle-Écosse. Grâce à sa politique prévoyante, qui stimula le libre-échange avec la Nouvelle-Angleterre, les provinces de l’Atlantique devinrent un entrepôt prospère du commerce international. Cette florissante activité commerciale, les possibilités que la colonie offrait aux corsaires et aux contrebandiers, l’accroissement de la demande du bois et l’augmentation des dépenses du commissariat de l’armée britannique, tout cela donna à l’économie néo-écossaise un stimulant artificiel qui, comme on pouvait le prévoir, cessa d’agir peu après le retour de la paix, en 1815.
La coopération commerciale et la neutralité militaire qui existaient entre les Maritimes et la Nouvelle-Angleterre, et qui constituaient une situation incommode mais rentable, firent place en 1814 à un état de choses tout à fait différent. Encouragé par la défaite de Napoléon en Europe à se montrer plus belliqueux en Amérique du Nord, le gouvernement britannique ordonna à Sherbrooke de maintenir pendant l’hiver les communications avec le Canada et de faire pression sur le gouvernement américain en occupant une partie du territoire actuel du Maine. Décidant de frapper la frontière depuis longtemps litigieuse qui passait entre la baie de Passamaquoddy et le fleuve Penobscot, Sherbrooke dirigea en août un corps expéditionnaire qui réussit un débarquement à Castine et entreprit de soumettre toute la région comprise entre le Penobscot et la rivière Sainte-Croix. Puis, ayant organisé l’administration civile de cette enclave britannique et y ayant réglementé le commerce, Sherbrooke rentra à Halifax, après une absence de moins de quatre semaines. Il devait se remettre aux tâches plus prosaïques qu’imposait une guerre maintenant proche de sa fin : s’occuper des prisonniers français et américains de l’île Melville, distribuer aux Indiens, en guise de présents, des provisions endommagées et des couvertures usées qui venaient du magasin du Board of Ordnance et reporter la décision quant à l’installation des réfugiés noirs sur des concessions foncières. Les huit mois d’occupation de Castine rapportèrent des droits de douanes qui servirent plus tard à financer une bibliothèque militaire à Halifax et à fonder le Dalhousie College. Désireuse d’exprimer la fierté et le sentiment de triomphe que la guerre avait engendrés dans la population, la chambre d’Assemblée de la Nouvelle-Écosse vota une somme de £1 000 qui permettrait à Sherbrooke d’acheter une pièce d’argenterie.
Les talents inattendus de Sherbrooke pour l’administration civile, plus tard si évidents dans le Bas-Canada, se révélèrent dans le pragmatisme avec lequel il aborda les affaires religieuses de la Nouvelle-Écosse. En tant qu’anglican pratiquant, il mesurait combien une Église établie peut favoriser la loyauté des habitants et servir leurs intérêts. Aussi constata-t-il avec regret que, dans cette colonie où la plupart étaient des non-conformistes, « la religion établie [était à l’époque] bien loin d’être florissante ». Comme l’évêque Charles Inglis*, il estimait que les difficultés de l’Église d’Angleterre provenaient en partie de l’insuffisance des revenus du clergé. Le problème financier, toutefois, s’avérait plus facile à cerner qu’à résoudre. Sherbrooke fut incapable de convaincre l’Assemblée, dominée par les non-conformistes, de voter des crédits à l’intention de l’Église d’Angleterre, et ce même en offrant, pour encourager leur générosité, de surseoir à la perception des arriérés de redevances sur les concessions foncières qui avait été annoncée. En attendant que les autorités impériales trouvent une solution, il ne pouvait guère que continuer d’allouer à l’Église de petites sommes prélevées sur le fonds d’armement et d’équipement, lui-même alimenté par un droit sur les boissons distillées, et mettre de côté des terres dans l’espoir d’en doter un jour un doyen et un chapitre, d’en faire des terres bénéficiales et de les donner à des écoles, bref de constituer des réserves équivalentes à celles du clergé du Canada. Il était trop tard cependant, et la tentative allait totalement échouer.
Préoccupé des intérêts de l’Église d’Angleterre, Sherbrooke n’en était pas moins conscient de la nécessité, dans une société multiconfessionnelle, de se montrer tolérant et conciliant en matière religieuse. Prévoyant en 1812 qu’un nouvel évêque succéderait bientôt à Inglis qui était malade, Sherbrooke avisa le secrétaire d’État aux Colonies que la Nouvelle-Écosse avait besoin d’ « une personne très calme, très modérée et très sensée qui, loin d’irriter et de dégoûter les non-conformistes, ce qui serait susceptible d’ébranler la paix du pays, saurait les apaiser et se les concilier et qui aurait en même temps la fermeté nécessaire pour soutenir la religion établie ». Aucun des aspirants issus de la colonie ne lui semblait suffisamment qualifié, et il se prit d’une aversion profonde pour le tractarien autoritaire John Inglis*, que son père voulait comme successeur. Tant par instinct que pour des raisons d’utilité publique, Sherbrooke favorisait aussi bien le latitudinarisme que la coopération interconfessionnelle. Son indépendance d’esprit et sa tolérance sur le plan religieux et politique plaisaient aux Néo-Écossais, et les députés pressèrent son successeur, lord Dalhousie [Ramsay*], de suivre ses traces.
Le 10 avril 1816, Sherbrooke fut nommé gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique. Parti de Halifax le 27 juin, il arriva à Québec le 12 juillet pour assumer ses nouvelles fonctions, à un moment où se faisaient sentir les répercussions de la guerre contre les États-Unis et des rudes luttes de partis. Le gouverneur précédent, sir George Prévost*, à qui le parti des bureaucrates avait vivement reproché sa stratégie militaire durant les hostilités et sa politique d’apaisement envers les Canadiens, avait été rappelé un an auparavant. De son côté, le parti canadien avait entamé à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada l’impeachment contre les deux juges en chef, Jonathan Sewell* et James Monk. Dès le début, Sherbrooke résolut de ne pas se mêler des querelles partisanes et de viser plutôt la neutralité et la conciliation en recourant à la persuasion individuelle et à une démarche franche. Or, d’entrée de jeu, un dilemme s’imposa à lui. Tout à fait conscient de la nécessité d’obtenir et de conserver l’approbation du comte Bathurst, secrétaire d’État aux Colonies, Sherbrooke se trouva devant des instructions inspirées de bonnes intentions mais irréalistes : cultiver les dispositions favorables de Mgr Joseph-Octave Plessis et du clergé catholique tout en collaborant étroitement avec Sewell, un des leaders du parti des bureaucrates qui avait fait une rentrée triomphale à Québec après avoir été blanchi par le Conseil privé. Sherbrooke signala à Bathurst que ces deux objectifs étaient inconciliables. Il expliqua que les Canadiens méprisaient profondément Sewell et que le clergé catholique le tenait même responsable des maux de la colonie. Il s’agissait peut-être d’un préjugé délibérément cultivé par d’« intrigants démagogues », mais il fallait en reconnaître l’existence et en tenir compte si l’on voulait restaurer l’harmonie politique. Sherbrooke soutiendrait Sewell et tenterait d’apaiser les leaders du parti des bureaucrates, mais il était convaincu que le succès d’une politique conciliatrice reposait en grande partie sur sa capacité d’établir de bonnes relations avec l’évêque catholique.
Animés d’une sympathie et d’un respect réciproques depuis leur première rencontre, survenue à Halifax en 1815, Sherbrooke et Plessis devinrent bientôt de grands amis et de proches collaborateurs. Désireux de cimenter cette entente personnelle, de la mettre au service du gouvernement colonial et du lien impérial tout en gagnant la confiance du clergé et des fidèles catholiques, Sherbrooke proposa, comme cela avait déjà été suggéré, de nommer Plessis au Conseil législatif à titre d’évêque catholique de Québec. L’emploi de cette désignation suscita des conciliabules inquiets à Québec, à Londres et à Rome, car il soulevait de délicates questions religieuses, protocolaires et juridiques et semblait notamment inconciliable avec la suprématie et les instructions du roi. Finalement, Sherbrooke court-circuita ces chicanes de juristes en convoquant Plessis au conseil en 1818, initiative acceptée d’emblée par Bathurst, qui était enthousiaste à l’idée de reconnaître les services rendus par le clergé catholique durant la guerre. Grâce à la souplesse du gouverneur, cette nomination assura à l’exécutif colonial un précieux allié politique en même temps qu’elle resserra ses liens avec les francophones de la province.
Par ailleurs, Sherbrooke réussit à gagner l’appui du président de l’Assemblée, Louis-Joseph Papineau*, qui, jeune et encore impressionnable, était pressé d’accroître le prestige de sa position et de consolider sa situation financière. Sherbrooke veilla à ce que le président reçoive en permanence le salaire annuel de £1 000 qui lui avait d’abord été alloué pour la durée de la guerre et acheta l’assentiment du Conseil législatif en versant la même somme à Sewell en tant que président de la chambre haute. Par sa bonne foi et sa courtoisie, Sherbrooke parvint à nouer une relation cordiale, voire paternelle, avec l’homme politique canadien-français qui allait plus tard devenir la bête noire de gouverneurs moins astucieux et moins traitables.
Sherbrooke tabla sur l’harmonie qui régnait entre lui et le président de l’Assemblée quand il s’employa à démêler les affaires financières de la colonie, et il obtint en 1818 que les crédits soient votés sans heurt, ce qui constituait presque un tour de force pour un gouverneur du Bas-Canada. Depuis l’époque de lord Dorchester [Guy Carleton*], l’exécutif avait cherché à éviter la divulgation complète de la liste civile, tout comme l’accroissement des pouvoirs financiers de l’Assemblée, en ne lui présentant qu’une fraction des estimations annuelles et en lui demandant de voter des crédits pour ce qui ne représentait qu’une partie des dépenses gouvernementales. Pour le reste, l’exécutif s’était surtout servi des droits de douanes perçus en vertu de la loi du revenu de Québec de 1774 et d’autres revenus de la couronne que les deux chambres n’avaient pas le droit d’affecter. Toutefois, à mesure que s’étaient accrues les multiples dépenses inhérentes à l’administration d’une vaste province, surtout pendant la guerre de 1812, il avait pris l’habitude de combler le déficit annuel en puisant dans une caisse de l’armée britannique réservée aux « dépenses militaires extraordinaires », fonds apparemment illimité qui échappait encore à l’examen des parlementaires et absorbait couramment une foule de dépenses qui n’étaient en fait ni militaires, ni extraordinaires. La situation s’avérait d’autant plus complexe pour Sherbrooke que le gouverneur sir James Henry Craig*, en rejetant en 1810 l’offre que lui faisait l’Assemblée de négocier une liste civile, avait instauré une pratique que Prévost avait maintenue pendant la guerre contre les États-Unis et qui consistait à emprunter secrètement au trésor provincial le produit accumulé des lois coloniales du revenu, en escomptant le rembourser plus tard. Ces fonds étaient qualifiés de « dette » de la Grande-Bretagne envers la colonie, mais les autorités impériales n’en avaient apparemment jamais entendu parler avant que, en 1817, Sherbrooke ne révèle qu’ils s’élevaient en tout à £120 000.
Afin de régulariser dans une certaine mesure la procédure financière et d’éliminer tant la « dette » passée que les déficits futurs, Sherbrooke proposa en 1818 de chercher un accommodement avec l’Assemblée. Il s’agirait de faire examiner le budget chaque année par les deux chambres et de leur faire voter les crédits nécessaires aux dépenses ordinaires de la province, mais non de reconnaître à l’Assemblée un droit de regard sur toutes les formes de revenu. Une fois qu’il eut obtenu du secrétaire d’État aux Colonies la permission de mener cette négociation en visant à réduire les dépenses impériales, Sherbrooke fut prêt à inclure dans les estimations tous les postes de dépenses, si inexplicables qu’ils soient, sauf les salaires du clergé, que Plessis tout autant que l’évêque anglican Jacob Mountain désiraient omettre. Par rapport aux controverses passées et futures sur le contrôle des finances, le débat de 1818 se déroula dans les deux chambres avec une célérité et une unanimité remarquables. L’Assemblée ayant quelque peu protesté contre le versement de salaires aux fonctionnaires absentéistes, Sherbrooke recommanda à Bathurst de ne plus inscrire ces dépenses dans les estimations futures. En raison de cette objection et d’une maladie inopportune du gouverneur, l’Assemblée ne vota pas une loi de finances régulière mais présenta plutôt une adresse autorisant le gouverneur à combler son déficit budgétaire à même les revenus non affectés. Cette procédure imprécise était malhabile : on venait de perdre une occasion magnifique d’établir un précédent pour les futurs projets de loi de finances, et l’affectation des crédits redevint un brandon de discorde entre les gouverneurs et les Assemblées qui n’étaient pas en bonne intelligence.
Depuis son arrivée au Bas-Canada, Sherbrooke n’avait pas joui d’une santé robuste. En 1817, il se plaignit que le dur climat hivernal aggravait les malaises qu’il avait contractés en Inde et prévint Bathurst qu’il devrait démissionner l’année suivante, même s’il déplorait les fréquents changements de gouverneur et s’attristait de la perte de revenu que signifierait sa retraite prématurée. Le 6 février 1818, une grave attaque de paralysie le frappa, et il démissionna sans délai en recommandant que Dalhousie lui succède. Le 30 juillet, il confia plutôt l’administration au duc de Richmond [Lennox*], beau-frère de Bathurst, et, le mois suivant, il partit pour l’Angleterre. Ayant partiellement recouvré la santé, notamment grâce à des séjours aux stations thermales de Cheltenham et de Bath, Sherbrooke coula des jours tranquilles à Calverton, dans la campagne anglaise. Jusqu’à sa mort, survenue en 1830, il y accueillit de temps en temps des Canadiens, dont Plessis en 1819. En outre, il échangea avec des coloniaux et des fonctionnaires du gouvernement britannique une correspondance sur les affaires canadiennes, notamment le projet de loi de 1822 sur la réunion des provinces, qui ne vit jamais le jour.
On s’étonnera peut-être qu’un militaire au tempérament violent et à la santé précaire ait obtenu une application aussi harmonieuse de la constitution au Bas-Canada et ait mérité la confiance et le respect de coloniaux de toutes tendances politiques. Nommé gouverneur d’une colonie à l’âge de 46 ans en récompense de ses services militaires, sir John Coape Sherbrooke se révéla dans cette fonction civile un fin diplomate et un conciliateur habile. Instinctivement traditionaliste, il n’était cependant pas réactionnaire et, en abordant la politique coloniale dans une perspective pratique, il put conserver son sens des proportions et son objectivité. Il n’avait pas de préjugés tenaces et n’était pas affligé de cette sensibilité excessive aux prérogatives officielles ou aux honneurs personnels qui pervertit tant la conduite de gouverneurs comme Dalhousie. Sa réussite tint à ce qu’il était ouvertement déterminé à combattre l’esprit de clocher et à conserver une position neutre, à ce qu’il sut garder l’indépendance d’esprit nécessaire à la poursuite constante de ces objectifs et à ce que, par sa franchise engageante, il sut convaincre des hommes de toutes classes de sa probité et de son équité. Herman Witsius Ryland* avouait en janvier 1817 : il serait impossible « de trouver homme plus aimable, plus droit et plus honorable, et j’ai la conviction que sa sincérité virile, sa fermeté et son bon sens amèneront la majorité de l’Assemblée à [le] respecter et à suivre ses vues ». Par ailleurs, les circonstances favorisèrent Sherbrooke. D’un côté, le secrétaire d’État aux Colonies lui accorda une approbation sans réserve et lui donna toute latitude. D’un autre côté, à l’époque de son mandat, les personnages religieux et politiques de la province avec lesquels il noua des rapports amicaux, Plessis et Papineau par exemple, étaient disposés à la conciliation, tant en raison de leurs intérêts que de leurs inclinations. Par la force de son caractère et la perspicacité de son administration, Sherbrooke créa une accalmie dans la politique d’affrontement du Bas-Canada. Ce faisant, il mérita un titre exceptionnel : celui d’être l’un des rares officiers supérieurs de l’armée de Wellington dont la réputation se rehaussa lorsqu’il devint administrateur colonial.
Le Halifax Club possède un portrait de sir John Coape Sherbrooke peint par Robert Field*.
APC, MG 23, GII, 10, vol. 5 ; MG 24, A57 (mfm) ; B3, 3–4.— Nottinghamshire Record Office (Nottingham, Angl.), Reg. of baptisms for the parish of Arnold, 29 avril 1764.— PANS, MG 100, 152, no 1 ; RG 1, 62–63, 111–111A.— PRO, CO 42/166–179 ; 43/23–25 ; 217/88–98 ; 218/28–29.— B.-C., chambre d’Assemblée, Journaux, 1816–1818.— H.[E.] Bunbury, Narratives of some passages in the great war with France, from 1799 to 1810 (Londres, 1854).— Gentleman’s Magazine, janv.-juin 1830 : 558–559.— N.-É., House of Assembly, Journal and proc., 1811–1816.— P.H. [Stanhope], 5e comte Stanhope, Notes of conversations with the Duke of Wellington, 1831–1851 (Londres, 1888 ; réimpr., New York, 1973).— Halifax Journal, 19 avril 1830.— Cornelius Brown, Lives of Nottinghamshire worthies [...] (Londres, 1882), 326–327.— DNB.— G.-B., WO, Army list, 1780–1830.— H. J. Morgan, Sketches of celebrated Canadians.— Wallace, Macmillan dict.— Christie, Hist. of L.C. (1848–1855), 2. — Judith Fingard, The Anglican design in loyalist Nova Scotia, 1783–1816 (Londres, 1972).— Lambert, « Joseph-Octave Plessis ».— W. S. MacNutt, The Atlantic provinces : the emergence of colonial society, 1712–1857 (Toronto, 1965).— A. P. Martin, Life and letters of the Right Honourable Robert Lowe, Viscount Sherbrooke [...] with a memoir of Sir John Coape Sherbrooke [...] (2 vol., Londres, 1893).— Murdoch, Hist. of N.S.— Ouellet, Economic and social hist. of Que. ; Lower Canada (Claxton).— Taft Manning, Revolt of French Canada.— Evening Mail (Halifax), 11 nov. 1896.— D. C. Harvey, « The Halifax–Castine expedition », Dalhousie Rev., 18 (1938–1939) : 207–213.— Helen Taft Manning, « The civil list of Lower Canada », CHR, 24 (1943) : 24–47.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Peter Burroughs, « SHERBROOKE, sir JOHN COAPE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/sherbrooke_john_coape_6F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/sherbrooke_john_coape_6F.html |
| Auteur de l'article: | Peter Burroughs |
| Titre de l'article: | SHERBROOKE, sir JOHN COAPE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1987 |
| Année de la révision: | 1987 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |