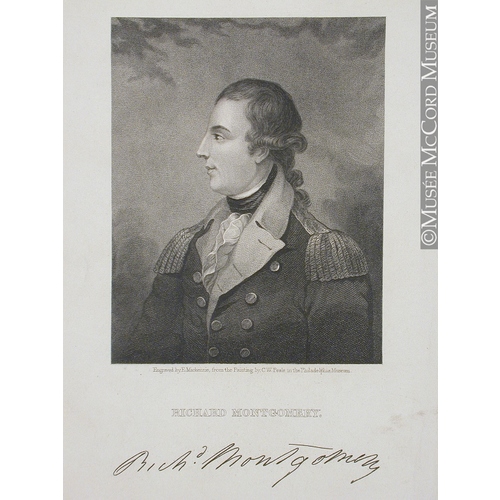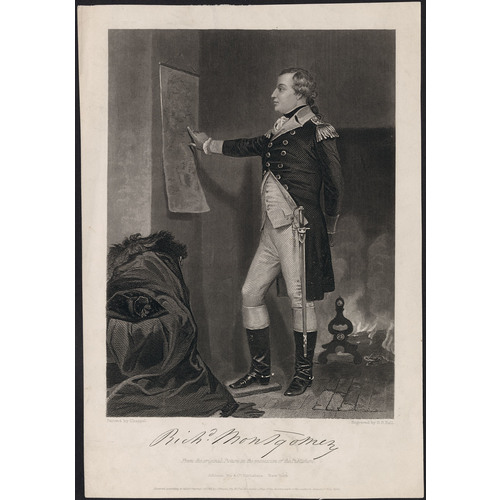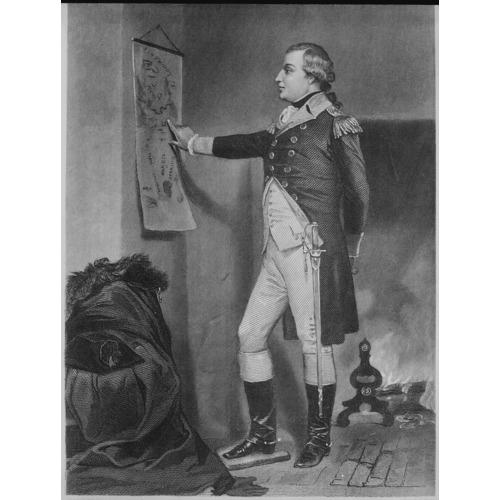Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
MONTGOMERY, RICHARD, officier, né le 2 décembre 1736 près de Swords (République d’Irlande), troisième fils de Thomas Montgomery, député de Lifford au parlement irlandais, et de Mary Franklyn (Franklin) ; il épousa le 24 juillet 1773 Janet Livingston ; décédé à Québec le 31 décembre 1775.
Richard Montgomery naquit dans une famille respectable de la petite noblesse irlandaise et, après ses premières classes, on l’envoya au Trinity College de Dublin, en 1754. Il n’y obtint point de diplôme, cependant, entrant plutôt dans l’armée, à titre d’enseigne dans le 17e d’infanterie, le 21 septembre 1756. Son régiment fut très actif outre-mer pendant la guerre de Sept Ans. Présent avec Amherst au lac Champlain en 1759, le régiment participa avec William Haviland aux opérations qui menèrent à la conquête du Canada en 1760 ; en 1762, il prit part aux attaques contre la Martinique et contre La Havane, à Cuba. Au cours de ces années, Montgomery prit régulièrement du galon : lieutenant en juillet 1758, adjudant-major du régiment en mai 1760 et capitaine en mai 1762. Mais la carrière des armes, pendant la période de paix inaugurée en 1763, se révéla décevante par suite de l’incapacité de Montgomery d’obtenir de l’avancement, et, en avril 1772, il vendit sa commission et émigra en Amérique. Il y acheta une ferme près de New York, où il s’adonna à la « passion violente » qu’il s’était récemment découverte pour la culture de la terre. Son mariage, l’année suivante, au sein de la puissante famille Livingston, aux convictions fortement procoloniales, apparaissait assez extraordinaire, vu ses antécédents, mais il avait des liens d’amitié avec des hommes politiques libéraux d’Angleterre et était devenu sympathique à la cause américaine. Il s’établit, avec son épouse, sur la propriété de cette dernière, près de Rhinebeck, New York.
Les affrontements armés entre les troupes britanniques et les colons, à Lexington et à Concord, Massachusetts, en avril 1775, déclenchèrent des hostilités en d’autres lieux, et, en mai, Ethan Allen et Benedict Arnold* capturèrent les forts frontaliers de Crown Point et de Ticonderoga, New York. Ceux-ci poursuivirent leur avantage en lançant des raids contre le Canada, jusqu’à Saint-Jean (Québec), et la bonne chance relative qui marqua ces opérations les convainquit du succès d’une invasion de cette province. Le Congrès continental s’était inquiété depuis quelques mois du danger potentiel que représentaient pour les colonies du Nord les troupes britanniques, les Canadiens et les Indiens qui avaient leurs bases au Canada. Mais, à part quelques adresses à la population canadienne pour l’inciter à la solidarité avec les autres colonies, il n’avait jusque-là accordé que peu d’attention au Canada, et, en fait, le 1er juin, il en interdit toute invasion. Cependant, à la suite des rapports d’Allen et d’Arnold sur la faiblesse des défenses britanniques et sur leur conviction que les Canadiens seraient enclins à demeurer neutres si les Américains les envahissaient, et devant des renseignements qui allaient fortement dans le même sens, en provenance de sympathisants et d’émissaires américains au Canada, le Congrès changea sa politique. Le 27 juin, il ordonna au major général Philip John Schuyler, commandant de la colonie de New York, de rassembler une armée et de s’emparer de île aux Noix, sur la rivière Richelieu, de Saint-Jean et de Montréal, et d’infliger une défaite aux troupes britanniques du Canada « si cela se révélait possible et [...] non [...] désagréable aux Canadiens ». On devait presser les Canadiens et les Indiens du Canada de rester neutres et même d’adhérer à l’union des colonies ; on dépêcha des émissaires en vue de réaliser ces objectifs. En juillet et août, quelque 2 000 hommes commencèrent à se rassembler dans le nord de la colonie de New York. Montgomery était commandant en second de l’expédition. Son appui à la cause américaine avait amené son élection au Congrès provincial de New York, plus tôt en 1775, et, le 22 juin, on le nomma général de brigade dans l’armée continentale récemment formée, sans doute en considération de son expérience militaire antérieure. Mais Montgomery hésita d’abord à accepter ce grade. Il ne voulait pas quitter sa femme ni le confort de la vie civile, non plus que prendre les armes contre ses compatriotes ; il y consentit à la longue, en partie parce qu’il croyait que « la volonté d’un peuple opprimé [...] doit être respectée ».
Pendant ce temps, le gouverneur Guy Carleton*, de la province de Québec, éprouvait des difficultés considérables à lever une armée aux fins de la défense. Quand il fit appel à la milice, en juin, pour riposter aux raids américains, il rencontra dans la population une forte opposition à l’idée même de servir dans la milice et un sentiment fort répandu en faveur de la neutralité. Si la milice fut finalement organisée en août, Carleton resta convaincu qu’il serait « peu sage de tenter de rassembler un certain nombre [de miliciens], sauf en cas d’absolue nécessité ». Avec seulement 800 soldats de l’armée régulière britannique en garnison dans la province, le gouvernement se trouvait en situation de faiblesse.
Plusieurs raisons expliquaient la réaction de la population. Depuis la fin de 1774, des lettres, des adresses, des brochures et des rapports avaient circulé au Canada, en provenance des colonies américaines prônant la neutralité dans tout conflit ; ils avaient eu un retentissement considérable, d’autant qu’on avait présenté les clauses de l’Acte de Québec de 1774 sous un faux jour dans la province. Cette propagande avait été surtout le fait de marchands britanniques et américains, comme Thomas Walker, qui, irrités du refus du gouvernement britannique de leur accorder, dans l’Acte de Québec, les lois anglaises et une chambre d’Assemblée, avaient accueilli avec sympathie la cause américaine. Ces marchands purent prôner un peu partout leurs idées au cours de l’été de 1775 et même après le début des hostilités. En outre, alors que les seigneurs, le clergé et la bourgeoisie étaient presque unanimement loyaux aux Britanniques, grâce aux garanties religieuses et juridiques de l’Acte de Québec, l’ensemble de la population, pour des raisons ayant trait à la langue et à la religion, à cause aussi du souvenir de la Conquête, était encore assez détachée pour prêter une oreille attentive aux demandes des Américains de rester neutre. Pendant la levée des milices, Carleton avait fait l’erreur, relativement à leur organisation, de confier trop de responsabilités aux seigneurs. Non seulement avaient-ils perdu de leur influence depuis la Conquête, pour des motifs économiques et par suite d’un sentiment accru d’indépendance à leur égard parmi les censitaires, mais ils avaient en plus fait preuve de favoritisme en choisissant les officiers de milice et s’étaient montrés hautains, si bien qu’ils avaient réussi à s’aliéner ceux même des habitants les plus enclins à la modération. De même les menaces de sanctions ecclésiastiques, de la part des autorités religieuses, à l’endroit des miliciens récalcitrants n’eurent pas beaucoup d’effets. La faiblesse même de la garnison britannique constituait une dernière explication ; la population pouvait raisonner ainsi : puisque les Britanniques paraissaient incapables de les défendre, il eût été peu raisonnable de s’aliéner les Américains. D’ailleurs, Carleton ne pouvait entretenir qu’un léger espoir d’obtenir des renforts de Gage, à Boston ; comme il l’a dit lui-même, « chaque individu semblait conscient de notre situation actuelle d’impuissance ». Il y avait, à vrai dire, au sein de la population canadienne, certains courants de fond en faveur d’un appui aux Britanniques, qui eussent pu déboucher sur quelque aide au gouvernement, mais cette aide allait dépendre pour une bonne part de l’évolution de la situation.
Au début de septembre, les troupes de Schuyler s’installèrent sur le sol canadien, à l’île aux Noix. Schuyler proclama qu’il « recev[rait] de la manière la plus favorable tout habitant du Canada et tout ami de la liberté », qu’il protégerait leurs biens et leur assurerait la liberté de religion. Dès le début, nombre de Canadiens vinrent offrir leurs services. Les paroisses du Richelieu réagirent particulièrement vite à cet égard, elles qui s’étaient montrées spécialement réceptives à la propagande américaine, et James Livingston, ancien marchand de grain de Sorel et parent de Montgomery, fut nommé commandant des volontaires. D’autres, en plus grand nombre, sans prendre une part active aux opérations, fournirent des vivres et des moyens de transport aux troupes américaines. On devait payer ces services en argent comptant, cependant, les Canadiens ayant encore à la mémoire la cuisante expérience de la monnaie de papier du Régime français.
Le premier objectif des envahisseurs était le fort Saint-Jean, où l’on conservait de grandes quantités de matériel militaire. La garnison se composait aussi d’environ 500 réguliers de l’armée britannique commandés par le major Charles Preston, aidés d’un groupe de volontaires canadiens sous les ordres de François-Marie Picoté de Belestre. Schuyler, parce qu’il n’avait « pas joui d’un [seul] moment de santé » depuis quelque temps, passa le commandement à Montgomery le 16 septembre et rentra chez lui. Pendant le siège, gêné dans ses initiatives par le mauvais temps, la faiblesse de son artillerie et l’insuffisance de matériel militaire, de même que par la piètre discipline de ses hommes aux prises avec la maladie, Montgomery vint près de démissionner par déception. Jusqu’à la fin de septembre, seuls un blocus du fort et un bombardement par intermittence s’avérèrent possibles, ce « qui n’ennuya jamais l’ennemi le moins du monde ». À Montréal, Carleton n’avait pas encore pu lever une véritable troupe de miliciens. Mais, à la fin de septembre, la situation changea soudain. Le 25, un groupe rapidement rassemblé de soldats de l’armée régulière, de miliciens et d’Indiens, commandé par le major John Campbell, infligea une défaite à Ethan Allen et à un corps d’armée constitué de Canadiens et d’Américains, qui avaient tenté de s’emparer de Montréal par surprise. L’effet de cette victoire fut tel que, selon l’avocat Simon Sanguinet, quelque 1 200 miliciens rallièrent Montréal en une semaine pour offrir leurs services, dont 300 de Varennes, menacée par les rebelles, qui arrivèrent « avec la meilleure volonté du monde ». Carleton pouvait maintenant rassembler une armée de 2 000 hommes, miliciens pour la plupart, et l’on espérait qu’il allait bientôt contre-attaquer.
Mais, pendant trois semaines, le gouverneur ne bougea pas, en partie par manque de confiance envers la milice pour ses hésitations de naguère et envers leurs chefs pour la perte de leur influence, et en partie par désir d’éviter de se battre davantage avec les Américains, dans l’espoir d’une réconciliation. Découragés et gagnés par l’ennui, les miliciens commencèrent à partir avec l’autorisation des autorités, ou à déserter, pour faire les moissons et pour protéger leurs maisons et leurs familles contre des représailles possibles. Puis, le 18 octobre, le fort Chambly se rendit à un corps d’armée américain largement composé de Canadiens, ce qui mit à la disposition des assiégeants de Saint-Jean des munitions et des ravitaillements en abondance. Ailleurs dans la province, les Canadiens persistèrent dans leur refus de servir une cause qu’ils considéraient maintenant en péril. Adam Mabane trouva devant lui 250 hommes armés de bâtons quand il essaya de recruter des miliciens dans l’île d’Orléans, et l’on rapporta que 15 hommes seulement vinrent des paroisses en aval de Québec pour aider le gouvernement. Plus loin, du côté ouest, d’autres Canadiens empêchèrent par la force Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour et Jean-Baptiste-Marie Blaise Des Bergères de Rigauville, à Berthier-en-Haut (Berthierville) et à Verchères, de rallier les troupes du gouvernement avec les miliciens qu’ils avaient rassemblés. Quand ils apprirent ces faits, de 30 à 40 miliciens commencèrent à déserter chaque nuit, à Montréal. Il devenait évident, dans ces circonstances, que Carleton devait organiser une contre-offensive ou voir fondre ses effectifs, mais il ne passa à l’action que le 30 octobre. Quelque 1 000 miliciens, Indiens et soldats de l’armée régulière devaient débarquer à Longueuil et se porter au secours de Saint-Jean, mais les Américains les en empêchèrent. Les défenseurs du fort devenaient à court de provisions ; Montgomery disposait de nouvelles batteries qui détruisaient les constructions, et la réserve de munitions était quasi épuisée. Ayant appris l’échec de la troupe de renfort, la garnison se rendit le 3 novembre. Quelque 2 000 Américains et plusieurs centaines de Canadiens s’opposaient maintenant, autour de Montréal, à environ 150 réguliers britanniques et à une milice canadienne en voie de disparition rapide. Carleton n’eut guère d’autre choix que d’évacuer Montréal le 11 avec ses troupes régulières et de mettre à la voile pour Québec. La menace des batteries américaines arrêta la flotte à Sorel et, si Carleton et son aide de camp Charles-Louis Tarieu* de Lanaudière s’arrangèrent pour s’échapper avec l’aide de Jean-Baptiste Bouchette*, le reste du corps d’armée dut se rendre le 19 novembre, ce qui, effectivement, laissait au gouvernement la seule ville de Québec comme point de résistance.
Montgomery avait débarqué des troupes dans l’île des Sœurs, près de Montréal, le 11 novembre, et, le lendemain, il recevait un comité de citoyens de Montréal, dont faisaient partie James McGill*, Jean-Louis Besnard, dit Carignant, et Pierre-Méru Panet*. Tout en rejetant leur demande d’accepter une capitulation en forme, le général américain promit de ne pas obliger les Loyalistes à s’opposer ouvertement au gouvernement, de garantir la « paisible jouissance des biens » et d’autoriser le « libre exercice [...] de la religion ». Montréal fut occupée le 13, et Valentin Jautard présenta une adresse de bienvenue de la part de quelques habitants proaméricains. Peu après, Montgomery reçut une délégation de Trois-Rivières, dont faisait partie Jean-Baptiste Badeaux, et il promit que l’on traiterait bien leur ville. Mais, même si la résistance britannique s’était effondrée dans presque toute la province et que les Canadiens observaient en général une neutralité bienveillante à l’endroit des Américains, Montgomery voulut s’assurer leur collaboration active. Croyant qu’il ne pourrait y arriver à moins de prendre Québec, il partit pour réaliser cet objectif avec 300 hommes, le 28 novembre, laissant une garnison de 500 hommes, sous les ordres du général de brigade David Wooster, à Montréal, Saint-Jean et Chambly.
À Québec, entre-temps, le lieutenant-gouverneur Hector Theophilus Cramahé tentait de défendre la ville, mais les sympathies proaméricaines d’une partie de la population le gênèrent lui aussi dans ses initiatives. Au début de novembre, les choses avaient empiré à la nouvelle qu’une seconde armée américaine se trouvait à proximité de Québec. Cette armée, commandée par Benedict Arnold, avait quitté Cambridge, Massachusetts, en septembre, avec l’ordre de George Washington lui-même de tenter de surprendre Québec ou, au moins, de rallier Montgomery. Sa marche à travers la forêt vierge, hors de tout sentier tracé, jusqu’à la rivière Kennebec (Maine) et, ensuite, par delà la hauteur des terres, jusqu’à la rivière Chaudière, avait été épuisante. Seulement 600 hommes environ des 1 100 au départ atteignirent Pointe-Lévy (Lauzon, Lévis) le 9 novembre. Les Américains traversèrent du côté des plaines d’Abraham dans la nuit du 13, mais six jours plus tard ils se replièrent en amont, à Pointe-aux-Trembles (Neuville), pour y attendre Montgomery. Malgré l’accueil que les habitants du lieu réservèrent aux rebelles mourant de faim, leur fournissant des vivres et des moyens de transport, les Américains étaient néanmoins « presque nus », disposaient de peu de munitions et craignaient une sortie des Britanniques. Montgomery arriva le 3 décembre et prit le commandement ; deux jours plus tard commençait le siège de Québec. Avec l’apport, des Canadiens locaux [V. Maurice Desdevens de Glandon] et de l’unité de Livingston (promue au rang de régiment américain), les forces rebelles se composaient d’environ 1 000 Américains et 200 Canadiens, dispersés par groupes sur les plaines d’Abraham, en descendant jusqu’à la rivière Saint-Charles. La population locale les approvisionna en bois et en vivres (cette fois encore, contre espèces sonnantes) et le moral était élevé, même si on notait une forte baisse dans les approvisionnements. À l’intérieur de la ville de Québec, le moral était meilleur depuis l’arrivée, le 11 novembre, du lieutenant-colonel Allan Maclean avec 100 hommes de son régiment des Royal Highlands Emigrants, récemment recruté, et de Carleton lui-même, le 19. Le gouverneur expulsa immédiatement tous ceux qui refusaient de servir dans la milice et il fit faire des préparatifs pour une vigoureuse défense : on installa des canons sur les murs et les barricades, et on construisit des blockhaus. La garnison, de 1 800 hommes, composée de miliciens britanniques et canadiens, de soldats de l’armée régulière, de marins et de quelques artificiers, disposait de suffisamment de provisions pour nourrir la population de 3 200 habitants et se nourrir elle-même pendant huit mois, en plus d’un abondant matériel militaire.
Montgomery découvrit bientôt que l’artillerie britannique était de loin supérieure à la sienne, mais il n’avait jamais eu l’intention de bombarder Québec jusqu’à sa reddition. Les pressions de ses supérieurs de Boston et de Philadelphie, qui avaient un urgent besoin du matériel militaire de Québec, la petite vérole qui sévissait parmi ses hommes, l’expiration imminente de plusieurs contrats d’enrôlement et le peu de probabilité d’obtenir des renforts immédiats le convainquirent qu’il devait attaquer la ville plutôt que d’en faire le blocus jusqu’au printemps. On décida finalement de mener une attaque concentrique sur la basse ville, en espérant que la confusion et les collaborateurs forceraient Carleton à abandonner la haute ville, puissamment fortifiée, pour livrer bataille. On donna des ordres pour déclencher l’attaque à la première nuit sombre.
La nuit du 30 au 31 décembre répondait à cette condition. À cinq heures du matin environ, alors qu’une tempête faisait rage, Montgomery et 200 hommes avancèrent sur la rive, le long du fleuve, à partir du cap Diamant, en direction du district de Près-de-Ville. Au même moment, les 600 hommes d’Arnold avançaient, à partir du faubourg Saint-Roch, vers la rue Sault-au-Matelot, et en direction de Montgomery, avec qui ils devaient opérer leur jonction dans la basse ville. Les défenseurs, prévenus par des déserteurs et alertés par le capitaine Malcolm Fraser*, se préparèrent rapidement à l’action. À Près-de-Ville se trouvaient des marins britanniques sous les ordres du capitaine Adam Barnsfare et des miliciens canadiens sous les ordres de François Chabot et de Louis-Alexandre Picard, accompagnés de John Coffin*. Eux-mêmes invisibles dans la poudrerie, ils surveillèrent jusqu’à ce que Montgomery et quelques autres bougeassent à la tête du groupe principal, puis firent une décharge générale qui les abattit. Les autres Américains firent rapidement retraite. Sur l’autre front, on évacua Arnold, blessé, mais ses hommes s’activèrent pour contourner une barricade, au Sault-au-Matelot, et faire quelques prisonniers. L’opiniâtre résistance de soldats réguliers et de miliciens aux ordres de Henry Caldwell*, au cours de laquelle John Nairne* et François Dambourgès jouèrent un rôle de premier plan, les arrêta. Informé de l’échec de Montgomery, Carleton opéra un transfert de troupes et entoura les hommes d’Arnold, qui capitulèrent vers huit heures. La prétention d’un officier britannique, à l’effet que la garnison avait remporté « une petite victoire aussi complète qu’il en fût jamais », était justifiée. De 60 à 100 rebelles avaient été tués ou blessés et quelque 400 autres faits prisonniers, tandis que dans l’autre camp on avait subi la perte de moins de 20 Britanniques et Canadiens.
Ce qui restait des Américains, maintenant commandés par Arnold, craignait une contre-attaque britannique ; Carleton, incertain du moral de sa garnison, s’enferma prudemment à l’intérieur de Québec pendant le reste de l’hiver. La puissance des rebelles restait faible, en dépit des renforts, à cause de l’épidémie persistante de petite vérole et de l’expiration des contrats d’engagement des combattants. Aussi ne purent-ils maintenir le blocus de la ville qu’en ne la bombardant que par intermittence ; en quatre mois, ces bombardements « tuèrent [seulement] un garçon [et] une vache, blessèrent un marin et une dinde, et convulsèrent une vieille femme ». Le 1er avril 1776, Wooster remplaça Arnold, découragé, qui alla commander à Montréal ; un mois plus tard, le major général John Thomas succéda à Wooster. Thomas pouvait rassembler 1 900 hommes, dont seulement 1 000 aptes au combat ; de ceux-ci, 300 réclamaient leur licenciement en raison de l’échéance de la période de leur enrôlement.
Entre-temps, l’attitude des Canadiens avait changé. Un courant de loyalisme s’était maintenu dans beaucoup de régions, et, en mars, un groupe de Canadiens avait même tenté une attaque contre le camp américain de Pointe-Lévy [V. Charles-François Bailly de Messein ; Michel Blais]. Si la majorité n’opta point pour une action aussi apparente, elle devenait néanmoins plus antiaméricaine, sinon probritannique. Le clergé, d’une loyauté inébranlable, exerçait une influence notable, de même que les classes supérieures de la société. En outre, la faiblesse continuelle des armées américaines amenait les habitants aux mêmes conclusions qu’ils avaient naguère tirées de la faiblesse des Britanniques. Les Canadiens ne désiraient plus se battre pour les rebelles : Moses Hazen* se plaignit que le recrutement d’un régiment qu’il effectuait pour le Congrès progressait peu et que les hommes ne convenaient point à la tâche, désertant à la première occasion. L’usage croissant que firent les américains de la monnaie de papier et de billets à ordre pour le paiement des biens et services – ce qui apparut à la population comme un indice de la faillite financière de la cause américaine – s’avéra le plus grand facteur individuel de ce changement. Et si l’on considère que les Américains réquisitionnaient fréquemment aussi les vivres et approvisionnements, la désaffection croissante de la population à leur endroit est compréhensible. Montréal, en particulier, eut de bonnes raisons de regretter l’invasion. Wooster s’était lancé dans une série de mesures arbitraires et mal calculées, pendant l’hiver de 1775–1776, qui allaient à l’encontre de la plupart des promesses de Montgomery. Il ferma les « Maisons du culte » la veille de Noël, tenta d’arrêter des Loyalistes comme Simon Sanguinet et Georges-Hippolyte Le Comte Dupré, et annonça l’arrestation pour trahison de tous ceux qui s’opposeraient aux désirs du Congrès. Non content de tout cela, il prit Edward William Gray* et René-Ovide Hertel de Rouville comme otages pour s’assurer que trois faubourgs, jugés hostiles aux Américains, désarmeraient, et il arrêta Le Comte Dupré et Thomas-Ignace Trottier Dufy Desauniers après leur refus d’échanger leurs commissions de la milice britannique contre des commissions américaines. Au printemps de 1776, le prestige américain avait à ce point sombré que Benjamin Franklin, Charles Carroll et Samuel Chase, qui arrivèrent à Montréal en avril, à titre de commissaires nommés par le Congrès pour entreprendre la conversion politique des Canadiens, furent bientôt découragés et conseillèrent même l’abandon du pays.
Les Canadiens, cependant, dissimulaient encore en grande partie tout appui aux Britanniques, et seuls de grands renforts du côté britannique pouvaient réellement en faire des adversaires actifs des Américains. Le 6 mai 1776, une petite escadre sous les ordres de Charles Douglas mouillait au large de Québec et y débarquait des troupes. Carleton fit une sortie le même jour. Se préparant à lever le siège, les Américains, qui n’étaient point sur leurs gardes, battirent en retraite « dans une hâte et une confusion extrêmes », ne s’arrêtant qu’à Sorel. Carleton refusa de les poursuivre et attendit plutôt les renforts massifs de soldats réguliers britanniques et allemands, sous les ordres de Burgoyne, qui approchaient, en provenance de Grande-Bretagne. À la mi-mai, un détachement ad hoc de soldats réguliers, d’Indiens et de Canadiens des postes des lacs Supérieur, Huron et Michigan fit prisonniers 400 Américains aux Cèdres, à l’ouest de Montréal. Les troupes américaines ne tenaient plus alors que la région de Montréal et de la vallée du Richelieu, mais d’importants renforts rendus disponibles par la fin du siège de Boston permirent au général de brigade John Sullivan, qui commandait alors au Canada (Thomas était mortellement atteint de la petite vérole et Wooster avait été rappelé pour rendre compte de sa conduite à Montréal), de concentrer 5 000 hommes à Sorel, à la fin de mai. Comme première étape dans la contre-offensive projetée, Sullivan envoya le général de brigade William Thompson et 2 200 hommes attaquer Trois-Rivières, qu’on croyait faiblement défendue. Mais l’avance de Thompson fut ralentie [V. François Guillot, dit Larose] et, quand les Américains arrivèrent devant la ville, le 8 juin, ils la trouvèrent sous la protection de 7 000 soldats britanniques de l’armée de Burgoyne. Battus d’importance, les rebelles laissèrent sur place 200 prisonniers, dont Thompson lui-même. Par la suite, leur position au Canada se détériora rapidement. Quelque 10 000 soldats britanniques et allemands les pourchassèrent de près en aval du Saint-Laurent, près de 3 000 Américains tombèrent malades et les Canadiens commencèrent à se tourner ouvertement contre les envahisseurs. Le 18 juin, les armées d’Arnold, qui s’échappa de justesse de Montréal, et de Sullivan avaient reculé jusqu’à Saint-Jean, et, deux semaines plus tard, poursuivies de près par les Britanniques, elles s’étaient repliées au delà de la frontière. On ne fit aucune autre tentative, au cours de la guerre, pour envahir le Canada même si des rumeurs à cet effet maintinrent Haldimand dans l’inquiétude.
Pendant que les Américains effectuaient leur retraite, la province de Québec revenait à la vie normale. Carleton fit en général preuve d’indulgence envers les habitants qui avaient appuyé les rebelles, peut-être à cause de sa propre prédiction, faite avant l’invasion, que les Canadiens n’aideraient pas le gouvernement en grand nombre. On décerna tout de même certaines punitions. Le gouverneur nomma une commission, formée de Gabriel-Elzéar Taschereau*, de François Baby* et de Jenkin Williams*, pour enquêter sur la nature et l’étendue de la collaboration avec l’ennemi dans la région de Québec ; du 22 mai au 16 juillet, elle fit le tour des paroisses. La commission découvrit que beaucoup de paroisses avaient activement appuyé et encouragé les envahisseurs, que d’autres étaient restées neutres, et qu’un petit nombre avaient été sympathiques au gouvernement. Néanmoins, les seules représailles adoptées consistèrent, en général, à remplacer beaucoup d’officiers de milice, qui avaient été particulièrement favorables aux Américains, et à obliger les paroisses qui s’étaient montrées particulièrement déloyales à loger les soldats. Malgré la douceur des punitions, on se plaignit de leur distribution inéquitable, et, une fois l’invasion passée, Carleton adopta une attitude beaucoup plus dure envers les sympathisants américains et en emprisonna plusieurs. Il eut, dans ses efforts pour restaurer l’ordre, l’aide de l’Église qui conserva une attitude ferme à l’endroit des partisans et des relaps. Mgr Briand décréta qu’on refuserait les sacrements à ces sympathisants qui ne répareraient point leur faute par quelque pénitence publique, mais il s’écoula quelque temps avant qu’on se pliât d’une façon générale à cette directive, et beaucoup refusèrent de se repentir.
L’invasion du Canada fut une campagne de peu d’importance à l’intérieur de ce qui devint bientôt un conflit beaucoup plus étendu et beaucoup plus compliqué, et, à tout prendre, elle s’avéra inutile. Les Américains n’avaient aucune idée précise de leurs objectifs en envahissant le pays et, quand il devint évident qu’il devait être entièrement occupé et pacifié, leur organisation rudimentaire ne put soutenir un défi de cette envergure. En tout état de cause, il était à peu près inévitable que, tôt ou tard, les Britanniques auraient organisé une contre-offensive – la perte du Canada aurait été un coup sérieux porté à leurs espoirs d’écraser rapidement la rébellion – et que, compte tenu de leur suprématie navale incontestée, ils auraient pu concentrer assez de troupes pour reconquérir la province. Mais si les Canadiens s’étaient portés fortement d’un côté ou de l’autre, l’invasion aurait échoué, ou, si elle avait réussi, la reconquête aurait été plus sanglante et plus longue. Qu’ils aient choisi de conserver une neutralité changeante indique leur manque de sympathie pour l’un et l’autre côté et leur prise de conscience du fait que la pratique d’une neutralité souple constituait le parti qui pouvait le mieux servir leurs intérêts dans les circonstances fluctuantes et incertaines de l’invasion, et leur épargner la misère qui avait accompagné la Conquête, 15 ans plus tôt.
Après la défaite des Américains devant Québec, au matin du 31 décembre 1775, on découvrit sous un amoncellement de neige les corps gelés de Montgomery et de plusieurs de ses compagnons. Thomas Ainslie* nota que ceux qui, à Québec, avaient connu l’officier américain (il avait été promu major général le 9 décembre mais n’en reçut jamais la nouvelle) exprimèrent leurs sincères regrets de sa mort, et même Carleton pleura apparemment son « ami induit en erreur ». Cramahé fit « décemment enterrer » le corps de Montgomery, à ses propres frais. En 1818, on retournera le corps de Montgomery aux États-Unis. Ses compatriotes, qui le considéraient comme un officier populaire et prometteur, le regrettèrent. Le capitaine Simeon Thayer, de l’armée d’Arnold, laissa de lui ce portrait : « un homme d’une apparence distinguée, grand et svelte, [...] d’un caractère agréable, et un vertueux général ».
On a beaucoup écrit sur la Révolution américaine, mais peu sur Montgomery en raison de sa courte participation à l’événement. Il y a bien la biographie de A. L. Todd, Richard Montgomery : rebel of 1775 (New York, 1966), mais la recherche superficielle sur laquelle s’appuie cet ouvrage et son style naïf en font une étude de peu de valeur. Montgomery a fait l’objet d’une biographie dans le DAB et le DNB. Les renseignements d’ordre biographique proviennent notamment des sources suivantes : G.-B., WO, Army list, 1756–1772 ; F. B. Heitman, Historical register of officers of the Continental Army during the war of the revolution [...] (Washington, 1893) ; et T. H. Montgomery, « Ancestry of Gen. Richard Montgomery », New-York Geneal. and Biographical Record (New York), II (1871) : 123–130. [s. r. j. s.]
[Thomas Ainslie], Journal of the most remarkable occurences in the province of Québec from the appearance of the rebels in September 1775 until their retreat on the sixth of May 1776, F. C. Würtele, édit., Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 7e sér. (1905) : 9–89.— American archives (Clarke et Force), 4e sér., III–VI.— APC Report, 1914–1915, app.B, 5–25.— [Henry Caldwell], The invasion of Canada in 1775 : letter attributed to Colonel Henry Caldwell, Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 2e sér. (1868) : 1–19.— Canada, Dép. de la Milice et de la Défense, État-major général, A history of the organization, development and services of the military and naval forces of Canada, from the peace of Paris in 1763, to the présent time [...] (3 vol., [Ottawa, 1919–1920]), I.— [Jacob Danford], Québec under siege, 1775–1776 : the « Mémorandums » of Jacob Danford, J. F. Roche, édit., CHR, L (1969) : 68–85.— Docs. relating to constitutional history, 1759–1791 (Shortt et Doughty ; 1907), 450–459.— Invasion du Canada (Verreau).— Journal of the most remarkable occurences in Québec since Arnold appear’d before the town on the 14th November 1775, Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 7e sér. (1905) : 93–154.— Journal of the siege and blockade of Quebec by the American rebels, in autumn 1775 and winter 1776, Literary and Hist. Soc. of Québec, Hist. Docs., 4e sér. (1875) : 3–25.— Journal par Messrs Frans Baby, Gab. Taschereau et Jenkin Williams [...], Ægidius Fauteux, édit., ANQ Rapport, 1927–1928, 431–499.— March to Québec : journals of the members of Arnold’s expédition, K. L. Roberts, édit. (New York, 1938).— Orderly book begun by Captain Anthony Vialar of the British militia [...], F. C. Würtele, édit., Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 7e sér. (1905) : 155–265.— [Rudolphus Ritzema], Journal of Col. Rudolphus Ritzema, of the First New York Regiment, August 8, 1775, to March 30, 1776, Magazine of American History (New York), I (1877) : 98–107.— Rôle général de la milice canadienne de Québec [...], Literary and Hist. Soc. of Québec, Hist. Docs., 8e sér. (1906) : 269–307.— State papers, APC Report, 1890.— Boatner, Encyclopedia of American révolution.— The toll of independence : engagements and battle casualties of the American revolution, H. H. Peckham, édit. (Chicago, 1974).— Allen French, The first year of the American revolution (Cambridge, Mass., 1934).— Lanctot, Canada and American revolution.— J. H. Smith, Our struggle for the fourteenth colony, : Canada and the American revolution (2 vol., New York, 1907).— G. F. G. Stanley, Canada invaded, 1775–1776 (Toronto, 1973).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Stuart R. J. Sutherland, « MONTGOMERY, RICHARD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/montgomery_richard_4F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/montgomery_richard_4F.html |
| Auteur de l'article: | Stuart R. J. Sutherland |
| Titre de l'article: | MONTGOMERY, RICHARD |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1980 |
| Année de la révision: | 1980 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |