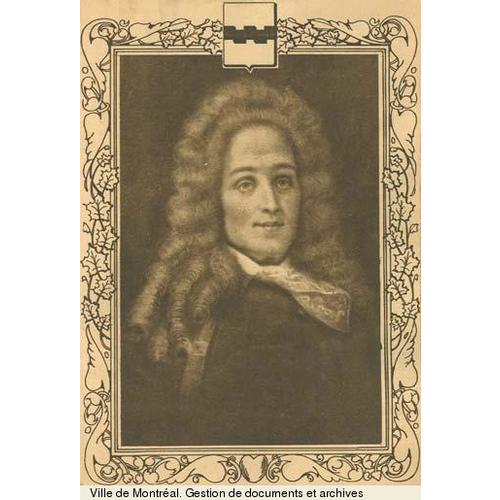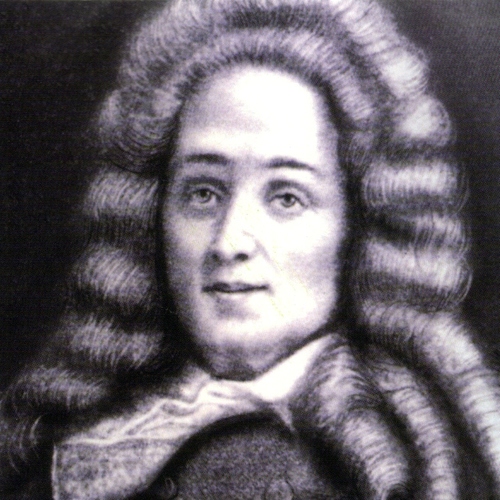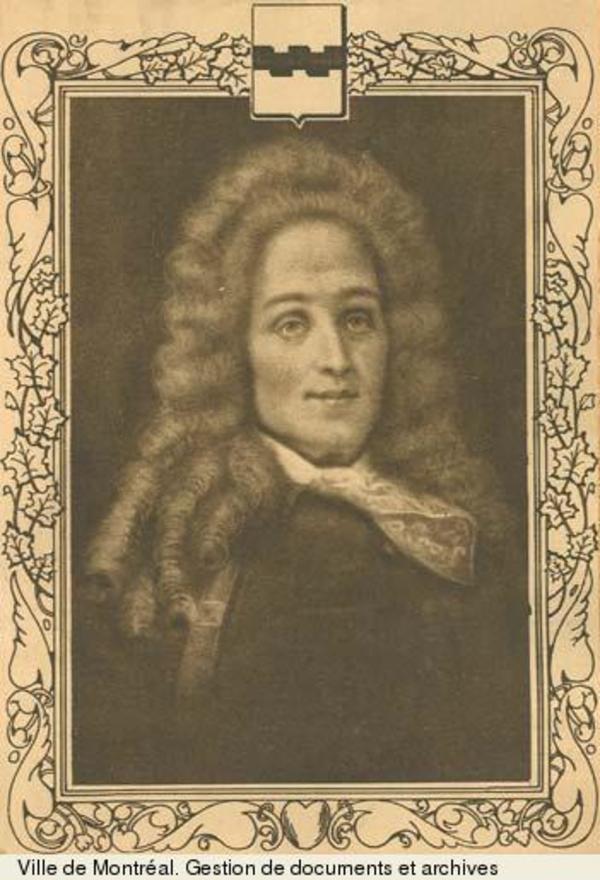
Provenance : Lien
CALLIÈRE, LOUIS-HECTOR DE (le nom s’écrit généralement Callières, mais il a toujours omis le « s » dans sa signature), chevalier, capitaine en France, gouverneur de Montréal, gouverneur général de la Nouvelle-France, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, né à Thorigny-sur-Vire, en Normandie, le 12 novembre 1648 ; mort à Québec le 26 mai 1703.
La famille Callières était originaire de l’Angoumois. En 1490, les commissaires du roi de cette province reconnurent les titres de noblesse de Jehan de Callières. Deux ans plus tard, grâce à son mariage avec Perrette Du Fort, ce Jehan de Callières devenait seigneur de Clérac, en Saintonge, et c’est là que la famille choisit d’établir sa demeure principale.
Le père de Louis-Hector, Jacques de Callières, naquit en Touraine, on ne sait à quelle date. Il fit partie de la suite des puissantes familles Matignon et Orléans-Longueville, dont la protection lui permit de devenir maréchal de camp dans l’armée du roi et, en 1644, gouverneur de la ville de Cherbourg, en Normandie. Ces fonctions ne l’empêchèrent pas de se livrer à son penchant pour les belles lettres. Il écrivit plusieurs livres, notamment une Lettre héroïque à la duchesse de Longueville sur le retour de M. le prince, et fut l’un des fondateurs de l’Académie de Caen en 1652. Il mourut à Cherbourg en 1662. Il avait épousé en 1643 Madeleine Potier de Courcy, fille du seigneur de Courcy, près de Coutances. De leur union naquirent deux filles et deux garçons.
L’aîné, François, fut élu à l’Académie française en 1689 et se distingua également comme membre du corps diplomatique de Louis XIV. Il fut envoyé en Pologne en 1670 pour appuyer la candidature du duc de Longueville au trône de Pologne, et il fut l’un des trois plénipotentiaires français qui négocièrent le traité de Ryswick en 1697. Il devint par la suite l’un des quatre secrétaires particuliers du roi. En 1701, comme il imitait à merveille l’écriture royale et qu’il possédait parfaitement sa langue, il remplaça Toussaint Rose et devint le secrétaire « qui avait la plume ». Ses fonctions consistaient à épargner au roi temps et fatigue, en rédigeant, d’une écriture semblable à la sienne et dans le style royal, des lettres et des mémoires destinés aux dignitaires et aux chefs d’États étrangers, et à y apposer le paraphe royal. Un tel poste de confiance donnait à Callières un pouvoir dont il usa souvent pour favoriser la carrière de Louis-Hector au Canada.
Ce dernier était entré dans l’armée vers 1664 et avait pris part à plusieurs des campagnes de Louis XIV, mais on ne sait à quel régiment il appartenait : le ministre de la Marine précisa, lorsqu’il le nomma gouverneur de Montréal en remplacement de François-Marie Perrot* en 1684, qu’il avait été capitaine au régiment de Navarre, mais Callière, lui, déclara qu’il avait servi dans le régiment de Piémont. Tout comme son frère, Louis-Hector était doué d’une vive intelligence, et il montra en outre des qualités d’habile négociateur dans ses rapports avec les Indiens. Le gouverneur, Le Febvre* de La Barre, fut vite impressionné par son expérience, sa prudence et son habileté. De caractère peu aimable, il avait, en bon soldat de carrière, le sens de la discipline et l’habitude du commandement, un sentiment fort exagéré de son importance et une humeur maussade que n’allégeaient certes pas de fréquentes crises de goutte.
La guerre avec les Iroquois, qui venait d’éclater, augmentait l’importance du gouvernement de Montréal. À cause de sa situation géographique, la région de Montréal était non seulement la plus vulnérable aux incursions des Iroquois, mais aussi la base militaire où étaient mises sur pied toutes les expéditions contre ces Indiens. par conséquent le gouverneur devait faire fonction de chef militaire, et prendre aussi les mesures nécessaires pour protéger la population civile. Callière prouva bientôt qu’il avait l’énergie et les capacités requises pour assumer toutes ces fonctions, et Brisay de Denonville écrivit à Colbert qu’il était « en ce lieu gouverneur, commissaire, garde magazin, munitionnaire et de tout employ lorsqu’il s’agit du service ». Le gouverneur le considéra vite comme l’officier le plus compétent de la colonie et n’hésita pas à étendre ses responsabilités. Il annexa au gouvernement de Montréal la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent, jusqu’au lac Saint-Pierre, qui relevaient jusque-là du gouvernement de Trois-Rivières. Pour éviter que la discorde ne s’installe si le poste de gouverneur de la Nouvelle-France venait à être vacant par suite de maladie ou de mort, il pria le ministre de la Marine de faire de Callière son second, avec des pouvoirs s’étendant à tout le Canada. Le ministre hésita d’abord mais accéda finalement à cette requête en 1687.
À cette époque la Nouvelle-France avait à faire face au péril iroquois, péril grandissant et qu’il était presque impossible d’enrayer. En 1687, Denonville, secondé par Callière et Rigaud de Vaudreuil, le nouveau commandant, avait envahi le territoire des Tsonnontouans à la tête d’une armée importante. Mais cette expédition n’impressionna nullement les Cinq-Nations, et ne fit que mettre en relief les dangers et les difficultés d’une campagne menée dans des régions sauvages contre un adversaire insaisissable. L’expérience fut salutaire à Denonville et à Callière. Pour anéantir les Iroquois, les deux hommes mirent au point un projet qui ne manquait ni d’originalité ni d’audace. Il s’agissait tout simplement de la prise et de l’occupation de New York. Les mémoires que Callière remit personnellement à Versailles au début de 1689 énuméraient les principaux avantages que les Français retireraient de cette prise de possession : on obtiendrait la soumission des Iroquois qui, privés des armes et des munitions que leur fournissaient les Anglais, seraient bien obligés de traiter avec les Français ; les pêcheries morutières seraient moins exposées —, et la France gagnerait une province fertile, dotée d’un des plus beaux ports d’Amérique. Pour réaliser son projet, le gouverneur de Montréal avait besoin de deux frégates et de 2 000 hommes. Avec cette armée, il prendrait Albany puis continuerait sur New York, qu’il attaquerait par terre pendant que les deux frégates bloqueraient le port et bombarderaient la ville. Louis XIV, après y avoir apporté quelques changements, approuva le projet et décida que Callière serait gouverneur de la province, une fois qu’elle serait conquise. Mais une série de contretemps retarda l’arrivée des frégates au large des côtes d’Amérique du Nord, et il fallut abandonner l’idée.
Callière ne devait guère connaître de répit à son retour au Canada à la fin de 1689. La guerre avait éclaté entre la France et l’Angleterre, et le conflit avec les Cinq-Nations entrait dans une phase nouvelle, marquée de plus de violence encore. Des bandes d’Iroquois rôdaient sur le territoire montréalais, menaçant constamment la vie et les biens des habitants. Mais Callière avait mis la région sur pied de guerre. Montréal avait été entouré d’une palissade, et on avait construit dans chaque seigneurie des redoutes faites de pieux de 14 pieds, où les habitants pourraient trouver refuge en cas d’attaque. Callière avait également fort à faire pour organiser des expéditions à la poursuite des Indiens chaque fois qu’on en signalait sur son territoire. Il lui arrivait de prendre lui-même le commandement des troupes, mais la plupart du temps elles étaient sous les ordres de Vaudreuil ou d’officiers des troupes de la marine rompus à ce genre d’exercice. Buade* de Frontenac, sachant Montréal entre bonnes mains, ne se mêlait que rarement des affaires de cette région et passait le plus clair de son temps à Québec, se concentrant sur l’aspect stratégique de la guerre. En 1694, probablement en partie grâce aux rapports favorables du gouverneur, Callière reçut la croix de Saint-Louis, récompense enviable que Frontenac, lui, n’obtint qu’en 1697.
Callière ne rendait pas entièrement à Frontenac l’estime que ce dernier avait pour lui, car il entretenait des doutes sur la valeur de la stratégie conçue par le gouverneur. À plusieurs reprises Frontenac avait ordonné le cessez-le-feu pour permettre aux envoyés iroquois de se rendre à Québec avec des offres de paix. Callière ne croyait pas que les Indiens souhaitaient sincèrement la fin des hostilités. À son avis, leur but réel était de forcer les Français à l’inaction pour permettre à leurs guerriers de reprendre des forces, et pour amasser de bonnes réserves de fourrures et négocier la paix avec les tribus de l’Ouest, alliées de la Nouvelle-France. Les Iroquois seraient alors en mesure de reprendre le combat avec plus d’acharnement encore. Les événements donnèrent raison à Callière et en 1696 Frontenac décida que l’expédition militaire préconisée par le gouverneur de Montréal ne pouvait être retardée davantage. Le 4 juillet, une armée de plus de 2 000 hommes, comprenant des troupes de la marine, des forces de la milice et un corps auxiliaire composé d’Indiens, quittait Montréal. Vers la fin du mois, elle débarquait sur la rive sud du lac Ontario et marchait sur les Onontagués. Callière, atteint de la goutte, était à la tête des troupes, monté sur un cheval qu’on lui avait amené spécialement de Montréal sur un bateau plat. Frontenac, que l’âge affaiblissait (il avait 74 ans), se faisait porter dans un fauteuil à l’arrière de l’armée. Les troupes ne réussirent pas à rejoindre les Onontagués, mais elles saccagèrent leur territoire et celui des Onneiouts et portèrent un rude coup au moral des Iroquois.
Frontenac mourut le 28 novembre 1698 et Callière fit automatiquement fonction de gouverneur de la Nouvelle-France. Mais Vaudreuil briguait lui aussi le poste. Callière arriva toutefois à devancer son rival. Avec diligence et dans le plus grand secret, il remit sa requête à Augustin Le Gardeur de Courtemanche qui se rendit en France en passant par les colonies anglaises. Le temps ainsi gagné fut un facteur décisif : Courtemanche arriva à Versailles quelques heures avant l’émissaire de Vaudreuil, Charles-Joseph Amiot de Vincelotte, et donna les dépêches de Callière à son frère François, qui les porta à Louis XIV. Lorsque le protecteur de Vaudreuil, Pontchartrain [Phélypeaux], vint annoncer au monarque le décès de Frontenac, il apprit que Sa Majesté était au courant et qu’elle avait accédé à la requête de François de Callières et accordé le poste de gouverneur à son frère.
Pendant ce temps, l’hiver était venu et la colonie était coupée du reste du monde. On n’apprendrait qu’au printemps ce qui s’était passé en France. Mais dans l’intervalle, Callière, qui faisait fonction de gouverneur, ne perdait aucune occasion de bien faire sentir son pouvoir à ses rivaux politiques. Il se conduisit de façon odieuse à l’égard de l’intendant Bochart de Champigny, qui appuyait la cause de Vaudreuil. Il força le Conseil souverain à consigner les lettres de provision comme gouverneur intérimaire, encore que ce fût parfaitement inutile. Enfin, un jour qu’il inspectait les troupes, il insista pour qu’on lui rendît les honneurs réservés aux maréchaux de France. C’en fut trop pour Vaudreuil, Tantouin de La Touche le commissaire de la Marine, et Le Roy de La Potherie le contrôleur. Ils protestèrent avec énergie auprès du ministre. La Potherie se montra particulièrement mordant. Le contrôleur déclara que contrairement à Vaudreuil, qui était « très galand homme », Callière était « dur et insensible » et qu’il n’avait pas su se gagner l’estime de quatre personnes dans toute la colonie. Et, commentait-il avec acidité, il était heureux de voir les Iroquois se tenir tranquilles pour le moment, parce que Callière serait bien incapable de prendre la tête d’une armée, étant « au lit toute l’année accablé de goutte et d’une autre incommodité qui l’empêche de s’asseoir ». Personne ne dut être surpris lorsque Champigny et La Potherie quittèrent la colonie après avoir appris la nomination officielle de Callière.
Callière devenait gouverneur deux ans après que le traité de Ryswick eut mis fin aux hostilités entre l’Angleterre et la France. Il lui fallait maintenant s’atteler à une tâche importante et négocier un traité durable entre les Iroquois, la Nouvelle-France et toutes les tribus indiennes alliées. C’était là une affaire extrêmement complexe. Le gouverneur de New York, Bellomont, soutenait que les Iroquois étaient sujets britanniques et que les conditions du traité de Ryswick leur étaient applicables, il déploya beaucoup d’efforts pour empêcher que leurs négociations avec les Français n’aboutissent. De plus, Callière avait affaire à quelque 30 tribus différentes, dont certaines se faisaient la guerre entre elles, ou combattaient les Iroquois, depuis les temps les plus reculés. Pour arriver à la réconciliation générale dans ces conditions, il fallait être fin diplomate.
Près de trois ans s’écoulèrent avant le règlement de tous ces problèmes. Au début les Iroquois, pour ménager les Anglais, se montrèrent peu disposés à négocier avec les Français. En 1699, trois de leurs envoyés rendirent visite à Callière et tentèrent d’obtenir que les pourparlers aient lieu à Albany. Mais le gouverneur répondit qu’ils ne pourraient avoir lieu qu’à Montréal. À l’occasion de rencontres ultérieures, Callière, pour forcer les Iroquois à envoyer une délégation officielle au Canada, les accabla de sarcasmes, leur répétant les propos de Bellomont qui faisait d’eux des sujets britanniques n’ayant pas le droit de disposer d’eux-mêmes, et il les menaça d’envahir leur territoire s’ils refusaient encore d’entamer les négociations. Dans l’intervalle, les tribus de l’Ouest n’avaient pas cessé leurs attaques contre les Iroquois et c’est ce qui finalement mit fin aux hésitations de ces derniers : ils commencèrent par demander aux Anglais de les protéger contre ces incursions, mais quand ils comprirent qu’ils ne recevraient pas l’aide demandée, il ne leur resta plus qu’à négocier avec les Français.
En juillet 1700, deux chefs onontagués et quatre chefs tsonnontouans arrivèrent dans la colonie et annoncèrent qu’ils désiraient la paix. Ils prièrent Callière de permettre à trois hommes qui jouissaient d’un grand prestige auprès des Iroquois, le père Bruyas, Chabert de Joncaire et Paul Le Moyne de Maricourt, de les accompagner dans leurs cantons pour convaincre les Indiens de signer un traité. Callière y consentit et la mission des trois hommes fut couronnée de succès. Ils revinrent dans la colonie en septembre, accompagnés d’une délégation de 19 Indiens, représentant toutes les nations sauf les Agniers, et de 13 prisonniers français que les Iroquois avaient libérés en témoignage de bonne foi. Ces délégués se réunirent avec ceux des tribus alliées, Abénaquis, Hurons et Outaouais, et l’on s’entendit sur les conditions du traité de paix. Callière annonça alors qu’une grande assemblée aurait lieu l’été suivant, pour échanger tous les prisonniers et ratifier solennellement le traité.
Au début de l’été, les délégués commencèrent d’arriver à Montréal. Quand leurs canots étaient en vue de Montréal, les Indiens levaient leurs pagaies en manière de salut et le canon français les saluait en retour. En juillet, 1 300 Indiens, appartenant à plus de 30 tribus et venus de régions aussi éloignées les unes des autres que la côte Atlantique et le haut Mississipi, étaient réunis et les pourparlers commencèrent. Pendant plusieurs jours les délégations se succédèrent devant Callière avec leurs accusations réciproques et leurs demandes et contre-demandes. Comme on pouvait s’y attendre, la question des prisonniers fut la plus délicate à résoudre : beaucoup étaient morts ou avaient été tués en captivité ; d’autres avaient été adoptés et on ne voulait pas les rendre. Callière arriva à persuader les délégués de le laisser régler toute cette question au meilleur de sa connaissance et c’est là une des preuves les plus édifiantes de ses talents de diplomate. Ces difficultés éliminées, on pouvait commencer à rédiger le traité. Les tribus acceptèrent de vivre en paix et de ne plus contre-attaquer en cas d’incursion ennemie, comme elles le faisaient auparavant, mais de déposer une plainte auprès du gouverneur qui leur obtiendrait réparation. Et, chose fort importante, Callière obtint des Iroquois la promesse de leur neutralité en cas de conflit entre les Anglais et les Français. New York était ainsi privée de sa première ligne d’attaque et de défense et le gouverneur de la Nouvelle-France devenait l’arbitre d’une immense région de l’Amérique du Nord.
En même temps Callière devait faire face aux conséquences des excès commis dans la traite des castors à l’époque de Frontenac. Le marché français en était saturé, et une chute sensible des prix s’ensuivait au Canada. Louis XIV décida de prendre des mesures énergiques pour réduire l’entrée de peaux de castor dans la colonie. Il signa, en mai 1696, un édit qui supprimait les 25 congés de traite, abolissait les principaux postes de l’Ouest et ordonnait aux coureurs de bois de revenir à la civilisation. Callière se rendit tout de suite compte que cette loi risquait de saper le réseau des alliances existant entre la Nouvelle-France et les tribus indiennes. D’une part des prix trop bas pourraient amener les indigènes à commercer avec les Anglais à Albany et, d’autre part, avec l’abolition des postes et des congés, il devenait difficile de garder la main haute sur les tribus alliées, ce qui faciliterait l’infiltration anglaise dans l’Ouest. Le gouverneur tenta d’enrayer les conséquences de la baisse des prix et, manifestant une autorité particulière, il força la Compagnie de la Colonie, qui venait d’être fondée, à vendre ses marchandises aux Indiens à des prix spéciaux. Mais il n’arriva pas à convaincre le ministre de la nécessité de rétablir les postes et les congés.
En dépit de ces difficultés, Callière respecta les ordres du roi et s’efforça d’appliquer la loi interdisant le commerce dans l’Ouest. En 1699, il confisqua des marchandises que deux commerçants de Montréal essayaient de faire parvenir frauduleusement à leurs agents à Michillimakinac. L’année suivante, il mit le commandant du fort Frontenac, La Porte de Louvigny, aux arrêts pour s’être livré au commerce des fourrures contrairement à la loi. Pareille rigueur choqua sans doute une population habituée à plus de laisser-aller avec Frontenac, mais elle donna des résultats appréciables. En 1699 et 1700, Champigny et Callière déclarèrent que les coureurs de bois revenaient dans la colonie au fur et à mesure que, faute d’articles de troc, ils ne pouvaient plus faire la traite. Mais une orientation nouvelle et totalement différente de la politique française dans l’Ouest allait bientôt faire échouer cette tentative de retour à l’ancien système, préconisé par Colbert, d’une colonie peu étendue mais solidement établie.
En 1700 et 1701, Louis XIV décida de consolider son emprise sur l’Amérique du Nord, de la région des Grands Lacs jusqu’au golfe du Mexique, en fondant de nouveaux établissements, à Détroit et dans le bas Mississipi, en Louisiane. La fondation de la Louisiane avait pour cause des rivalités dynastiques en Europe. Le dernier des Habsbourg espagnols, Charles II, mort le 1er novembre 1700, avait légué au petit-fils de Louis XIV, Philippe d’Anjou, toutes ses possessions espagnoles. La fondation d’une colonie, dans le bas Mississipi, permettrait de protéger le Mexique d’une agression éventuelle de la part des colonies anglaises. Louis XIV espérait ainsi montrer à l’Espagne que, sous le règne d’un Bourbon, elle pouvait compter sur l’appui de la France. En ce qui concerne Détroit, d’après les mémoires soumis par Cadillac [Laumet], il semblait, entre autres choses, qu’un poste à cet endroit arrêterait l’expansion anglaise dans la région des Grands Lacs. Grâce à ces deux nouveaux établissements, la France espérait dominer toute le partie de l’Amérique du Nord située à l’ouest des Appalaches et en interdire l’accès aux Anglais.
Callière avait des doutes sérieux sur l’ensemble de cette politique, mais il fut incapable d’y apporter le moindre changement. Encore qu’il jugeât que la fondation d’un poste à Détroit était, dans l’ensemble, une bonne idée, il prévoyait deux « grands empêchements ». D’abord il y avait le risque que les Iroquois, offusqués que l’on établisse un poste sur leur territoire de chasse, ne reprennent la guerre au Canada. Mais le danger le plus sérieux, et que Callière découvrit tout de suite, c’est que l’établissement de Détroit allait attirer les tribus alliées de l’Ouest bien près des cantons iroquois. La proximité favoriserait le commerce, et de là il serait facile d’en venir à des alliances politiques. Si l’on voulait conserver l’Ouest, pensait-il, il était bien plus important de rétablir les anciens postes et les congés. Pontchartrain ne voulut rien entendre et répliqua qu’il fallait s’occuper de Détroit à moins qu’il ne surgisse des « inconvénients invincibles ». Callière céda devant l’insistance du ministre et collabora avec Cadillac afin d’assurer le succès de l’entreprise.
Si Callière s’était contenté de formuler des réserves sur la fondation de Détroit et sur Cadillac, il était par contre résolument hostile à la Louisiane et à son fondateur, Pierre Le Moyne d’Iberville. Détroit, tout en présentant certains risques, demeurait tout de même sous la juridiction du Canada. Mais la Louisiane serait une colonie indépendante, détachée d’un territoire jusque-là sous l’autorité de Québec. Cela ne pouvait déjà qu’irriter Callière. Pour comble de malheur, la nouvelle colonie devint bientôt le repaire des coureurs de bois hors-la-loi et fit concurrence au Canada dans la traite des fourrures à l’intérieur des terres. Furieux, le gouverneur insista auprès de la cour pour que soient prises les mesures nécessaires afin de remédier à une situation qui, disait-il, ruinait sa colonie. Il suggéra que la Louisiane soit placée sous son commandement, qu’on arrête les coureurs de bois, qui s’y étaient réfugiés après avoir contrevenu à la loi au Canada, et qu’on interdise à la Louisiane de se livrer à la traite des peaux de castor, ne lui permettant que le commerce des peaux de bisons et autres animaux du sud du continent. Mais le ministre refusa de placer la Louisiane sous la coupe de Callière, car il était bien plus facile d’y envoyer des instructions directement de France sans avoir à passer par Québec. Il refusa également d’arrêter les coureurs de bois qui avaient fui le Canada, car il comptait sur eux pour la colonisation. Ordre fut donné d’empêcher que la Louisiane ne se livre au commerce du castor et d’enjoindre les coureurs de bois de payer les dettes qu’ils avaient au Canada. Mais on ne fit aucun effort, semble-t-il, pour faire exécuter ces ordres.
Callière, par conséquent, eut peu d’influence sur les décisions concernant l’ouest du continent. Mais il devait jouer un rôle très important dans l’établissement d’une politique stratégique pour la Nouvelle-France au cours de la guerre de Succession d’Espagne. Lorsque le conflit éclata, en 1702, Pontchartrain pressa le gouverneur de conclure une alliance offensive avec les Iroquois et l’autorisa à porter un coup sérieux aux colonies anglaises. Mais Callière n’approuvait pas cette attitude belliqueuse. Il fallait que le budget de la colonie passe de 50 000 à 60 000# pour financer une expédition militaire d’envergure. Quant aux Iroquois, tout ce qu’on pouvait leur demander pour l’instant, c’était de s’en tenir à la neutralité promise en 1701. Des incursions contre les établissements du nord de la région de New York ne pourraient qu’amener les Iroquois à rompre leur pacte avec les Français et à se ranger aux côtés de leurs anciens alliés. Par contre, le gouverneur autorisa les Abénaquis à reprendre les hostilités à la frontière de la Nouvelle-Angleterre, hostilités auxquelles le traité de Ryswick avait mis fin. Les propos qu’il tint à un groupe d’Indiens de cette tribu, venus à Québec en décembre 1702, semblent indiquer que sa stratégie consistait à prouver à ces farouches guerriers qu’une alliance avec la France pouvait être profitable : dans son discours, il informa les délégués qu’avec le butin volé au cours de ces expéditions et les cadeaux qu’ils recevraient des Français ils pourraient vivre plus largement en temps de guerre qu’en temps de paix. Pontchartrain adopta le point de vue de Callière, et la stratégie française en Amérique du Nord pendant toute la durée de la guerre de Succession d’Espagne reposa sur ce double principe : combiner la trêve avec New York et la guerre sur une petite échelle avec la Nouvelle-Angleterre.
Le jour de l’Ascension, au mois de mai 1703, Callière assistait à la grand-messe à la cathédrale de Québec lorsqu’il eut une subite hémorragie et se mit à cracher du sang. On le transporta immédiatement à sa résidence du château Saint-Louis, mais il était évident que la fin approchait. Le 25 mai, le notaire Louis Chambalon était convoqué au chevet du mourant, qui voulait faire son testament. Callière, qui était syndic apostolique des Récollets, demanda à être enterré dans leur chapelle, et il leur laissa la somme de 1 200# pour finir la construction de leur couvent. Il ordonna que sa garde-robe et son argenterie soient partagées entre son secrétaire, Hauteville, son maître d’hôtel, Beaufort, et son valet, Gillet. Comme il n’était pas marié, il légua tous ses biens à son frère François. Le gouverneur, d’une main affaiblie, signa de façon presque illisible le document que lui remit Chambalon. Il mourut le lendemain.
Callière fut un gouverneur respecté et obéi par le peuple, mais peu aimé. Nombreux étaient ceux qui lui reprochaient sa sévérité, son comportement autoritaire et la rigidité avec laquelle il appliquait les ordres du roi. Mais ils le respectaient pour sa probité et la haute idée qu’il se faisait de la fonction publique. Sans aucun doute, il y en eut qui respirèrent plus librement après sa mort, mais ceux qui appréciaient de vivre sous un gouvernement intègre et avisé surent lui rendre hommage. Le père de Charlevoix* déclara que Callière mourut « autant regretté, que le méritoit le Général le plus accompli, qu’eût encore eu cette Colonie, et l’Homme, dont elle avoit reçu de plus importans services ». Dans les annales de l’Hôtel-Dieu de Québec, mère Juchereau de Saint-Ignace écrivit : « le sentiment de tous ceux qui connoissoient sa capacité est que nous ne méritions pas un tel gouverneur ». Ces éloges ne sont pas exagérés. Callière fut un des principaux artisans de la victoire française lors de la deuxième guerre contre les Iroquois. Il fut le diplomate qui négocia la paix de 1701 et le stratège dont la politique militaire fut adoptée pendant tout le temps que dura la guerre de Succession d’Espagne. Jamais, au cours de l’histoire de la colonie, la monarchie française n’eut serviteur plus capable et plus dévoué.
AJQ, Greffe de Louis Chambalon, 25 mai 1703.— AN, Col., B, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 ; Col., C11A, 6–21 ; Col., C11E, 14 ; Col., D2C 21, 49 ; Col., F3, 2, 6, 8.— BN, Cabinet des titres, dossiers bleus, 148.— Charlevoix, Histoire de la N.-F.— Correspondance de Frontenac (1689–1699), RAPQ, 1927–28 : 1–211 ; 1928–29 : 247–384.— Éloge funèbre de feu messire Louis-Hector de Callières, RAPQ, 1921–22 : 226–232.— Juchereau, Annales (Jamet).— La Potherie, Histoire (1753).— Robert Le Blant, Histoire de la Nouvelle-France : les sources narratives du début du XVIIIe siècle et le Recueil de Gédéon de Catalogne (I vol. paru, Dax, [1948]), 270n.— NYCD (O’Callaghan et Fernow), IX, X.— Testament de Louis-Hector de Callières, gouverneur de la Nouvelle-France, RAPQ, 1920–21 (on trouve entre les pages 320 et 321 un fac-similé du testament de Callière).— Eccles, Frontenac ; Canada under Louis XIV.— Giraud, Histoire de la Louisiane française, I.— Lanctot, Histoire du Canada, II— C. Vigen, Notice sur les de Callières de Normandie et leurs rapports avec ceux de Saintonge (Ligugé, dép. de Vienne, s.d.).— Le frère de notre gouverneur de Callières, BRH, XXXIII (1927) : 48–51.— M. Godefroy, Le chevalier de Callières, gouverneur du Canada (1648–1703), Revue catholique de Normandie, VIII (1898–99) : 5–19, 158–170, 228–241, 310–324, 456–469 ; IX (1899–1900) : 5–17.— H. Jouan, À Propos de Jacques-François et Louis-Hector de Callières, Mémoires de la société académique de Cherbourg (1890) : 1–18 ; Les de Callières (Jacques et Louis-Hector) : Un nouveau point douteux d’histoire locale éclairci, Mémoires de la société académique de Cherbourg (1891) : 52s. (Ce texte très court contient un extrait de l’acte de naissance de Louis-Hector de Callière, prouvant bien qu’il était né à Thorigny-sur-Vire, en Normandie, le 12 novembre 1648.)— H. Moulin, Les deux Callières, Jacques et François, Mémoire de l’Académie des belles lettres de Caen (1883) : 136–156,— Benjamin Sulte, La famille de Callières, MSRC, III série, VIII (1890), sect. i : 91–112 ; La signature royale, BRH, XXI (1915) : 75–77.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Yves F. Zoltvany, « CALLIÈRE (Callières), LOUIS-HECTOR DE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/calliere_louis_hector_de_2F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/calliere_louis_hector_de_2F.html |
| Auteur de l'article: | Yves F. Zoltvany |
| Titre de l'article: | CALLIÈRE (Callières), LOUIS-HECTOR DE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1969 |
| Année de la révision: | 1991 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |