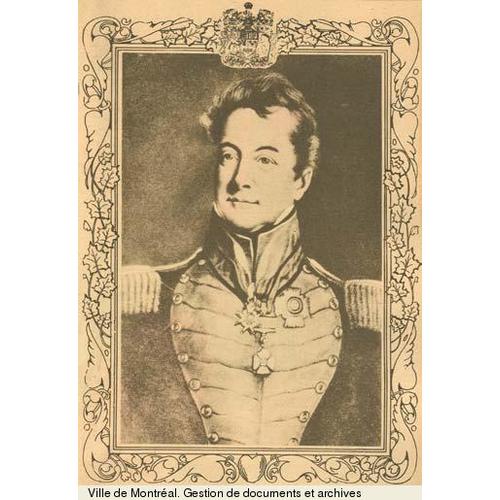Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
WHITWORTH-AYLMER, MATTHEW, 5e baron AYLMER, officier et administrateur colonial, né le 24 mai 1775, aîné des cinq enfants de Henry Aylmer, 4e baron Aylmer, et de Catherine Whitworth ; le 28 juillet ou le 4 août 1801, il épousa Louisa Anne Call, fille de sir John Call, et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 23 février 1850 à Londres.
Matthew Aylmer n’avait que 10 ans lorsqu’il succéda à son père à la vieille baronnie irlandaise d’Aylmer et 12 ans lorsqu’il entra au 49th Foot à titre d’enseigne. Il devint lieutenant en 1791 et capitaine en 1794. Quatre ans plus tard, il participa à un malheureux raid britannique sur Ostende (Belgique), où on le captura ; il passa six mois dans une prison française. Son commandant, le lieutenant-colonel Isaac Brock*, le couvrit d’éloges pour son rôle à la bataille d’Egmont-op-Zee (plus correctement Egmond aan Zee, Pays-Bas) en 1799. Deux ans plus tard, Aylmer accéda au grade de major du 85th Foot, puis en 1802 à celui de lieutenant-colonel. Cependant, on le mit à la demi-solde jusqu’à son entrée dans les Coldstream Foot Guards en juin 1803. Le 25 juillet 1810, il devint colonel et aide de camp du roi ; le 4 juin 1813, major général. Sous-adjudant général puis, à compter de janvier 1812, adjudant général adjoint de l’armée de lord Wellington, il commanda une brigade au cours de plusieurs des grandes batailles de la guerre d’Espagne, durant laquelle il obtint la croix militaire avec agrafe. On lui décerna le titre de chevalier commandeur de l’ordre du Bain le 2 janvier 1815 et celui de chevalier le 6 juin. Nommé adjudant général des troupes britanniques d’Irlande en 1814, il demeura dans ce pays jusqu’en 1823. Sans emploi de 1823 à 1830, il passa une bonne partie de son temps à parcourir la Suisse et l’Italie. Le 27 mai 1825, on le promut lieutenant général, et cette année-là, à la mort de son oncle, le comte de Whitworth, il changea son nom de famille pour celui de Whitworth-Aylmer. Colonel du 56th Foot en 1827, il fut muté au 18th Foot cinq ans plus tard.
L’inactivité forcée d’Aylmer prit fin quand sir James Kempt* démissionna de son poste d’administrateur du Bas-Canada. En juin 1830, le secrétaire d’État aux Colonies, sir George Murray, qui avait aussi servi sous Wellington pendant la guerre d’Espagne, lui offrit la succession. On le nomma commandant des troupes britanniques en Amérique du Nord le 11 août, et il prit la tête du gouvernement le 20 octobre, en débarquant à Québec. Son mandat de gouverneur en chef était daté du 24 novembre 1830 mais ne fut enregistré officiellement à Québec que le 12 février 1831. Aylmer était peu qualifié pour ce poste : sans aucune expérience politique, il n’avait jamais été administrateur civil et, de son propre aveu, « tout ce qui touch[ait] » le Bas-Canada lui était « parfaitement étranger ». Pourtant, Murray ne l’avait pas choisi que par amitié. Aylmer était l’un des officiers de son grade les plus distingués et les plus compétents, il était francophile et, comme le notait Louis-Joseph Papineau*, parlait français « avec la plus grande facilité et élégance ». Bien qu’en politique britannique il ait penché du côté des conservateurs, ce n’était pas un homme de parti, et les réformistes du Bas et du Haut-Canada, rassurés par leurs alliés en Grande-Bretagne, l’accueillirent comme « un homme intelligent et capable, d’un naturel conciliant, libéral dans ses principes et sincèrement disposé à bien agir ».
Aylmer admettait ses lacunes mais prédisait que bientôt il ne ferait « plus partie des bleus ». Il entreprit une série de tournées qui le menèrent finalement dans toutes les régions du Bas-Canada et se déclara enchanté par « le pays, la population et le climat ». Lady Aylmer et lui prenaient au sérieux leurs responsabilités vice-royales. Divers organismes, dont une fondation d’aide aux immigrants, le Female Orphan Asylum et le Quebec Driving Club (l’une des nombreuses sociétés que lady Aylmer prit sous son aile), bénéficièrent de leur générosité. Ils veillaient à promouvoir les arts et la culture et assistaient à de nombreuses activités communautaires : concours de labour ou courses annuelles à Trois-Rivières, où Aylmer offrit une coupe d’argent pour un cheval élevé dans la province. Riche, il donnait souvent de somptueuses réceptions au château Saint-Louis, résidence du gouverneur. Cependant, notait le Vindicator and Canadian Advertiser, journal réformiste montréalais, il évitait l’erreur « dans laquelle la plupart [des] gouverneurs [de la province étaient] tombés », c’est-à-dire de « tenter de faire croire aux « autochtones » que venir d’outre-Atlantique conf[érait] quelque supériorité ». À l’occasion d’une visite à la réserve indienne du lac des Deux Montagnes, il se laissa convaincre de se joindre à la danse.
Aylmer souhaitait particulièrement persuader les Canadiens français de ses bonnes intentions. Peu après son arrivée, il donna de l’argent pour marquer d’une plaque l’endroit « où repos[aient] les restes du brave Montcalm [Louis-Joseph de Montcalm*] ». Les partisans de l’assimilation le hérissaient. Selon lui, il n’y avait pas de sujets britanniques « plus loyaux et fidèles que les habitants du Bas-Canada » ; les assimiler affaiblirait leur loyauté et les jetterait dans les bras des États-Unis. Il défendait le régime seigneurial et demandait l’autorisation de concéder, à des Canadiens français qui n’avaient pas les moyens d’acheter des terres en franche-tenure, des parties de seigneuries que gérait la couronne. Son désir de répartir avec la plus grande impartialité les postes gouvernementaux était sincère : il réintégra des officiers de milice qu’un de ses prédécesseurs, lord Dalhousie [Ramsay], avait démis pour opposition à l’administration, augmenta le nombre de juges canadiens, distribua équitablement entre francophones et anglophones les commissions de juge de paix, et 8 des 14 premiers conseillers législatifs qu’il nomma étaient des Canadiens français. En 1831, pour démontrer qu’il était « libre de toute attache partisane », il offrit aux chefs du parti patriote, Papineau et John Neilson, d’entrer au Conseil exécutif. Tous deux refusèrent, mais les députés réformistes francophones Philippe Panet*, Dominique Mondelet* et Hugues Heney acceptèrent l’un après l’autre une offre identique. De toute évidence, il fut trop timide : les Conseils législatif et exécutif, comme les échelons supérieurs de la fonction publique, étaient toujours dominés par des anglophones réfractaires aux exigences de l’Assemblée. Néanmoins, il alla aussi loin, et parfois plus loin, que ses supérieurs londoniens ne le voulaient et, du moins au début, convainquit Papineau qu’« il aim[ait] et [voulait] le bien de la province ».
Pendant le mandat d’Aylmer, le Parlement se réunit pour la première fois en janvier 1831. Pris d’« une grave indisposition », ce fut « littéralement de [son] lit » qu’il dut prononcer le discours du trône. Tout au long de la session, il s’occupa avec diligence des griefs de l’Assemblée, dont un bon nombre, il l’admettait, étaient « fondés ». Il appliqua de nouvelles mesures d’économie dans la fonction publique, présenta à l’Assemblée presque tous les documents de l’exécutif qu’elle demandait, protesta auprès du gouvernement britannique contre les retards mis à étudier les lois coloniales dont la sanction avait été réservée, refusa d’alléger des règlements pour accommoder les parties intéressées, exigea un resserrement des normes de comptabilité des fonds publics, ouvrit une enquête sur les abus du régime de concession des terres et invita les juges (à l’exception du juge en chef Jonathan Sewell) à ne pas assister aux réunions du Conseil législatif pendant que le ministère des Colonies délibérait sur une vieille requête en faveur de leur exclusion de cet organisme. En prorogeant le Parlement, en mars, il s’inquiéta de savoir si l’Assemblée n’avait pas négligé « quelque plainte isolée ».
À la fin de la session, l’Assemblée réclama la démission du procureur général James Stuart*, virulent adversaire du parti patriote : c’est en cette occasion qu’Aylmer fit sa tentative d’apaisement la plus controversée. Le 9 septembre 1831, cédant aux pressions de l’Assemblée, il suspendit Stuart en attendant que les accusations qu’elle avait portées contre lui aient été examinées en Grande-Bretagne. Réprimandé par le ministère des Colonies pour avoir suspendu Stuart avant qu’il n’ait eu l’occasion de se défendre devant l’Assemblée, Aylmer souligna avec raison qu’en n’agissant pas il aurait provoqué « une effervescence et une agitation extrêmes ». En novembre 1832, le ministère des Colonies renvoya Stuart, qui provoqua Aylmer en duel, sans succès. Ceux qui, parmi la minorité britannique de la colonie, croyaient qu’Aylmer « n’os[ait] pas déplaire au citoyen Papineau, qui [...] le [tenait] entièrement sous sa coupe », firent de Stuart un martyr. Cependant, par son attitude dans cette affaire, Aylmer devint encore plus populaire auprès des réformistes, et surtout de Papineau, qui l’avait reçu avec lady Aylmer à sa maison de campagne en juin 1831. Mais, bien qu’il ait été « en bons (et même en très bons) termes » avec Papineau, Aylmer savait qu’un profond désaccord les séparait sur nombre de questions.
Depuis plus d’une décennie, l’Assemblée cherchait avant tout à s’assurer la mainmise sur les revenus de la province, y compris ceux que la loi de Québec sur le revenu avait réservés en 1774 à la couronne [V. sir Francis Nathaniel Burton*]. À la demande du successeur whig de Murray aux Colonies, lord Goderich, Aylmer soumit des prévisions de dépenses réduites à la chambre et lui réclama une liste civile permanente en guise de préalable à une reddition des revenus de la couronne. L’Assemblée porta peu d’attention aux prévisions de Goderich et n’étudia pas sa demande de liste civile, mais elle adopta tout de même des crédits pour un an. Pendant l’été de 1831, contre l’avis d’Aylmer et sous l’influence de son sous-secrétaire parlementaire, lord Howick, Goderich déposa au Parlement britannique un projet de loi qui cédait inconditionnellement les revenus de la couronne. Puis, en septembre, il ordonna à Aylmer de convoquer l’Assemblée pour redemander une liste civile relativement modeste. L’Assemblée refusa de pourvoir aux salaires de plusieurs des fonctionnaires inscrits sur la liste de Goderich. Sur ce, Aylmer eut la sottise de tenter de l’y contraindre en laissant entendre qu’il réserverait la sanction de tout projet de loi non conforme aux intentions de Goderich. L’Assemblée répliqua en refusant un salaire permanent à tous les fonctionnaires. Peut-être les propositions de Goderich, qui ne recueillirent que 9 voix sur 51, n’auraient-elles pas eu l’aval de l’Assemblée même si Aylmer s’était montré plus subtil. Déçu, il clôtura la session, en reconnaissant que ses relations avec les chefs du parti patriote s’étaient grandement refroidies.
Un autre événement allait élargir le fossé qui les séparait : le 21 mai 1832, au cours d’une orageuse élection partielle dans Montréal, des soldats britanniques tuèrent trois Canadiens français [V. Daniel Tracey*]. Aylmer écrivit à Papineau pour lui exprimer ses regrets, mais il ne désapprouva pas le comportement des soldats. Il refusa d’intervenir dans les poursuites judiciaires qui suivirent le drame, même lorsque le chef patriote réclama une enquête militaire. Il encouragea le solliciteur général Charles Richard Ogden* à porter l’affaire devant un jury d’accusation mais, par la suite, félicita publiquement le jury d’avoir exonéré les soldats de tout blâme. Dès lors, Papineau refusa ouvertement d’assister aux réceptions du château Saint-Louis.
L’épidémie de choléra qui fit plus de 7 000 victimes dans la colonie en 1832 attisa la colère du parti patriote. En prévision de cette tragédie, Aylmer avait convaincu le Parlement de mettre sur pied une station de quarantaine à la Grosse Île et un bureau de santé à Québec, et d’autoriser l’établissement d’installations semblables ailleurs quand elles seraient nécessaires. Il appliqua consciencieusement les règlements de quarantaine et subventionna les bureaux de santé et la Montreal Emigrant Society, mais ces mesures se révélèrent tout à fait insuffisantes. De plus, en insistant pour que seuls les légistes de la couronne intentent des poursuites, il nuisit au travail des bureaux de santé et, en encourageant les gens à fuir pour réduire l’incidence du choléra dans les villes, il contribua à la diffusion de la maladie. Tout compte fait cependant, il ne méritait pas le blâme de l’Assemblée, qui lui reprocha aussi de distribuer des fonds sans son approbation et de ne pas réduire l’afflux des immigrants. En fait, Aylmer souhaitait limiter l’immigration et proposa d’imposer une taxe sur les immigrants pour recueillir de l’argent. Quand l’Assemblée se réunit, en novembre 1832, elle n’était pas d’humeur à concéder quoi que ce soit : elle déclara le siège de Dominique Mondelet vacant lorsque celui-ci entra au Conseil exécutif, vota un projet de loi de subsides qui ne pourvoyait pas à une liste civile et que le Conseil législatif se sentit tenu de rejeter, et adopta une adresse semblable à celle qu’elle avait refusée à la session précédente et qui réclamait un Conseil législatif électif.
Aylmer, qui voyait là des preuves d’intransigeance, demanda à Londres l’autorisation d’utiliser les fonds non alloués que le Revenue Act de Goderich avait cédés en 1831 au Parlement colonial. Même s’il comprenait la difficulté de la situation, Edward George Geoffrey Smith Stanley, futur lord Stanley, qui remplaça Goderich au ministère des Colonies en avril 1833, refusa d’agir avant que l’Assemblée n’ait eu l’occasion de reconsidérer ses décisions. En convoquant de nouveau le Parlement en janvier 1834, Aylmer allait donc presque certainement provoquer un affrontement. Il ne consentit pas à accorder à l’Assemblée £7 000 de fonds de réserve, réserva la sanction de 11 des 12 projets de loi adoptés par le Parlement et refusa de sanctionner le douzième. En retour, l’Assemblée refusa d’adopter une loi de subsides et présenta une liste de 92 griefs qui réclamait notamment le rappel du gouverneur. Affirmant que les Quatre-vingt-douze Résolutions équivalaient à une « Déclaration d’indépendance », Aylmer envoya à Stanley un avant-projet de loi qui permettrait au gouvernement de reprendre en main les revenus de la couronne cédés à l’Assemblée en vertu du Revenue Act de lord Goderich. Stanley était disposé à abroger la loi de Goderich et soumit donc les Quatre-vingt-douze Résolutions à un comité spécial de la chambre des Communes qui, croyait-il, blanchirait Aylmer. Toutefois, il fut remplacé en juin 1834 par un whig irlandais, Thomas Spring-Rice, qui, allergique aux querelles, convainquit le comité des Communes d’attribuer le conflit bas-canadien à des « incompréhensions mutuelles ». Après avoir rencontré des délégués de l’Assemblée, Spring-Rice autorisa Aylmer, en septembre, à emprunter £31 000 à la caisse militaire pour verser des salaires impayés, en prenant pour acquis (ce en quoi il se trompait) que l’Assemblée accepterait de rembourser l’emprunt. Les actions de Spring-Rice et le fait que le comité spécial ne défendit pas sa propre conduite consternèrent Aylmer.
Ironiquement, Aylmer avait amené le ministère des Colonies à s’assouplir en faisant valoir que les radicaux de l’Assemblée perdaient des appuis. Pendant les sessions de 1833 et de 1834, une scission était apparue au sein du parti patriote, et Aylmer tentait de l’exploiter, surtout en courtisant la hiérarchie de l’Église catholique, qui s’opposait aux politiques des radicaux. Bien qu’il ait été un anglican convaincu, Aylmer était d’une rare tolérance religieuse. Il souhaitait modifier le serment imposé aux juges de paix afin de pouvoir nommer des juifs [V. Aaron Ezekiel Hart*]. Il assistait aux offices religieux aussi bien à la cathédrale catholique que dans la sienne et refusait d’aller aux offices d’un prêtre anglican de la ville qui avait protesté parce qu’il apportait une aide financière à l’Église catholique. Il offrit aux ursulines de Québec de se réfugier au château Saint-Louis quand un incendie frappa leur couvent, recommanda que l’évêque catholique soit nommé au Conseil exécutif et découragea le ministère des Colonies de s’ingérer dans la question des biens des sulpiciens. Cultiver l’Église n’était d’ailleurs pas le seul élément de sa stratégie : il choisissait délibérément ses candidats à des postes gouvernementaux parmi les membres les plus conservateurs et les plus « respectables » du parti patriote.
Cependant, les nominations d’Aylmer éclaircissaient les rangs des députés modérés puisque les nouveaux titulaires perdaient leur siège. De toute façon, lui-même n’était pas en mesure de multiplier le nombre des « vendus ». Progressivement déçu par ce qu’il considérait être de l’ignorance et de l’ingratitude de la part des Canadiens français, il se mit dès septembre 1832 à prétendre que « l’influence britannique au Bas-Canada [... devait] dominer sous peu » et que les Canadiens français devaient « finir par accepter un sort qui ne [pouvait] être conjuré ». En octobre, il servit cet avertissement à sir John Colborne*, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada : « quand on donne aux sujets du roi le nom d’étrangers et parle des Canadiens comme d’une nation tenue dans la servitude par une autre nation, il convient que les autorités constituées se tiennent sur leurs gardes ». Dès le printemps de 1834, il était convaincu que, tant que l’Assemblée compterait un fort nombre de Canadiens français, « la constitution de la province [...] ne fonctionnera[it] jamais bien ». Après l’adoption des Quatre-vingt-douze Résolutions, il tenta surtout de se concilier les Américains d’origine qui peuplaient les Cantons-de-l’Est ainsi que les communautés irlandaises de plus en plus nombreuses à Montréal et à Québec en confiant des postes d’importance à certains de leurs représentants. En juin 1835, en dépit de la véhémente opposition de l’Assemblée, il appuya fermement « une association de gentlemen » des Cantons-de-l’Est qui voulait obtenir, pour l’achat d’une grande superficie de terres, des conditions semblables à celles dont bénéficiait la British American Land Company [V. sir Alexander Tilloch Galt*].
En fait, Aylmer s’était peu à peu soumis à l’influence des fonctionnaires depuis longtemps en place. En avril 1834, il nomma l’un des protégés de Dalhousie, David Chisholme, coroner de Trois-Rivières. Lorsque John Fletcher dut refuser une promotion de juge offerte en compensation des « années de persécution » que lui avait fait subir la chambre d’Assemblée, Aylmer recommanda de nommer plutôt Samuel Gale*, qui avait été l’agent de Dalhousie en Angleterre en 1828 et l’avocat des officiers en devoir au moment du « massacre » de Montréal. Cette recommandation souleva une vive opposition au ministère des Colonies, qui céda cependant à Aylmer en exigeant que le prochain poste vacant aille à un Canadien français.
La nomination de Gale choqua bien des modérés, dans les deux camps. Aylmer se rendit encore plus impopulaire en refusant de verser de l’argent à Montréal à l’occasion d’une deuxième épidémie de choléra en 1834 et en se retirant, au plus fort de l’épidémie, à la maison de campagne réservée au gouverneur à William Henry (Sorel). Aux élections qui se tinrent à la fin de cette année-là, les radicaux remportèrent une écrasante victoire et éliminèrent presque les modérés de l’Assemblée. Ce résultat ne déplut pas à Aylmer, car il avait « éveillé dans la population britannique un sentiment (jusque[-là] latent) » qui, toutefois, risquait d’« avoir de très graves répercussions s’il n’[était] pas utilisé avec prudence ». Il accueillit avec enthousiasme la formation, à Québec et à Montréal, d’associations militantes de défense de la constitution et fit valoir que la minorité britannique ne tolérerait plus la domination de l’Assemblée. Selon lui, la victoire des patriotes découlait de « la complaisance avec laquelle le comité sur le Canada [de 1834] a[vait] écouté des griefs factices » ; la nouvelle Assemblée, prédisait-il, serait moins raisonnable que la précédente. Quand l’Assemblée se réunit, en février 1835, il fit de cette prédiction une réalité en refusant de lui allouer des fonds de réserve. La chambre répliqua en refusant encore de voter les subsides et se plaignit qu’Aylmer avait des préjugés contre les Canadiens français. Le 18 mars, Aylmer prorogea le Parlement et demanda à la Grande-Bretagne de trouver une solution à l’impasse constitutionnelle et financière.
Remplacer Aylmer fut la solution qu’adopta le ministère des Colonies. Spring-Rice avait commencé à lui chercher un successeur à l’automne de 1834 et lui avait promis un autre poste de gouverneur s’il démissionnait. Aylmer, cependant, voulait être disculpé, et il suggéra de faire venir une commission parlementaire pour examiner les accusations de l’Assemblée. En avril 1835, on nomma une commission de trois membres, mais son président, lord Gosford [Acheson], allait aussi devenir le successeur d’Aylmer. Celui-ci accueillit sa destitution avec d’autant plus d’amertume que Gosford, qui prit la tête du gouvernement le 24 août 1835, se dissocia de lui. Son terrible voyage de retour, raconté par lady Aylmer dans Narrative of the passage of the Pique across the Atlantic paru à Londres en 1837, ne fut pas de nature à le rasséréner. Une fois en Angleterre, il exigea, pour accepter le commandement des troupes d’Irlande, que les autorités approuvent d’abord sa conduite, mais en vain. Au moins parvint-il à forcer le gouvernement à lui décerner la grand-croix de l’ordre du Bain le 10 septembre 1836 ; le 23 novembre 1841, il devint général. Cependant, il n’obtint jamais une pairie anglaise, même s’il estimait y avoir droit, ni un autre poste administratif. Le 23 février 1850, il mourut d’un anévrisme cardiaque dans sa maison de Londres.
En quittant la colonie, Matthew Whitworth-Aylmer avait déploré que ses « ardents efforts pour promouvoir le bien-être général du Bas-Canada aient produit des résultats si inférieurs » à ses attentes ; il éclata en sanglots quand la petite foule réunie au quai pour lui faire ses adieux l’acclama. En vérité, Aylmer fut un personnage tragique. Il était bien intentionné et aussi compétent que la plupart des militaires qui gouvernèrent l’Amérique du Nord britannique après les guerres napoléoniennes. Mais le Bas-Canada avait besoin, comme gouverneur, d’un habile politique, et non de celui qui avait noté, en octobre 1831 : « Ici, je ne puis demander conseil ni trouver d’appuis en dehors du cercle de ma famille, qui se compose de soldats comme moi ; et de [... l’autre] côté de l’océan, je n’ai absolument aucune relation dans le monde politique. » Plutôt mal préparé à sa tâche, il s’était trouvé « obligé de se mesurer en même temps à ceux qui [avaient] consacré leur vie à l’étude du droit et à la politique ». Selon le Vindicator and Canadian Advertiser, il avait « gagné, dans l’histoire du Canada, une place à côté des Craig [sir James Henry Craig*] et des Dalhousie et s’[était] attiré la haine d’un demi-million de personnes ». Les whigs lui attribuaient l’échec de leur politique de conciliation, et les historiens qui penchent de leur côté, Helen Taft Manning par exemple, ont renouvelé ce reproche. Pourtant, malgré ses nombreuses erreurs de jugement, Aylmer a souvent été critiqué à tort. Nombre de ses bourdes, comme le note l’historien Fernand Ouellet, furent « plus ou moins provoquées ». Il ne devint jamais un aussi violent francophobe que Craig ou Dalhousie, ne perdit jamais son sang-froid en public, ne ferma jamais les portes du château Saint-Louis à ses opposants. Certes, il contribua à la polarisation des ethnies du Bas-Canada, mais il n’en fut pas responsable, et il n’aurait pas davantage pu l’empêcher que Gosford, qui était un civil doté d’une expérience politique considérable. De plus, Aylmer souffrit des nombreux changements de gouvernement que la Grande-Bretagne connut au début des années 1830 : il servit sous cinq secrétaires d’État dont les vues sur le Bas-Canada différaient considérablement. Privé de « relations dans le monde politique » britannique, il fut sacrifié au nom de la bonne entente avec l’Assemblée bas-canadienne. Ironie du sort, ce sacrifice fut vain, car à ce moment les rébellions de 1837–1838 étaient probablement devenues inévitables.
APC, MG 24, A43 ; F66, 1 ; RG 1, E1, 40–41 ; RG 68, General index, 1651–1841 : 72.— PRO, CO 42/230–257 ; 43/28–30 ; 387/1–11.— B.-C., chambre d’Assemblée, Journaux, 1830–1835.— L. A. [Call Whitworth-Aylmer, baronne] Aylmer, Narrative of the passage of the Pique across the Atlantic (Londres, 1837) ; « Recollections of Canada, 1831 », ANQ Rapport, 1934–1935 : 279–318.— Montreal Herald, 8 sept. 1832, 18, 23 août, 2 oct. 1834, 8 janv., 9 févr. 1835.— Quebec Gazette, 13, 17, 24 janv., 19, 24 févr., 5 mars, 9, 21 avril, 20 juin, 29 août 1834, 2 janv., 23 févr., 26 juin, 10 août, 9, 16 sept. 1835, 30 mars 1850.— Times (Londres), 26 févr. 1850.— Vindicator and Canadian Advertiser, 19 oct., 26, 30 nov., 21, 24 déc. 1830, 1er févr., 24, 28 juin, 1er juill., 27 déc. 1831, 3, 7 févr., 2 mars 1832, 21 mars, 12 mai, 23 juin 1835.— Burke’s peerage (1890), 73.— G.-B., WO, Army list, 1788–1850.— Geoffrey Bilson, A darkened house : cholera in nineteenth-century Canada (Toronto, 1980).— Ouellet, Lower Canada.— Rumilly, Papineau et son temps, 1.— Taft Manning, Revolt of French Canada.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Phillip Buckner, « WHITWORTH-AYLMER, MATTHEW, 5e baron AYLMER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/whitworth_aylmer_matthew_7F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/whitworth_aylmer_matthew_7F.html |
| Auteur de l'article: | Phillip Buckner |
| Titre de l'article: | WHITWORTH-AYLMER, MATTHEW, 5e baron AYLMER |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1988 |
| Année de la révision: | 1988 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |