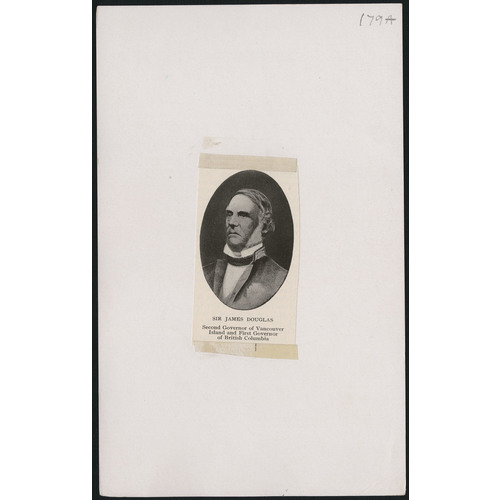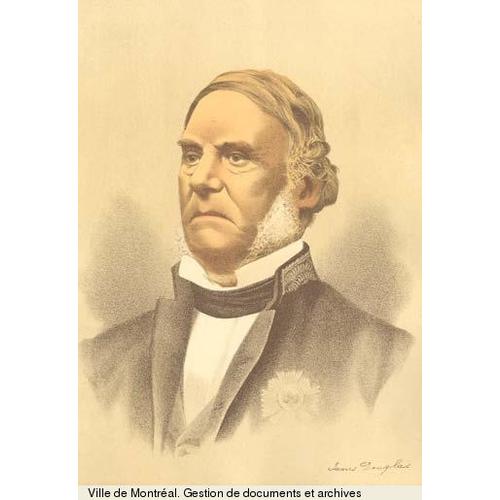Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
DOUGLAS, sir JAMES, administrateur de la Hudson’s Bay Company et gouverneur de l’Île-de-Vancouver et de la colonie royale de Colombie-Britannique, né le 5 juin ou le 15 août 1803, décédé à Victoria, en Colombie-Britannique le 2 août 1877.
« Un Écossais des Antilles », voilà comment on avait surnommé James Douglas dans les milieux du commerce des fourrures ; il était le fils de John Douglas et le neveu du lieutenant général sir Neill Douglas. John Douglas et ses trois frères, négociants de Glasgow, avaient des intérêts en Guyane britannique dans les plantations de canne à sucre. Il semble qu’à Demerara, John Douglas ait eu une liaison avec une Créole, probablement du nom de Mlle Ritchie, dont il eut trois enfants : Alexander, en 1801 ou 1802 ; James, en 1803 ; et Cecilia Eliza, en 1812. John Douglas eut d’autres enfants de son mariage avec Jessie Hamilton, qui eut lieu à Glasgow en 1809. Une véritable affection liait James et l’une des filles de ce mariage, Jane Hamilton Douglas.
James Douglas, qui fut envoyé très jeune dans une école préparatoire d’Écosse, apprit « à se battre pour survivre au milieu de garçons de toutes sortes et à faire son chemin à coups de cravache et d’éperons ». Il reçut une bonne instruction à Lanark et poursuivit sans doute ses études avec un précepteur français et huguenot à Chester, en Angleterre. Dans les premières années qu’il passa à faire la traite des fourrures, il se fit remarquer par sa bonne connaissance du français et « sa diction claire et précise ».
À l’âge de 16 ans, Alexander et James Douglas devinrent tous deux apprentis de la North West Company. James Douglas avait quitté Liverpool le 7 mai 1819 à bord du Matthews, un brick qui faisait voile vers Québec ; il poursuivit sa route jusqu’au fort William, où il arriva le 6 août. Il consacra l’hiver suivant à se familiariser avec la comptabilité et les méthodes commerciales ainsi qu’à étudier le caractère des Indiens. Sans doute, manifestait-il déjà les qualités qui le firent apprécier par la suite : il était travailleur, ponctuel, attentif aux moindres détails et bien déterminé, quelle que fût l’urgence de son travail, à acquérir des connaissances dans le domaine de la littérature, de l’histoire, de la politique et de l’administration publique.
Au cours de l’été de 1820, il fut transféré à l’Île-à-la-Crosse. Il se donna corps et âme à la lutte qui mettait aux prises les hommes de la North West Company et ceux de la Hudson’s Bay Company, allant jusqu’à se battre en duel avec Patrick Cunningham et à organiser des manoeuvres militaires et des manifestations d’intimidation. Il fut l’un des quatre Nor’Westers que l’on avertit personnellement, le 12 avril 1821, de cesser de parader à portée de fusil du poste de la Hudson’s Bay Company avec « fusils, épées, drapeaux, fifres, tambours, etc., etc. »
Lors de la fusion des deux compagnies en 1821, Douglas entra au service de la Hudson’s Bay Company comme commis de deuxième classe. En 1822, bien qu’âgé de 18 ans seulement, on le considérait comme « un jeune homme très sérieux » et comme un excellent trafiquant avec les Indiens. On put donc lui confier, cet été-là, la responsabilité du poste d’Island Lake.
Le 15 avril 1825, Douglas quitta l’Île-à-la-Crosse et se rendit, en passant par le lac Athabasca, au fort Vermilion, dans la région de la rivière de la Paix, afin d’en prendre la direction pendant l’été. Il passa l’hiver au lac McLeod, à l’est des Rocheuses, avec John Tod*. Au printemps suivant, il se trouvait au fort St James, sur le lac Stuart, poste principal du district de New Caledonia. Douglas avait ainsi accompli la première de ses sept traversées des montagnes Rocheuses ; il devait garder de cette aventure un souvenir indélébile : « paysages nouveaux, voyage périlleux, épuisement, émotions fortes, aventures dans la montagne et lors des inondations ».
C’est au cours de ce printemps de 1826 qu’il vit la côte du Pacifique pour la première fois. On avait décidé d’approvisionner New Caledonia à partir de Fort Vancouver, construit en 1824 sur la rive nord du fleuve Columbia, et d’expédier en Angleterre les marchandises qui en arriveraient, en contournant le cap Horn. L’agent principal, William Connolly*, qui considérait Douglas comme « un commis et un trafiquant équilibré, actif et bien fait pour s’adapter à un pays nouveau », le choisit pour l’aider à ouvrir une route à travers les terres. Cette route devait permettre aux brigades de se rendre avec leurs chevaux de somme du fort Alexandria, sur le cours supérieur du Fraser au fort Okanagan, à la jonction de la rivière Okanagan et du fleuve Columbia. La brigade quitta le lac Stuart le S mai et, après un voyage de 1 000 milles, arriva à Fort Vancouver le 16 juin. Connolly, avec neuf bateaux bien chargés, prit le chemin du retour le 5 juillet. Douglas, qui avait été envoyé avec John Work* et Archibald McDonald* chez les Nez-Percés, afin de se procurer des chevaux, le rejoignit au fort Okanagan. Ils étaient de retour au fort St James le 23 septembre. En octobre, on envoya Douglas faire la traite avec les Sèkkanais ; après s’être acquitté avec succès de sa mission, il fut chargé le 15 mai 1827 d’aller fonder le fort Connolly sur le lac de l’Ours.
Au cours de l’hiver de 1827, au fort St James, Douglas décida d’abandonner la traite des fourrures à l’expiration de son contrat de trois ans. En mars 1828, découragé par l’isolement qu’accentuait le manque de compagnons et de bons livres, par l’hostilité des Indiens et par le danger de mourir de faim – le saumon n’avait pas remonté les rivières cette année-là –, il était « bien décidé de quitter le pays ». Ses employeurs, eux, étaient prêts à renouveler son contrat et à augmenter son traitement de £60 à £100.
Le 27 avril, Douglas prit pour femme selon la coutume du pays (ce mariage fut consacré plus tard par l’Église d’Angleterre, à Fort Vancouver, en 1837) la fille de l’agent principal et d’une Indienne, Amelia Connolly. Connolly laissa Douglas en charge du fort St James, et porta lui-même à Fort Vancouver les recettes pour 1828 à destination de l’Angleterre. Un « violent incident » avec les Indiens éclata alors. À la suite de l’exécution d’un Indien qui avait participé à un assassinat au fort George en 1823, des Porteurs envahirent le fort, décidés à venger sa mort et menaçant la vie de Douglas. Ce dernier pouvait être « furieusement violent, si on le provoquait », et les Indiens le détestaient. En novembre, il fut une fois encore attaqué près du lac Fraser, et il y eut de nouveaux troubles au fort St James, le 1er janvier 1829. « La vie de Douglas est en danger au milieu de ces Porteurs », fit remarquer Connolly au gouverneur George Simpson* en février 1829. « Il ne craint pas de faire face à une centaine d’entre eux, mais la perspective de se faire assassiner ne lui sourit guère. »
Le Conseil du département de Northern suivit la recommandation de Connolly, qui conseillait de transférer Douglas à Fort Vancouver où l’on avait entrepris sur le littoral d’importantes réalisations dans les domaines de l’agriculture et du commerce. Le 30 janvier 1830, Douglas quitta le lac Stuart et devint comptable sous les ordres du médecin John McLoughlin*, surintendant du vaste département de Columbia.
« James Douglas est à Vancouver, et il y est fort bien vu » rapporte un trafiquant de fourrures en 1831. Simpson, qui avait eu l’occasion de voir Douglas à l’Île-à-la-Crosse en 1822 et au fort St James en 1828, était persuadé que Douglas était « tout désigné pour prendre place, dans quelque temps, [au] conseil d’administration ». McLoughlin lui confia, en 1832 et en 1833, la mission de tenir les écritures à York Factory. Devenu le principal adjoint de McLoughlin, il assista, en 1835, à la réunion du conseil dans la colonie de la Rivière-Rouge. C’est là que, le 3 juin, il reçut sa commission de chef de poste. En l’absence de McLoughlin, qui était en Angleterre en 1838–1839, Douglas fut responsable de Fort Vancouver, des postes du littoral, des expéditions de trappeurs et de l’envoi des marchandises par bateau. Finalement, en novembre 1839, il fut promu agent principal.
Cet avancement permit à Douglas de connaître l’aisance matérielle. Comme chef de poste, il avait reçu 1/85 des bénéfices nets de la compagnie, environ £400 par an. Une fois agent principal, il avait droit à 2/85 des bénéfices. Douglas, qui n’avait que son traitement pour vivre, savait se montrer économe. Lorsqu’il était jeune commis et ne gagnait que £60 par an, il avait mis de côté la moitié de cette somme. En 1835, alors qu’il avait reçu £406 à titre de chef de poste, il s’arrangea pour ne pas dépenser beaucoup plus de £30. Cette année-là, il commença de subvenir aux besoins de sa sœur Cecilia, et de donner son obole à la Bible Society et aux missions chrétiennes de l’Oregon. Au printemps de 1850, ses économies s’élevaient à près de £5 000.
Durant l’absence de McLoughlin, Douglas était responsable du poste principal du district de Columbia, et il chercha à y exercer une influence morale. L’esclavage le préoccupait : « J’ai toujours essayé de décourager les Indiens de cette pratique en ne faisant appel qu’à la morale, précisa-t-il à la compagnie, à Londres. Auprès des nôtres, j’ai joué un rôle plus actif et j’ai dénoncé l’esclavage comme une institution contraire à la loi. J’ai essayé de protéger le mieux possible les droits naturels de tous les infortunés qui étaient esclaves de sujets britanniques. » En 1849, il racheta un esclave, afin de le libérer, pour 14 shillings de marchandises. Il estimait que le progrès moral et religieux « de [leur] petite communauté » relevait du pasteur anglican du fort, mais il retira son appui au révérend Herbert Beaver quand il découvrit en lui un véritable fanatique. « Dans ce pays, un ministre du culte ne doit pas se claustrer ; il doit agir avec bienveillance et s’attacher à défendre les principes plutôt que les apparences ; il doit éviter la discorde, ne pas manquer à la charité, tempérer son zèle de modération, [et] donner l’exemple de ce qu’il prêche. » Ces règles de conduite étaient d’ailleurs devenues les siennes.
Au cours de cette période, alors que McLoughlin s’efforçait d’éliminer la concurrence américaine sur la côte nord-ouest et que Simpson étendait les activités de la compagnie à toute la région du Pacifique, on considéra Douglas comme le plus qualifié pour exécuter les missions importantes. En avril 1840, on l’envoya dans le Nord, à Sitka, où les autorités russes lui accordèrent « une attention des plus courtoises » et où il organisa la prise de possession de Stikine, selon les accords intervenus en 1839 avec la Russian American Company. Il choisit également l’emplacement du fort Taku, en Alaska, et en fit commencer la construction. En décembre, il se rendit en Californie pour étudier les possibilités d’échanges commerciaux, acheter du bétail et s’entendre avec les autorités mexicaines en vue de commercer avec la Californie. Suivant son conseil, la compagnie construisit le poste de Yerba Buena à San Francisco.
Douglas fit preuve de réels talents de négociateur lors de ces missions délicates. Comme Simpson, il avait appris à jauger l’homme auquel il avait affaire. Comme McLoughlin, il avait belle prestance et était plein d’assurance. Rien ne lui échappait, du moindre détail relatif au gouvernement et à l’administration des affaires jusqu’aux valeurs sociales. Les administrateurs et le personnel de la Russian American Company vivaient dans l’oisiveté, selon lui, et les officiers de marine qu’employait cette compagnie étaient « les moins faits du monde pour s’occuper d’affaires ». Il estimait qu’en Californie espagnole, au contraire de ce qui se passait dans les territoires de John Bull, le gouvernement se comportait de façon arbitraire et que les lois n’étaient guère appliquées.
À Sitka, en traitant le gouverneur russe avec fermeté et tact, tout en faisant des concessions, Douglas arriva à une entente sur les limites des postes russes et britanniques. Au cours de leurs discussions quotidiennes, il s’exprima « de façon ouverte et naturelle, afin de dissiper toute impression de méfiance, et d’établir [leurs] rapports sur un pied de confiance mutuelle ». En ce qui concerne le commerce avec les Indiens, il obtint un tarif identique dans chaque poste. En mettant en vigueur les accords de 1839, Douglas promit de fournir les articles dont les Russes avaient besoin pour ce commerce, ainsi que du beurre et d’autres provisions venant du fort Langley. « L’honnêteté est toujours, en fin de compte, la meilleure politique, écrit-il, mais avec les Russes, il devra en être ainsi du premier au dernier jour de nos pourparlers. »
En Californie, Douglas se heurta à une réception « d’une courtoisie empreinte de réticence » de la part du gouverneur, Juan B. Alvarado. Son premier mouvement fut de s’offusquer d’un tel comportement mais, sachant que « mieux vaut réfléchir avant d’agir », il se contint et, faisant là encore quelques concessions, il réussit à obtenir l’autorisation nécessaire aux expéditions de trappeurs, des droits commerciaux, et le droit d’acheter à un prix raisonnable les moutons et le bétail dont on avait besoin dans les fermes de la compagnie situées sur les rives du fleuve Columbia.
En août 1841, Douglas accueillit Simpson à Fort Vancouver en l’absence de McLoughlin et l’accompagna à Sitka pour négocier une fois encore avec les Russes. Simpson prit des décisions qui allaient éveiller le ressentiment de McL,oughlin : on abandonnerait les postes situés le plus au nord, on augmenterait le rayonnement commercial du bateau à vapeur, le Beaver, et on organiserait un nouveau port, à l’extrémité sud de l’île de Vancouver. Douglas partit inspecter la pointe de l’île de Vancouver en juillet 1842, et, en mars 1843, commença la construction du fort Victoria.
L’érection de ce fort annonçait la fin prochaine de la grande époque du district de Columbia. Bien qu’Américains et Anglais eussent joui de droits égaux à l’ouest des montagnes depuis 1827, la compagnie avait, à cause de son importance, à peu près supprimé toute concurrence dans la traite des fourrures entres les 54º 40´ et 42º. Toutefois, le contrat qu’elle avait passé avec les Russes et qui l’obligeait à les ravitailler exigeait une certaine diversification de ses opérations. On intensifia l’agriculture dans le région de Fort Vancouver et de la vallée de Cowlitz et on y fit venir des pionniers de la Rivière-Rouge. Dans les années 40, des colons américains commencèrent à s’infiltrer dans la région et, en 1843, des gens hostiles aux intérêts britanniques », selon Douglas, arrivèrent en nombre si important qu’un gouvernement provisoire fut organisé en Oregon. Devant la présence des immigrants venus avec Elijah White dans la vallée de la Willamette en 1842 et l’arrivée en 1843 de 120 chariots de colons, McLoughlin fit contre mauvaise fortune bon coeur. Les nouveaux venus étaient bien armés, mais n’avaient ni argent, ni équipement. McLoughlin leur fournit des graines et les objets les plus indispensables, et il leur accorda des conditions de crédit dans les magasins de la compagnie.
Douglas se rendait compte que ce serait bientôt la rupture entre McLoughlin et Simpson. Il demeura loyal au premier, espérant, comme lui, que l’on pourrait convaincre les Américains de se déplacer vers la Californie, mais il était alarmé à l’idée de sacrifier les droits commerciaux de la compagnie et convaincu que les pressions exercées par les Américains iraient en augmentant. Il prévoyait aussi avec inquiétude que le gouvernement des États-Unis manifesterait de l’intérêt pour d’autres ports de la côte du Pacifique. « Les Américains ne se soumettront jamais de bonne grâce à la domination britannique, écrivit-il à Simpson, et il serait ruineux et inutile de vouloir faire obéir des gens mal disposés à notre égard ; notre gouvernement ne tentera donc même pas d’y parvenir et, en conséquence, il se fondera un nouvel état, qui se joindra à la république. » Si les États-Unis obtiennent un nouveau port sur le Pacifique, « chaque port deviendra un arsenal de la marine, et le Pacifique sera sillonné par une multitude de bâtiments de course, ce qui amènera la ruine du commerce britannique dans ces parages ».
Comme, en 1845, le nombre des habitants de race blanche en Oregon atteignit 6 000 en raison de l’immigration américaine, le gouvernement provisoire s’octroya juridiction au nord du fleuve Columbia. Le gouvernement britannique ne se montra guère intéressé à défendre ses droits sur le fleuve. Douglas, qui voyait loin, émit le principe des « droits de possession », afin de permettre à la compagnie d’occuper ses postes et ses fermes au nord du fleuve Columbia si le gouvernement britannique abandonnait ses revendications territoriales.
En 1845, la compagnie, reconnaissant que la situation était devenue critique en Oregon, remplaça l’autorité absolue de McLoughlin par un conseil de direction composé de ce dernier, de Peter Skene Ogden* et de James Douglas. Lorsque McLoughlin quitta la compagnie en 1846, Douglas fut choisi comme doyen du conseil et on y ajouta John Work. McLoughlin et Douglas allaient maintenant suivre des chemins divergents. McLoughlin avait décidé de partager le sort des Américains. Sans hésiter un seul instant, Douglas demeura fidèle à la compagnie et à l’Angleterre.
En 1846, lorsque le gouvernement britannique abandonna ses droits sur la rive nord du fleuve Columbia et accepta le 49e parallèle pour frontière, Douglas réorganisa le tracé des pistes des convois de trappeurs afin de faire converger les routes de New Caledonia vers le fort Langley, sur le cours inférieur du Fraser. En 1848, il alla étudier le marché du bois et du saumon à Honolulu. Et finalement, en 1849, il transféra les bureaux principaux de la compagnie, ses entrepôts maritimes et ses entrepôts de ravitaillement, de Columbia au fort Victoria.
Afin d’empêcher les Américains de s’introduire dans le Nord, la compagnie accepta le 13 janvier 1849 une concession royale d’une durée de dix ans pour l’île de Vancouver. Une colonie devait être constituée dans les cinq ans, et Douglas s’attendait à être nommé gouverneur de cette « véritable intima Thule de l’empire britannique ». Mais afin d’éviter « la jalousie des uns et la cupidité des autres », on lui préféra Richard Blanshard*. Les préparatifs entrepris pour l’arrivée du gouverneur, des colons et des régisseurs envoyés d’Angleterre étaient loin d’être terminés lorsque Blanshard arriva au fort Victoria en mars 1850. Les ouvriers abandonnaient leur travail pour aller chercher de l’or en Californie. « Les affaires de notre nouvelle colonie dans l’île de Vancouver n’avancent pas vite », reconnut Douglas en novembre. Blanshard avait déjà donné sa démission et, en attendant que Londres l’acceptât, le gouverneur commença de prêter l’oreille aux plaintes de ceux qui trouvaient que Douglas avait trop d’autorité, que les terres coûtaient trop cher et que les prix dans les magasins de la compagnie étaient exorbitants. La colonisation était tellement entravée par la politique d’immigration sélective adoptée par le ministère des Colonies que, lorsque Blanshard constitua un conseil le 27 août 1851, il fut bien forcé d’y nommer Douglas et Tod, qui étaient au service de la compagnie, ainsi que le capitaine James Cooper, ancien employé de la compagnie.
Le 16 mai 1851, Douglas avait été nommé gouverneur et vice-amiral de l’Île-de-Vancouver et de ses dépendances. Mais la nouvelle ne lui parvint que le 30 octobre. « Me voilà encore gouverneur pro tempore », s’était-il plaint au moment du départ de Blanshard en septembre ; « c’est trop d’honneur et me voilà fatigué de l’île de Vancouver. » Mais une fois sa nomination confirmée, il se consacra avec enthousiasme à sa double tâche de gouverneur et d’agent principal. Il prit les mesures nécessaires pour protéger de l’avidité des Américains l’or que l’on venait de découvrir dans les îles de la Reine-Charlotte ; il conseilla à la compagnie d’acquérir les mines de charbon de Nanaimo, acheta des terres aux Indiens près du fort Victoria, constitua des réserves, fit construire des routes et fonda des écoles.
Rien ne préoccupait davantage Douglas que la ligne de conduite à adopter à l’égard des Indiens. Il se montrait envers eux d’un paternalisme bienveillant, encore qu’il suivît la règle de la compagnie voulant que toute infraction fût rapidement punie. Afin de pourchasser un assassin cowichan, en 1853, il organisa les voltigeurs de Victoria, qui furent recrutés parmi les employés de la compagnie et qui constituèrent ainsi une petite milice de volontaires, il s’assura l’aide de la marine royale, et, pour le procès, il constitua un jury à bord du Beaver. La même année, il fit construire le bastion de Nanaimo.
En délimitant les réserves, il permit aux Indiens d’en choisir l’emplacement et l’étendue. Les arpenteurs reçurent l’ordre de respecter leurs désirs et de s’assurer que « chaque réserve comprît les sites permanents des villages, des pêcheries, un cimetière, des terres arables, et toutes les ressources préférées des tribus, bref de leur accorder toutes les terres sur lesquelles il ; avaient acquis un droit de possession soit par leur résidence permanente, soit par les cultures ou tout autre travail qu’ils auraient pu y effectuer ». Au début, les Indiens n’eurent que des exigences modestes, et ne demandèrent pas plus de dix acres par famille. Mais plus tard, dans les pâturages de l’intérieur, ils eurent besoin de terrains plus vastes pour leur bétail et leurs chevaux, et les réserves devinrent plus importantes. Le droit de propriété demeurait acquis à la couronne « comme mesure de sécurité et de protection pour ces collectivités indiennes qui pourraient, en raison de leur nature primitive, de leur ignorance et de leur imprévoyance naturelle, se débarrasser de leurs terres ». À mesure que sa politique à cet égard se précisait, Douglas était certain que le temps viendrait o’u « ils souhaiteraient une place plus importante dans la société, prendraient conscience de leurs besoins essentiels et exigeraient les droits qui découlent d’une condition plus élevée ». Aussi permit-il aux Indiens d’acquérir des terres à titre individuel ou par droit de préemption « aux mêmes conditions et au même prix que ceux accordés aux autres groupes de sujets de Sa Majesté ».
Comme principal administrateur de la compagnie à l’ouest des Rocheuses, Douglas encouragea les trafiquants du fort Langley à compléter leurs exportations de fourrures avec des produits agricoles et autres. Sachant que les innovations qui se faisaient dans l’he-de-Vancouver finiraient par en éliminer la traite des fourrures, il protégea jalousement les droits de la compagnie sur le continent, c’est-à-dire dans le district de New Caledonia. Il vérifia soigneusement les dépenses civiles et militaires engagées par la compagnie dans la colonie et déposa dans un compte en fiducie tous les revenus de la vente de terres et du bois ainsi que de l’exploitation des mines.
Une fois gouverneur et investi d’une autorité nouvelle, il suscita un certain ressentiment autour de lui. Les colons attendaient de lui plus d’améliorations qu’il ne pouvait en faire et l’accusèrent, lorsqu’il nomma au conseil deux anciens associés, dè chercher à créer une oligarchie. En- 1853, ses vieux amis, Tod, le médecin William Fraser Tolmie* et Roderick Finlayson*, influencés par le capitaine Cooper, le révérend Robert John Staines*, aumônier de la compagnie, et un régisseur, Edward Edwards Langford*, autorisèrent que l’on présentât des critiques sur Douglas à un député anglais de passage, C. W. Wentworth-Fitzwilliam. Ayant eu vent que Tod et Ogden accusaient Douglas de négligence à propos de la traite des fourrures, sir George Simpson, à Lachine, mit en doute sa loyauté à l’égard de la compagnie, déclarant ouvertement que Douglas avait « toujours fait preuve de vanité et d’ambition, surtout depuis quelques années. La situation importante à laquelle il [était] parvenu l’[avait], semble-t-il, rendu impérieux à l’égard de ses collègues et de ses subordonnés. Non seulement se [comportait]-il tout à fait comme un gouverneur, mais encore [donnait]-il des ordres que personne n’[avait] le droit de contester ». « Douglas semble bien décidé à ne pas nous renseigner sur ce qui se passe dans l’Île-de-Vancouver, disait Ogden à Simpson. D’après ce que je peux savoir de quelques pionniers, Cooper et Tod ont leur franc-parler, ce qu’il n’apprécie guère ; la traite des fourrures va sans doute bientôt trouver un porte-parole qui, lui aussi, s’exprimera sans ambages. Le système actuel ne pourra jamais répondre aux besoins de la situation, car trop d’autorité dans les mains d’un seul homme ne peut engendrer que des conflits d’intérêt [...]. »
Les pionniers comme Cooper affirmèrent que ni la compagnie ni Douglas n’avaient donné suite à leur obligation de coloniser l’île. Ils réclamèrent que l’île revînt à la couronne et que l’on nommât un gouverneur indépendant de la compagnie, qui n’attendrait pas l’avis des administrateurs de la compagnie ni leur aide pour mettre en oeuvre la politique du gouvernement.
Leur principal grief, selon Douglas, était la question de la politique des terres. Ni la compagnie ni le ministère des Colonies n’avaient suivi son conseil d’accorder des concessions gratuites de 200 ou 300 acres. On avait plutôt fixé le prix des terres à £1 l’acre, avec un achat minimum de 20 acres, et les pionniers qui achetaient plus de 100 acres devaient amener des colons avec eux. De plus, la compagnie en se créant une « réserve » de près de six milles carrés près du fort et en établissant ses fermes sur les autres bonnes terres avait forcé les pionniers à se disperser dans des régions moins favorables à l’agriculture.
Douglas était lui-même convaincu que la colonisation était en bonne voie et que la colonie avait de l’avenir. Bien que d’autres employés de la colonie fussent, disait-il, « effrayés du prix élevé que l’on demandait », il commença en décembre 1851 à acheter des terres au prix fixé, comme placement. Aux 12 acres attenantes au fort, il ajouta d’autres terrains : 418 acres à Esquimalt en 1852, puis 247 acres en 1855 et 240 acres en 1858 ; il acheta également 319 acres à Metchosin. C’étaient ses terres de Victoria qui avaient le plus de valeur : Fairfield Farm et un grand terrain sur la baie de James, à côté de la réserve du gouvernement.
Par l’intermédiaire de Fitzwilliam, on soumit aux deux chambres du parlement britannique des pétitions rédigées dans la colonie en 1854. Aux accusations antérieures s’ajoutaient celle de népotisme. Estimant que ses magistrats, E. E. Langford, Thomas Blinkhorn, Kenneth McKenzie et Thomas James Skinner, étaient ignorants et qu’il ne pouvait se fier à eux, Douglas avait nommé David Cameron, arrivé de Demerara en 1853 avec sa femme Cecilia Eliza Douglas Cowan, âu poste de juge en chef de la Cour suprême nouvellement créée.
Avant d’en arriver à une décision sur le renouvellement des droits commerciaux exclusifs de la compagnie sur la côte du Pacifique, droits qu’on lui avait accordés en 1838 pour une période de 21 ans, le parlement devait examiner les activités de la compagnie et, de plus, évaluer ses réalisations comme agent de colonisation. Dans l’intervalle, le ministère des Colonies ne retira pas sôn poste à Douglas mais diminua son autorité. Le 22 mai 1856, on lui ordonna de créer une assemblée. Il obtempéra, bien qu’ayant, comme il le disait lui-même, « fort peu de connaissances en matière de législation et n’ayant auprès de [lui] aucun conseiller juridique ni personne capable de lui apporter une aide intelligente ».
À peine quelques années plus tôt, l’île de Vancouver était une réserve de fourrures dans laquelle s’élevait un seul fort entouré de palissades. C’était maintenant une colonie dirigée par un gouvernement à représentativité limitée. En comparaison du territoire voisin de Washington où les terres étaient gratuites, la population était peu nombreuse mais elle vivait en paix, sans se battre avec les Indiens. Grâce aux efforts de Douglas, l’agriculture sur une grande échelle, des scieries, des charbonnages et des pêcheries de saumon s’étaient maintenant développés. Le gouverneur projetait de construire des immeubles du gouvernement dans sa petite capitale et il s’efforçait de transformer Esquimalt en une base navale. Ses réalisations compensèrent les critiques qu’émirent Blanshard, Cooper et l’amiral Fairfax Moresby sur sa façon de gouverner, devant la commission spéciale de la chambre des Communes britanniques en 1857. Lorsque le gouvernement transforma l’île de Vancouver en colonie de la couronne en 1859, il choisit James Douglas comme gouverneur. En 1857, on savait déjà à Londres qu’on avait découvert de l’or sur le continent, qui était toujours sous contrôle de la compagnie. Il serait précieux d’avoir sur les lieux un administrateur colonial aussi expérimenté que Douglas.
En juillet 1857, Douglas avait fait savoir à Londres que les Américains exploitaient des mines sur la rivière Thompson et qu’il fallait un fonctionnaire pour y maintenir la paix et l’ordre. Dès le mois de décembre, la ruée vers l’or était imminente. Ne recevant aucune instruction, Douglas agit de son propre chef, comme il l’avait fait lorsqu’on avait trouvé de l’or dans les îles de la Reine-Charlotte. À titre de représentant du gouvernement britannique le moins éloigné de la région, il proclama, le 28 décembre 1857, les droits de la couronne sur l’exploitation des mines et imposa aux prospecteurs l’obligation de faire des demandes de permis. Il n’avait toujours pas reçu d’instructions lorsque le premier bateau chargé de chercheurs d’or californiens arriva à Victoria le 25 avril 1858. Il prévint Londres : « Si l’on ouvre à tort et à travers le pays à l’immigration, les intérêts de l’empire pourraient bien en souffrir. » Tout aussi préoccupé par les droits commerciaux privés de la compagnie, il demanda l’appui du capitaine de vaisseau James Charles Prevost, de la commission britannique sur les frontières, et le pria de rester avec sa canonnière à l’embouchure du Fraser, pour recueillir les permis de tous les bateaux qui vaudraient remonter le fleuve.
Une fois déjà, Douglas avait pu mesurer les résultats de la pénétration américaine en territoire britannique, et il redoutait de voir se répéter’ l’affaire de l’Oregon. Les squatters américains étaient sur l’île San Juan, tout près de Victoria et des javeaux du Fraser, et 8 000 mineurs avaient emprunté l’ancienne route des brigades à travers la vallée de l’Okanagan. Le village anglais de Victoria, transformé en campement, fourmillait de commerçants américains, de courtiers et d’intermédiaires, d’agents des terres et de spéculateurs de toutes sortes. Dans la région sauvage et inhabitée qui s’étendait de l’autre côté du détroit de Georgia, les prospecteurs étrangers inquiétaient les Indiens et menaçaient de se faire justice. Quant à Douglas, il estimait que Victoria, au lieu de San Francisco, devait devenir le centre de ravitaillement pour les mines, et le Fraser, non le Columbia, la principale artère du commerce et du transport. Pour protéger la souveraineté britannique, il fallait une armée et une marine. Le droit britannique devait s’imposer à ces « foules sans loi ».
Deux fois au cours de l’été de 1858, il se rendit au site des exploitations minières. Quelques chercheurs d’or, découragées par les crues de printemps, avaient déjà abandonné les barres du fleuve et quitté le pays. Mais du fort Langley au fort Yale, plus de 10 000 prospecteurs lavaient les sables aurifères dans des batées. Quelques-uns avaient suivi les rives escarpées du fleuve au delà de Yale, et du grand canon, jusqu’à Lytton. Il fallait organiser le transport fluvial, ouvrir des routes, formuler des règlements relatifs à l’exploitation des mines et au maintien de l’ordre. En juillet, Douglas permit à deux vapeurs à roue arrière américains de s’ajouter aux bateaux de la compagnie pour faire la navette sur les 100 milles navigables jusqu’à Yale. On fit appel à des volontaires pour construire une route le long de la rivière Harrison jusqu’à Lilloet, et un chemin muletier de Yale à Lytton. On formula des règlements miniers, on engagea des policiers et on nomma des Indiens magistrats avec charge de poursuivre ceux des leurs qui commettraient des délits. Afin d’éviter l’occupation illégale par les squatters, Douglas fit délimiter par des arpenteurs l’emplacement de villes près des postes de la compagnie à Langley et à Hope, et on mit des lopins de terre en vente.
« J’ai parlé en termes fort clairs aux chercheurs d’or de race blanche, qui sont presque tous des étrangers et qui viennent d’à peu près tous les pays d’Europe », rapporta-t-il le 15 juin 1858 au ministère des Colonies, après sa première visite dans les régions aurifères. « J’ai refusé d’accorder tout droit d’occuper les terres, et leur ai dit nettement que le gouvernement de Sa Majesté ignorait jusqu’à leur existence dans cette région qui n’était pas censée être colonisée et où ils étaient tout au plus tolérés. Je les ai prévenus qu’on n’admettrait aucun abus et que la justice protégerait les droits des Indiens autant que ceux des Blancs. »
Après que son autorité eut été confirmée en août, il assigna les droits territoriaux à la couronne et l’on ouvrit petit à petit la région à la colonisation. Dans l’espoir d’attirer des immigrants de Grande-Bretagne, on vendit les terrains à bon marché. Seuls les sujets britanniques pouvaient acheter des terres, mais tous ceux qui faisaient une demande de naturalisation voyaient leur demande acceptée.
L’initiative prise par Douglas suscita d’abord l’enthousiasme à Londres. Puis un nouveau ministre des Colonies, sir Edward Bulwer-Lytton, qui jugeait avec sévérité la compagnie et le monopole dont elle jouissait, vit dans ces mesures préliminaires des démarches destinées à réserver tout le commerce de la région « autant que possible aux agents de la compagnie ». Il réprimanda Douglas, puis il prit les mesures nécessaires pour mettre fin aux droits exclusifs de la compagnie et pour ouvrir la côte du Pacifique à la colonisation. À sa suggestion, le parlement transforma, le 2 août 1858, le territoire de New Caledonia en colonie de la couronne, sous le nom de Colombie-Britannique.
On offrit à Douglas le poste de gouverneur de la nouvelle colonie, à condition qu’il rompît les liens qui l’attachaient à son ancienne compagnie. De l’avis de Simpson, il était sans contredit le mieux qualifié pour exercer ces fonctions et son traitement « l’aiderait à surmonter ses difficultés. Il faut aussi compter, ajoutait Simpson, sur sa vanité qui est grande, mais qui se double de beaucoup de détermination et de doigté ». Les deux intérêts que représentait Douglas étaient maintenant en conflit, et bien qu’il ne pût que susciter des regrets en se retirant de la compagnie, « son train de vie fastueux » comme gouverneur et sa façon libérale de recevoir tous les visiteurs avaient été un fardeau financier pour le commerce de la fourrure « qui bénéficia très peu de cette façon de faire ».
Le traitement que l’on accorda à Douglas à titre de gouverneur des deux colonies (la Colombie-Britannique et l’Île-de-Vancouver) n’était que de £1 800, mais il eut la compensation de devenir compagnon de l’ordre du Bain, en récompense de son administration de la colonie de l’Île-de-Vancouver, colonie sous le contrôle de la compagnie. Au fort Langley, le 19 novembre 1858, après avoir été démis de ses fonctions et avoir, en principe, liquidé ses intérêts dans la compagnie, James Douglas, compagnon de l’ordre du Bain, prêta serment et assuma les fonctions de gouverneur de la Colombie-Britannique.
Au printemps de 1859, Douglas n’était pas arrivé à persuader la compagnie d’acheter les intérêts qu’il avait acquis pour sa retraite. La compagnie voulait se faire rembourser les dépenses engagées au profit de la colonie de l’Île-de-Vancouver et se montrait préoccupée par les rapports émanant d’Alexander Grant Dallas*, qui vérifiait à Victoria les comptes de Douglas. On avait trouvé des cas où les fonds destinés à la traite des fourrures avaient servi au développement de la colonie. Qui plus est, £17 000 avaient été prises dans le compte de la traite des fourrures et avaient servi, à cause des « conditions urgentes » de l’année 1858, à acheter des provisions pour les chercheurs d’or qui arrivaient en foule en Colombie-Britannique.
Simpson confia à Dallas que « bien à contrecœur [il se voyait] forcé de reconnaître que M. Douglas avait usé de façon injustifiable de l’autorité dont on l’avait investi, afin de satisfaire ses intérêts propres, ceux de sa famille et ceux des gens à son service [...]. Je pense, dit-il, qu’il sera difficile de retenir l’argent qui lui appartient et qui est aux mains de la compagnie ; mais les intérêts acquis sont sous le contrôle de cette dernière, et je crois qu’on pourrait à juste titre les bloquer jusqu’à ce que la vérification des comptes de la colonie soit terminée ». La compagnie partagea cette opinion, et on ne prit aucune mesure lorsqu’en mai 1859 Douglas fit valoir ses droits à la somme de £3 500.
Voyant s’envoler ses légitimes espoirs et constatant l’insuffisance de son traitement, Douglas menaça de démissionner. « En tant que simple citoyen, je peux vivre de la façon qui correspond à ma fortune, fit-il savoir au ministre des Colonies. Mais en tant que gouverneur de la couronne, je n’ai pas le choix : il me faut bien adopter le train de vie qui sied à son représentant. » Bien que le gouvernement le considérât irremplaçable, il ne lui fit que de vagues promesses d’augmenter son traitement, quand augmenteraient les fonds provenant de la vente de terrains en Colombie-Britannique.
Jusqu’à ce que la couronne décidât de constituer une assemblée législative en Colombie-Britannique, le gouverneur avait pouvoir absolu d’administrer la justice et de promulguer lois et décrets. Il ne serait pas juste ni conforme aux grands principes qui doivent sous-tendre la liberté des institutions, avait déclaré Lytton en juillet 1858, de « tenter dès le début, l’expérience d’un gouvernement autonome parmi des colons aussi peu civilisés, d’origine si variée, qui ne sont peut-être que de passage, et dans une société aussi peu évoluée ». Cela convenait parfaitement à Douglas ; il estimait que la « meilleure forme de gouvernement, si elle existe, [était] un despotisme sage et éclairé », et que « les gouvernements responsables ne [pouvaient] exister sans recours direct ou indirect aux pots-de-vin et aux influences corruptrices ». Il saisit l’occasion qui s’offrait à lui d’élaborer sa politique et de la faire connaître sous forme de proclamation.
La colonie de l’or avait été richement dotée par la nature. Aussi le gouvernement britannique, tout en assumant la responsabilité des dépenses militaires, avait-il l’intention de ne dresser qu’une petite liste civile, comprenant un juge et quelques fonctionnaires. Il donna l’ordre au contre-amiral Robert Lambert Baynes, de la flotte du Pacifique, d’appuyer Douglas. Toutefois, son vaisseau amiral, le Ganges, armé de 84 canons, n’arriva à Esquimalt qu’en octobre 1858, après le départ de la plupart des chercheurs d’or qui allaient passer l’hiver en Californie. En février 1859, une frégate et une corvette, avec 164 soldats d’infanterie de marine surnuméraires arrivèrent des mers de Chine. Un détachement de 165 soldats du Génie fut aussi envoyé d’Angleterre et le gros de la troupe arriva en avril 1859.
Au cours de cette période critique que fut la première saison d’exploitation des mines d’or, il n’y avait eu ni autorité civile ni assistance militaire. Douglas n’avait aucun pouvoir politique et, pour toute protection personnelle, que 20 marins et 16 soldats du Génie, détachés de la commission sur les frontières, quand, au mois d’août 1858, il fit la tournée des camps de mineurs pour réprimer les désordres et annoncer son intention de faire officiellement des régions aurifères une partie intégrante de l’Empire britannique. Le 29 octobre 1858, il écrivit à Herman Merivale qu’il n’avait jamais vu « autant de têtes de fieffés coquins », mais qu’à son commandement, ils acclamèrent par trois fois la reine, « de fort mauvaise grâce, d’ailleurs ».
En 1859, il ne se produisit aucune arrivée massive de chercheurs d’or comme en 1858, alors qu’étaient venus quelque 25 000 aventuriers. Quelques-uns préféraient la liberté plus grande qui régnait dans les mines d’or américaines ; d’autres, entendant parler de la découverte de nouveaux gisements en territoire américain, s’y rendirent. Le Génie put se consacrer à sa mission : créer un réseau de transport, délimiter les emplacements où l’on construirait les villes et assurer la protection militaire nécessaire. Le colonel Richard Clement Moody*, commandant des troupes et commissaire des Terres et des Travaux publics, choisit, en tenant compte de la possibilité de se défendre éventuellement contre les Américains, un endroit situé près de l’embouchure du Fraser pour y bâtir la capitale de la colonie. Elle prit par la suite le nom de New Westminster. Les sapeurs et les soldats de l’infanterie de marine se mirent à abattre les arbres géants qui couvraient les pentes abruptes des collines.
Le gouverneur, lui aussi, se préoccupait de la sécurité. Quand un corps expéditionnaire américain débarqua dans l’île de San Juan le 27 juillet, il ne fallut pas moins de l’Assemblée législative de l’Île-de-Vancouver et des efforts du contre-amiral Baynes pour l’empêcher de l’expulser par la force. Tant qu’on n’eut pas déterminé à qui appartenait l’île, elle fut occupée par les forces militaires des deux pays. Quand il entendit parler de l’incident du Trent, qui avait eu lieu en 1861, Douglas souhaita vivement avoir recours à la marine du Pacifique Nord, au Génie et aux fusiliers marins qui étaient en station dans l’île de San Juan, pour s’emparer de cette île, prendre possession du détroit de Puget et s’avancer à l’intérieur des terres jusqu’au Columbia. « Avec le détroit de Puget et le Columbia entre nos mains, nous contrôlerions les seules voies navigables de la région et, de ce fait, nous serions maîtres de son commerce et la forcerions bientôt à se soumettre au gouvernement de Sa Majesté. » À son grand désappointement, le gouvernement britannique le découragea de passer à l’action.
En 1860, l’approvisionnement des mines situées à l’intérieur des terres devint un problème sérieux. Afin d’encourager les importateurs, on fit de Victoria un port franc, et, pour stimuler l’agriculture dans les terres de l’intérieur, on instaura un système de droit de préemption. Quand, en 1860, on découvrit de riches gisements dans le lointain ruisseau Antler, il fut bientôt évident qu’une autre ruée vers l’or allait se produire. Les files de chariots allaient remplacer les cortèges de bêtes de somme, et il faudrait réduire les frais de transport des marchandises à travers les rudes sentiers dans les cols des montagnes. Douglas fit appel aux civils ainsi qu’aux sapeurs pour améliorer les routes et, lorsque le gouvernement britannique refusa son aide financière, il recueillit des fonds en percevant des droits de tonnage, des péages, en imposant des permis d’exploitation minière et, en 1861, il fit un emprunt bancaire de £50 000.
En 1862, la ruée vers l’or dans la région du Cariboo attira 5 000 chercheurs. À cette occasion, le gouverneur Douglas dévoila son projet de construire une route importante pour les chariots : elle aurait 18 pieds de large, 400 milles de long, et irait de Yale, au-delà de la gorge du fleuve en direction du nord jusqu’à Quesnel et en direction de l’est jusqu’au ruisseau Williams. Avec la « grande route du Nord », qui allait être construite par des entrepreneurs privés et par les officiers du Génie, on pourrait mettre fin à la domination économique des Américains en faisant de la vallée du Fraser, malgré ses inconvénients naturels, la principale route commerciale de la Colombie-Britannique. Douglas espérait que la route pourrait être prolongée pour relier la Colombie-Britannique au Canada : « Qui peut prédire ce qui se passera au cours des dix prochaines années ? écrivait-il en 1863 ; il y aura sûrement un télégraphe continental et probablement un chemin de fer en territoire britannique qui reliera le golfe de Georgia à l’Atlantique. »
La population avait changé depuis la découverte, en 1861, des premières grosses pépites d’or dans le ruisseau Williams, dans la région du Cariboo. Lors de sa tournée de 1862 à Barkerville et dans les autres villes sur (e cours du ruisseau, le juge en chef Matthew Baillie Begbie*, ce juge austère et arrogant que l’on avait envoyé d’Angleterre, fit remarquer que « toutes les bonnes familles de l’Est et d’Angleterre semblaient avoir envoyé leur fils le plus doué pour se consacrer au développement des mines d’or de la région du Cariboo ». Dans le contingent qui était arrivé du Canada par voie de terre en 1862, se trouvaient des agriculteurs décidés de se fixer de façon permanente dans la colonie. Enfin, on avait cette présence de l’« élément britannique » que désirait tant Douglas.
New Westminster, la capitale de la colonie de l’or, comptait déjà bon nombre de Canadiens. Beaucoup d’entre eux étaient des négociants ou des spéculateurs parmi lesquels le mécontentement régna bientôt lorsqu’ils virent s’évanouir leurs rêves de prospérité. Les affaires languissaient à New Westminster alors que Victoria devenait le centre commercial et bancaire et que Yale devenait le port fluvial du littoral où s’effectuait le transbordement en direction des mines de l’intérieur. On se mit à jalouser amèrement l’île, et on critiqua Douglas qui continuait, avec ses fonctionnaires, de résider à Victoria. Il devint de plus en plus impopulaire à mesure qu’il s’appuyait davantage sur les assistants qu’on lui envoyait d’Angleterre, et que John Robson*, le bouillant rédacteur en chef du British Columbian, citait des exemples de son autoritarisme.
À la première demande d’un gouvernement populaire qui lui parvint de New Westminster, Douglas répondit en accordant, le 16 juillet 1860, l’autorisation d’ériger la ville en municipalité et d’élire un conseil municipal. En transmettant la demande d’assemblée formulée en 1860, il avait exprimé l’opinion que l’élément britannique dans la colonie était encore trop peu nombreux pour que l’on pût justifier cette concession. Sur quatre pétitions ultérieures, demandant un gouvernement populaire, qui furent transmises au ministère des Colonies, trois demeurèrent sans réponse de la part du duc de Newcastle [Clinton].
La convocation d’une assemblée à Hope, en septembre 1861, afin de réclamer le gouvernement responsable, suscita la colère du gouverneur : « C’est là un mot qui va de pair avec révolution et qui renferme une menace certaine. Le sujet a certes le droit de soumettre une pétition à sa souveraine, mais le mot « assemblée » signifie autre chose. il signifie coercition. » Il reconnut néanmoins le principe du gouvernement représentatif. En effet, en 1862, allant au devant de la réorganisation du gouvernement de la colonie prévue pour 1863 dans l’acte de fondation, Douglas recommanda une chambre avec un petit nombre de membres, dont le tiers serait nommé par la couronne et les deux tiers seraient élus.
Douglas se rendait compte que les « radicaux de New Westminster » avaient obtenu l’appui d’un homme politique canadien, Malcolm Cameron, et que Cameron faisait pression depuis 1861 sur Newcastle pour qu’on démît le gouverneur de ses fonctions. Après une visite à New Westminster en 1862, Cameron rendit visite à Douglas et lui montra la pétition qu’il avait l’intention de présenter à la reine. Douglas le congédia en l’informant sèchement qu’il était lui-même le gardien des droits et des libertés du peuple, et que, s’il ne pouvait améliorer la situation, il saurait présenter les griefs « de la manière appropriée » devant le gouvernement de Sa Majesté. En relatant l’incident au ministère des Colonies, il insista sur le fait que la Colombie-Britannique était en majorité prospère et satisfaite de son sort. « Une méchante clique de Californiens et de Canadiens, installés à New Westminster, sont à l’origine de toute cette histoire de « gouvernement responsable », et ce sont les seuls mécontents. Cette faction est composée de gens qui ne savent rien des besoins ni des conditions de vie du pays et qui n’ont jamais rien fait et ne feront jamais rien que de se plaindre. Non sans raison, ils sont fréquemment en butte aux moquerie. »
Cameron soumit aux autorités de Londres en février 1863 la pétition signée par « quelques habitants de Colombie-Britannique ». « Je ne puis m’empêcher de penser, lui dit Newcastle, qu’ils manquent un peu de jugement dans leurs demandes de changement radical dans la forme actuelle du gouvernement [...]. Ils traitent le leur d’« anti-britannique » et d’« anormal », mais ils oublient que leur colonie a à peine cinq ans et que la forme du gouvernement a été définie dans la loi de 1858, cette même loi qui prévoyait pour cette année [1863] le moment où devrait être envisagé tout changement dans la forme du gouvernement. »
Un mois plus tard, le duc envoya une dépêche à Douglas : « Comme vous avez maintenant gouverné l’Île-de-Vancouver pendant douze ans – deux fois la durée normale de l’exercice des fonctions d’un gouverneur – et que je ne pense pas qu’il soit souhaitable de vous y remplacer par un nouveau gouverneur et de vous laisser vous installer à New Westminster comme gouverneur de la seule Colombie-Britannique, j’ai l’intention de vous relever de vos deux gouvernements [...]. Vous pouvez être assuré que je ne ferai rien pour vous désobliger ni pour permettre à ceux qui ont souhaité votre rappel de triompher [...]. J’ai maintenant recommandé à la Reine votre successeur pour ces deux gouvernements, et j’ai accompagné ces recommandations de celle que vous soyiez élevé à la seconde classe de l’ordre du Bain. »
Afin de financer sa grande route, Douglas n’avait pas attendu l’autorisation officielle pour emprunter £100 000. Cela lui valut des reproches de Londres. De plus, Newcastle avait appris que Douglas s’était arrangé pour que son traitement passe de £I 800 à £3 800. De vieux ennemis et de plus récents, qu’il s’était faits au cours de sa longue carrière, s’étaient présentés à Whitehall. L’un d’eux, Langford, avait, bien des années auparavant, accusé Douglas de créer dans l’Île-de-Vancouver un « Family-Company Compact ». Un autre était le capitaine William Driscoll Gosset, officier du Génie, qui s’était montré incompétent dans l’exercice des fonctions de trésorier de la Colombie-Britannique. On savait que les rapports de Douglas avec le colonel Moody, qui avait été rappelé de la colonie avec les soldats du Génie en 1863, n’avaient pas été particulièrement cordiaux, et on accordait quelque crédit aux assertions des journalistes, Amor De Cosmos* à Victoria et John Robson à New Westminster, qui prétendaient que le gouverneur était un despote.
En se préparant à abandonner son poste au printemps de 1864, sir James Douglas pouvait dire avec satisfaction qu’il avait fait disparaître la menace étrangère et protégé la souveraineté britannique sur les côtes du Pacifique. Sa route était construite, la région aurifère du Caribou était exploitée au maximum, les villes de l’intérieur commençaient à se bâtir, l’ordre et la loi régnaient dans les régions minières. En 1864, les revenus de la colonie s’élevèrent à £110 000. Victoria avait 6 000 habitants et Barkerville, presque autant. La dernière tâche qu’accomplit Douglas en Colombie--Britannique, laquelle connaissait maintenant la stabilité, fut la création d’un Conseil législatif. « La carrière de gouverneur de sir James Douglas a réellement été remarquable, reconnut un fonctionnaire du ministère des Colonies. Au moment où il abandonne ses deux gouvernements, il les laisse en excellent état, avec toutes les chances de connaître une prospérité plus grande encore. »
Quant à Douglas, il lui semblait que, quel qu’ait été le caractère de son gouvernement, l’honneur que lui avait fait la reine en le créant chevalier et les marques de respect que lui prodiguèrent les habitants de la colonie lorsqu’il prit sa retraite, ne faisaient que refléter l’opinion générale : son but incessant avait été de « travailler pour le bien public et de procurer à la colonie le bien-être matériel ». Il continua d’insister auprès de Newcastle pour qu’on reliât la Colombie-Britannique et le Canada par une route praticable, car le « commerce trouvera des débouchés nouveaux et la population et la colonisation augmenteront en conséquence ».
Au cours des longues années consacrées à la traite des fourrures, Douglas n’avait jamais pris de congé et ne s’était même pas absenté de son poste une seule journée. Devenu gouverneur colonial, il s’était consacré à ses responsabilités et à son dur labeur. Son allure était quelque peu étrange et ses manières pompeuses, mais il ne s’était jamais résigné à « représenter Sa Majesté sans éclat ». « Tout le monde parle avec admiration de l’intelligence du gouverneur, et il faut bien qu’il soit remarquablement intelligent pour gouverner ainsi une colonie », fit remarquer en 1861 Sophia Cracroft, la compagne de voyage de lady Franklin [Jane Griffin]. « D’après ce qu’on nous a dit, il a énormément lu et c’est en réalité un autodidacte comme il en existe peu. Son allure est étrange, et l’on peut y deviner l’influence de longues années passées dans un pays sauvage, où l’homme blanc est rare, mais où l’Indien apparaît au détour de chaque chemin. Il a une certaine gravité et autre chose aussi, que d’aucuns pourraient prendre et prennent pour de la suffisance, mais qui vient de ses longues années au service de la Hudson’s Bay Company dans les conditions que j’ai mentionnées [...]. » Les voyageuses estimèrent que l’épouse du gouverneur était une femme aimable, simple et bonne. « Ai je précisé que sa mère était Indienne, et qu’elle reste beaucoup (beaucoup trop) dans l’ombre ? En fait il paraît que ce n’est que tout récemment qu’on a pu la persuader de recevoir des visites ; cela vient en partie du fait qu’elle parle difficilement l’anglais, utilisant habituellement l’indien ou le français du Canada, qui est un dialecte corrompu. »
Le gouvernement britannique accorda à sir James les bénéfices qui vont normalement de pair avec les fonctions de gouverneur et paya les frais de son voyage « de retour » en Angleterre. Le 14 mai 1864, après avoir souhaité la bienvenue à ses deux successeurs, il s’embarqua pour Londres. Son fils James, qui n’avait pas de santé, était déjà parti pour l’Angleterre afin d’y faire ses études, et sa fille Jane, épouse d’Alexander Grant Dallas, vivait en Écosse. Il voulait également faire la connaissance de ses demi-sœurs et du reste de la famille de son père.
Sir James était à Paris en 1865, au retour d’un voyage en Europe, lorsqu’il apprit que sa fille Cecilia, la femme du médecin John Sebastian Helmcken*, était morte. C’était le premier vide qui se faisait autour de lui. Seulement 6 des 13 enfants de James Douglas, que sa femme avait mis au monde dans un poste de la compagnie, étaient parvenus à l’âge adulte.
Douglas était tout dévoué à sa famille, et il avait un tempérament fortement empreint de puritanisme. Il traitait sa femme avec le même respect et la même affection que McLoughlin avait, devant lui, manifestés à sa propre femme, elle aussi à demi Indienne. « Je n’ai aucune objection à ce que vous racontiez ces vieilles histoires à propos de « Hyass », dit-il gentiment à sa plus jeune fille, Martha, mais je vous prie de ne pas raconter à tout le monde que ce sont des histoires que vous a apprises maman. » Peut-être est-ce à cause de ce milieu familial qu’il avait veillé avec la plus grande sollicitude à l’éducation de ses enfants. Son fils James, trop délicat pour vivre longtemps, mourut en 1883. Des trois filles qui lui restaient, Agnes avait épousé Arthur Thomas Bushby, fonctionnaire colonial en Colombie-Britannique, et Alice, Charles Good, un de ces jeunes hommes qui étaient arrivés au moment de la ruée vers l’or, à la recherche d’un emploi. Cette union fut malheureuse et finit par une séparation en 1869. Après la mort de son père, Alice divorça. Martha épousa plus tard Dennis Harris.
La plus grande partie de la retraite de Douglas s’écoula à Victoria, à part son grand voyage en 1864 et 1865 et un autre bref séjour à l’étranger. Martha fut la joie de ses vieux jours. Lady Douglas et lui eurent peine à se décider à l’envoyer poursuivre ses études en Angleterre en 1872. Martha devait être « son intellectuelle, le vrai bas-bleu de la famille ». Elle obéit fidèlement à ses instructions : « Vous avez quantité de choses à dire, et vous devez apprendre à bien les dire, car c’est là un talent qui est aussi nécessaire aux jeunes filles qu’à n’importe qui ; par conséquent, apprenez à vous exprimer avec aisance, sans prolixité ni tautologie. [...] Veillez à vos dépenses personnelles, soyez économe. La prodigalité conduit infailliblement à la ruine. »
Durant sa retraite, sir James se livra rarement à des commentaires sur la situation politique, sauf avec sa fille Martha ou avec ses gendres, le médecin J. S. Helmcken, l’un des trois délégués qui négocièrent l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, et A. G. Dallas qui, à l’époque, était bien connu dans les milieux financiers de Londres. Regrettant l’union des deux colonies du Pacifique en 1866 et le fait que Victoria n’était plus un port franc, Douglas écrivit dans le journal de Martha : « Les navires de guerre ont salué d’une salve l’événement. Un cortège funéraire, avec le canon tiré de minute en minute, aurait été mieux approprié à ce triste moment. » En 1872, il lui écrivit, plein de tristesse : « L’île de San Juan ne nous appartient plus. Je ne peux exprimer ce que je ressens et préfère me taire. »
Nous attendons d’une minute à l’autre de savoir dans quelle situation se trouve le cabinet de sir John Macdonald [John A. Macdonald*] à Ottawa, écrit-il au moment du scandale du Pacifique. Si la motion de censure des Grits l’emporte, sir John devra donner sa démission et ce seront des ennuis et des retards à n’en plus finir pour la construction du chemin de fer. Les Grits, comme on appelle l’opposition, sont des gens de peu de valeur et de qui il n’y a rien à attendre. »
Sa petite famille et ses honorables relations en Angleterre et en Écosse lui devenaient plus chères à mesure que passaient les années. Ses visites à l’étranger semblaient lui donner chaque fois davantage le souci de laisser à ses enfants une « compétence » afin qu’ils puissent jouer leur rôle dans la société. « L’ami Douglas, écrivait le vieux John Tod en 1870, est de plus en plus préoccupé des affaires de ce monde à mesure qu’il vieillit, et l’argent l’intéresse toujours autant, malgré sa fortune qui est grande. Il est, dit-on, parfois pris de peur à l’idée de mourir dans le dénuement [...]. » Douglas fut économe jusqu’à la fin de ses jours ; en 1869, alors que ses revenus provenant de terres et de placements s’élevaient à $27 300, il ne dépensa pas plus de $5 000. En plus d’une somme en fidéicommis et d’une rente à lady Douglas, il laissa par testament une jolie fortune à son fils James et des legs à ses proches qui s’élevaient à près de $70 000. Ses propriétés, de grande valeur, demeurèrent presque intactes pendant la vie de lady Douglas, qui mourut le 8 janvier 1890.
Sir James Douglas mourut d’une crise cardiaque le 2 août 1877 à Victoria. On lui fit des funérailles officielles. À Victoria et dans toute la Colombie-Britannique, on manifesta du chagrin, comme du respect et de l’affection pour cet homme qui était devenu « le père de la Colombie-Britannique ».
Douglas, dont les nerfs étaient d’acier et la force physique prodigieuse, était doué d’une énergie étonnante et d’une vive intelligence ; homme de ressources exceptionnelles, il avait eu une carrière remarquable dans la traite des fourrures. Devenu gouverneur colonial, sa carrière fut encore plus remarquable. En dépit de circonstances nettement défavorables, ayant l’appui peu enthousiaste du gouvernement britannique, l’aide de quelques navires de guerre et de quelques soldats du Génie, il parvint à imposer l’autorité de l’Angleterre sur la côte du Pacifique et à jeter les bases de l’expansion du Canada jusqu’au littoral ouest. Seul au beau milieu de la ruée vers l’or, il avait pris des mesures relatives aux droits aux terres, aux mines et aux cours d’eaux qui étaient justes et tolérables. Il avait conservé le respect des chercheurs d’or, individualistes, gaspilleurs et animés d’un esprit de concurrence. Sa grande route de la région du Cariboo leur avait certes été utile, mais elle avait joué un rôle plus important : elle avait permis au commerce de demeurer aux mains des Anglais et, à la loi et à la justice britannique de prévaloir plus facilement. À mesure que l’or du Cariboo rentrait dans les coffres britanniques, les liens qui unissaient la colonie et la mère patrie se resserraient. À mesure que le trafic augmentait sur la route du Cariboo, il semblait moins impossible d’emprunter un jour des routes transcontinentales.
Homme pratique doublé d’un idéaliste, sir James Douglas était aussi profondément humain. Il traitait les individus, y compris les esclaves noirs et les Indiens, avec un respect dont peu de ses contemporains faisaient preuve. La majesté de son allure excita parfois la critique, mais c’est cette même prestance qui fit de lui, dans cette masse hétéroclite d’individus qu’attiraient les deux colonies du Pacifique, le symbole même de la présence vivante et bien assurée de la Grande-Bretagne sur la côte nord-ouest du continent.
Archives of the ecclesiastical province of British Columbia (Vancouver, B.C.), George Hills diary, 27 juin 1838 – 17 nov. 1895.— Gregg M. Sinclair Library, University of Hawaii, Hawaiian Coll., Sophia Cracroft Journal, 15 févr. – 3 avril 1861.— HBC Arch. A.7/2 (recueil sous scellé de lettres personnelles expédiées de Londres, 1823–1870) ; A.8/8 ; B.89/a, B.89/b, B.223/b, B.226/a, B.226/b, B.226/c ; D.5/30, D.5/32, D.5/36 (George Simpson, Correspondence inward, 1822–1860).— PABC, Fort Vancouver, Correspondence outward to HBC, 1832–1849 (copies de lettres) ; Fort Vancouver, Correspondence outward, 1840–1841 (copies de lettres) ; Fort Victoria, Correspondence outward to HBC, 1850–1855, 1855–1859 (copies de lettres) ; Vancouver Island, Governors Richard Blanshard and James Douglas, Correspondence outward, 22 juin 1850 – 5 mars 1859 (copies de lettres) ; Vancouver Island, Governor James Douglas, Correspondence outward, 27 mai 1859 – 9 janv. 1864 (copies de lettres) ; British Columbia, Governor James Douglas, Correspondence outward, 27 mai 1859 – 9 janv. 1864 (copies de lettres) ; Governor James Douglas, Dispatches to London, 1851–1855, 1855–1859 (copies de lettres) ; Governor James Douglas, Correspondence inward, 1830–1868 ; James Douglas, Account and correspondence book, 1825–1872 ; James Douglas, Correspondence outward, private, 22 mai 1867 – 11 oct. 1870 (copies de lettres) ; James Douglas, Diary of a trip to the northwest coast, 22 avril – 2 oct. 1840 ; James Douglas, Diary of a trie to California, 2 déc. 1840 – 23 janv. 1841 ; James Douglas, Diary of a trip to Sitka, 6 oct.— 21 oct. 1841 ; James Douglas, Diary of a trip to Europe, 14 mai 1864 – 16 mai 1865 ; James Douglas, Letters to Martha Douglas, 30 oct. 1871 – 27 mai 1874 ; David Cameron papers ; Jane Dallas letters ; J. S. Helmcken papers ; J. S. Helmcken, Reminiscences (5 vol., manuscrit dactylographié, 1892), V ; Archibald Macdonald, Correspondence outward, circa 1830–1849 ; John McLeod, Correspondence inward, 1826–1837 ; Donald Ross papers.— PRO, CO 60, CO 305.— University of Nottingham Library, Newcastle mss, Letter books, 1859–1864 (microfilm aux APC).
Further papers relative to the affairs of British Columbia, October 1858 to May 1859 (G.B., Parl., Command paper, 1859, Session ii, XXII, [2 578], pp. 297–408).— Further papers relative to the affairs of British Columbia, April 1859 to April 1860 (G.B., Parl., Command paper, 1860, XLIV, [2 724], pp. 279–396).— Further papers relative to the affairs of British Columbia, February 1860 to November 1861 (G.B., Parl., Command paper, 1862, XXXVI, [2 952], pp. 469–562.— HBRS, IV (Rich) ; VI (Rich) ; VII (Rich) ; XXII (Rich).— James Douglas in California, 1841 : being the journal of a voyage from the Columbia to California, Dorothy Blakey Smith, édit. (Vancouver, C.-B., 1965).— Miscellaneous papers relating to Vancouver Island, 1848–1863 [...] (G.B., Parl., House of Commons paper, 1863, XXXVIII, 507, pp. 487–540).— Papers relating to Vancouver Island and the grant of it to the HBC [...] (G.B., Parl., House of Commons paper, 1849, XXXV, 103, pp. 629–650).— Papers relative to the affairs of British Columbia, May to November 1858 (G.B., Parl., Command paper, 1859, XVII, [2 476], pp. 15–108).— Report from the select committee on the Hudson’s Bay Company ; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix and index (G.B., Parl., House of Commons paper, 1857, Session ii, XV, 224, 260).— British Columbian (New Westminster, C.-B.), 1861–1877.— Colonist (Victoria), 1858–1877.— Victoria Gazette, 1859–1860.— H. H. Bancroft, History of British Columbia, 1792–1887 (San Francisco, 1890).— Coats et Gosnell, Douglas.— F. W. Howay, The work of the Royal Engineers in British Columbia, 1858 to 1863 [...] (Victoria, 1910).— F. W. Howay et E. O. S. Scholefield, British Columbia from the earliest tunes to the present (4 vol., Vancouver, C.-B., 1914).— J. S. Galbraith, The Hudson’s Bay Company as an imperial factor, 1821–1869 (Toronto, 1957).— Morton, History of the Canadian west.— Ormsby, British Columbia.— W. N. Sage, Sir James Douglas and British Columbia (Toronto, 1930).— W. E. Ireland, James Douglas and the Russian American Company, 1840, BCHQ, V (1941) : 53–66.— Journal of Arthur Thomas Bushby (Blakey Smith).— W. K. Lamb, The founding of Fort Victoria, BCHQ, VII (1943) : 71–92 ; The governorship of Richard Blanshard, BCHQ, XIV (1950) : 1–41 ; Sir James Douglas goes abroad, BCHQ, III (1939) : 283–292 ; Some notes on the Douglas family, BCHQ, XVII (1953) : 41–51.— W. N. Sage, The gold colony of British Columbia, CHR, II (1921) : 340–359 ; Sir James Douglas, K.C.B. : the father of British Columbia, BCHQ, XI (1947) : 211–227.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Margaret A. Ormsby, « DOUGLAS, sir JAMES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/douglas_james_10F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/douglas_james_10F.html |
| Auteur de l'article: | Margaret A. Ormsby |
| Titre de l'article: | DOUGLAS, sir JAMES |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1972 |
| Année de la révision: | 1972 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |