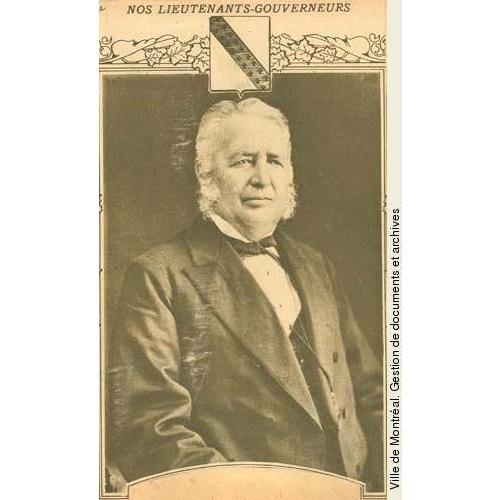CARON, RENÉ-ÉDOUARD, juriste, homme politique, deuxième lieutenant-gouverneur du Québec, né à Sainte-Anne-de-Beaupré le 21 octobre 1800 du mariage d’Élisabeth Lessard et d’Augustin Caron, cultivateur aisé qui fut député à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada, décédé le 13 décembre 1876 à Québec.
René-Édouard Caron fit ses études au collège de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (comté de Montmagny) où on enseignait les rudiments du latin, ce qui le prépara à entrer au petit séminaire de Québec, en septembre 1813, comme pensionnaire. Il y poursuivit le cours complet des humanités pour en sortir après ses deux années de philosophie en 1820. Il étudia le droit dans l’étude d’André-Rémi Hamel et il fut admis au barreau le 7 janvier 1826. Il exerça sa profession à Québec où il ne tarda pas à se tailler une bonne réputation de juriste en même temps qu’il acquérait une clientèle assez payante. En 1844, il s’associait à Louis de Gonzague Baillargé* qui avait étudié sous sa direction ; six ans plus tard les deux avocats furent nommés conjointement avocats de la ville de Québec. Les archives du petit séminaire de Québec témoignent aussi que Caron fut consulté par son alma mater. La société Caron & Baillargé fut dissoute lorsque Caron fut nommé juge de la Cour supérieure en 1853.
C’est par les institutions municipales que Caron aborda la politique. Le 31 mars 1831, la chambre d’Assemblée du Bas-Canada votait l’acte qui érigeait civilement la Cité de Québec et lui conférait le droit de s’administrer par un corps électif. Cette loi reçut la sanction royale le 5 juin 1832 (1 Guill. IV, c. 52). La ville était divisée en dix quartiers chacun ayant le droit d’élire deux conseillers. Les conseillers devaient choisir le maire entre eux lors de leur première réunion. La durée de l’application de la nouvelle loi s’étendait jusqu’au 1er mai 1836. Les premières élections eurent lieu en 1833 et Caron fut désigné comme l’un des deux représentants du quartier du Palais. Elzéar Bédard* fut élu maire mais, en mars 1834, la majorité des conseillers lui préférèrent Caron qui devint le deuxième maire de Québec jusqu’au 1er mai 1836, la loi n’ayant pas été renouvelée et Québec retombant sous la gouverne des juges de paix [V. Dubord]. Québec connut de nouveau un système municipal en 1840, par suite d’une ordonnance du Conseil spécial (4 Vict., c. 35) en vertu de laquelle le gouverneur nommait le maire. Lord Sydenham [Thomson*] choisit Caron et ce dernier fut élu, au bout de deux ans, lorsque la fonction redevint élective. Il l’abandonna en 1846.
Sous son administration, au cours de l’été de 1834, le choléra frappa durement la ville de Québec et y fit plus de 2 000 victimes. Il organisa la lutte contre l’épidémie et ne craignit pas de s’exposer personnellement à la maladie. Il était encore maire quand deux incendies successifs, en mai et en juin 1845, détruisirent la plus grande partie de la ville. Nommé président du comité de secours, il fit preuve de beaucoup de dévouement et d’esprit d’organisation.
En 1834, Caron fut élu sans concurrent député de Québec pour la Haute-Ville et, dès le début de son activité à l’Assemblée législative du Bas-Canada, il se classa parmi les libéraux modérés canadiens-français. Épousant les idées qu’Étienne Parent défendait dans le Canadien, il ne tarda pas à s’opposer à l’aile radicale dirigée par Louis-Joseph Papineau. Il vota cependant en faveur des Quatre-vingt-douze résolutions, mais on l’identifia bientôt à un petit groupe de députés, « le parti de Québec », qui se montrait favorable à une politique de conciliation. Caron et ses amis tentèrent de concrétiser cette politique, en mars 1836, à l’occasion du vote des subsides auxquels Papineau refusait de consentir. Il vota contre le chef canadien-français qui triompha dans sa politique de non-compromis. Un grand nombre des électeurs de Caron ayant, le 6 mars, présenté à Papineau une adresse dans laquelle ils l’approuvaient, se trouvant ainsi à blâmer leur député, Caron jugea nécessaire de donner sa démission.
Le 22 août 1837, le ministre des Colonies autorisait le gouverneur, lord Gosford [Acheson*], à nommer d’un seul coup dix conseillers législatifs dont sept Canadiens français. Caron était du nombre. Le conseil devait disparaître par suite de la suspension de la constitution en 1838. En 1837, Caron refusa de siéger au Conseil exécutif. En janvier 1840, lorsque fut connu le projet d’union qu’avait adopté la législature du Haut-Canada, Caron fut à Québec un des membres les plus actifs du mouvement qui, sous la direction de John Neilson*, s’y opposa. Au cours d’une réunion tenue le 17 janvier chez le notaire Louis-Édouard Glackmeyer*, on commença à organiser la lutte. Quelques jours plus tard, Caron participait à une assemblée populaire où fut lue une pétition « contre l’Union et pour la constitution de 1791 ». Avec Étienne Parent et François-Xavier Garneau*, il fut membre d’un comité d’une quarantaine de notables qui, en avril, avaient réussi à recueillir contre le projet d’union 38 928 signatures, qu’un marchand de Québec, Vital Têtu, consentit à aller présenter au parlement britannique. La nouvelle constitution n’en fut pas moins adoptée par le parlement britannique et sanctionnée le 23 juillet 1840 par la reine Victoria. Comme la plupart des Canadiens français, Caron déplora la naissance du nouveau régime mais il dut l’accepter et il ne tarda pas à participer à ses institutions. Le 14 juin 1841, il fut nommé membre du Conseil législatif de la province du Canada dont il fut président du 8 novembre 1843 au 19 mai 1847 et du 11 mars 1848 au 14 août 1853.
À la présidence du conseil, Caron remplaça Robert Sympson Jameson*, qui avait démissionné en signe de protestation contre la décision favorisée par le gouvernement et prise par le parlement de transporter le siège de la capitale de Kingston à Montréal. Le choix de Caron, par le gouverneur sir Charles Theophilus Metcalfe*, qui avait été précédé par des tractations avec Peter McGill* et John Neilson, fut d’abord regardé par le gouvernement de Louis-Hippolyte La Fontaine* et de Robert Baldwin* comme un nouveau geste posé par le gouverneur sans consulter ses ministres mais il fut assez difficile pour La Fontaine de s’y opposer à cause des qualités personnelles de Caron, que la Minerve du 9 novembre 1843 appelait « un des nôtres ».
La coupure de dix mois dans la présidence de Caron fut provoquée par sa participation à des pourparlers politiques menés en 1845, 1846 et 1847. Ces négociations qui, à l’époque, soulevèrent beaucoup de passion, naquirent du désir de faire entrer dans le gouvernement tory des représentants du Bas-Canada et préludèrent en définitive à la reconnaissance de la responsabilité ministérielle dans la province du Canada. Déjà, le 10 mars 1844, Denis-Benjamin Viger*, qui tentait de former un ministère à la suite de la démission du gouvernement de La Fontaine et de Baldwin, avait offert à Caron le poste de procureur général du Bas-Canada. Il aurait été obligé de se faire élire à l’Assemblée, mais on lui promit qu’advenant sa défaite il rentrerait de nouveau au Conseil législatif. Caron refusa l’offre mais on le considérait comme un modéré avec lequel il était plus facile de traiter qu’avec La Fontaine. Les premiers pourparlers eurent lieu au début de juillet à Québec et au début d’août à Montréal, entre Caron et William Henry Draper, regardé comme conservateur et plutôt opposé aux réformistes du Bas-Canada que dirigeait La Fontaine. Draper fit connaître à Caron son désir que d’autres Canadiens français en plus de ceux qui y étaient déjà fassent partie de l’administration. Il aurait, en particulier, mentionné Augustin-Norbert Morin*, laissant expressément de côté La Fontaine en raison des difficultés personnelles qui existaient entre ce dernier et le gouverneur Metcalfe. Caron, fidèle aux sentiments modérés qui l’animaient déjà, accepta de servir d’intermédiaire, mais ce n’est que le 8 septembre qu’il écrivit à La Fontaine pour lui communiquer les offres que faisait Draper de quelques portefeuilles pour les réformistes du Bas-Canada. Caron terminait sa lettre par ces lignes révélatrices : « Je dois vous dire que je suis d’avis que l’état dans lequel nous sommes ne peut pas durer. Ce qu’on nous offre est peu de chose, mais ce pourrait être le commencement de quelque chose de mieux. Il est très possible que je voie mal les choses, mais il me semble que cette ouverture vaut bien la peine qu’on y réfléchisse ; je vous la communique dans cette vue afin que vous y pensiez avec liberté de la communiquer, mais la chose doit être faite avec réflexion. » Deux jours plus tard, La Fontaine répondait par une lettre, qui, d’après l’historien Thomas Chapais*, « constitue un document capital pour l’histoire constitutionnelle de cette époque ». « Ce que l’on nous propose, écrivait La Fontaine, est une répudiation du principe de la responsabilité, en tant qu’il s’agit de son application au Bas-Canada. Puisque M. Draper admet que la section bas-canadienne du ministère ne représente pas le Bas-Canada, pourquoi la maintenir ? Pourquoi, suivant vos principes ne pas former une nouvelle administration pour le Bas-Canada, à l’aide de quelqu’un qu’on chargerait constitutionnellement de le faire ? » Caron écrivit à Draper, le 17 septembre, pour lui communiquer ce qu’on pouvait regarder comme le refus de La Fontaine et dans sa lettre il fut un des premiers à énoncer ce qui devait être reconnu plus tard comme le principe de la « double majorité ». « Il a été posé en principe, écrivait-il, que la direction des affaires devait être entre les mains des deux partis dominants dans chacune des sections de la province, que l’administration ne devait pas plus conduire le Bas-Canada au moyen d’une majorité prise dans le Haut qu’elle ne doit imposer la loi à la majorité du Haut-Canada, par suite de l’aide que lui donnerait le Bas, et qu’une administration quelconque ne devait durer que tant qu’elle serait soutenue par une majorité respective dans chacune des sections de la province. » Les négociations se continuèrent, pour se terminer sans résultat en novembre 1845, lorsque Draper informa Caron que, Metcalfe se voyant forcé par la maladie d’abandonner son poste, la situation était changée, ce qui peut laisser supposer que le gouverneur n’était pas étranger aux démarches de l’homme politique du Haut-Canada.
Les négociations Draper-Caron, restées plus ou moins secrètes, devaient au commencement d’avril 1846 faire l’objet d’un débat parlementaire au cours duquel La Fontaine donna lecture de toute la correspondance entre Draper, Caron et lui-même ; ce geste jeta un froid entre Caron et La Fontaine. Dans Dix ans au Canada de 1840 à 1850 [...], Antoine Gérin-Lajoie* écrit : « Ce que regrettèrent quelques amis de M. Caron, lorsque toute la correspondance fut publiée, ce fut de voir que dans une lettre à M. Draper, en date du 8 septembre 1845, il se montrait désireux de voir une réaction s’opérer en faveur du gouvernement de sir Chs Metcalfe, sentiment qu’il avait laissé ignorer à M. La Fontaine. Ce dernier ne put s’empêcher de dire publiquement que s’il eut eu connaissance de cette lettre, sa correspondance avec M. Caron aurait été immédiatement discontinuée. »
En août 1846, deux mois après la démission de Viger, Draper tenta de nouveau, mais sans succès d’engager Caron et Morin à entrer dans une coalition analogue à celle qu’il avait proposée l’année précédente. Dans une lettre adressée le 28 août 1846 à la Revue canadienne, Morin écrivait : « Je dois dire sans restriction au sujet des négociations récentes entre le gouvernement provincial d’une part et M. Caron et moi de l’autre, que dans toute cette affaire les démarches de M. Caron et les miennes ont été aussi honorables que j’ai désiré que les miennes le fussent. »
La troisième tentative de négociations avec Caron eut lieu en avril 1847 alors que lord Elgin [Bruce*], nommé gouverneur l’année précédente, voulut régler une situation bizarre qui faisait que les Canadiens français n’étaient représentés dans le gouvernement que par Denis-Benjamin Papineau*, auquel la majorité parlementaire du Bas-Canada était hostile. Papineau et William Cayley*, inspecteur général dans le gouvernement, offrirent à Caron la présidence du Conseil exécutif. Ce dernier fut près de succomber à l’invitation mais il semble avoir été prévenu de le faire par les conseils de son ami Morin, et par le désir de voir La Fontaine arriver au pouvoir, ainsi qu’en témoigne une lettre, datée du 11 avril 1847, de Thomas Cushing Aylwin à La Fontaine : « Je crois sincèrement que Caron veut faire quelque chose de bon, et qu’il désire votre rappel au pouvoir. »
Quoi qu’il en soit, Caron fut destitué de la présidence du Conseil législatif après qu’on lui eut laissé entendre que le poste devait appartenir à un homme politique ayant la confiance du gouvernement, et il fut remplacé par Peter McGill. À la session suivante, en juin 1847, il prononça un long discours en faveur d’une série de résolutions proposées par John Neilson dans lesquelles on soutenait que la population française n’était pas suffisamment représentée dans le cabinet. Il rappela toutes les tractations auxquelles il avait été mêlé et il termina par ces mots : « Je suis certain de n’avoir rien fait qui me pût attirer la perte de mon siège ; si j’ai quelque chose à me reprocher, c’est d’avoir mis ma confiance dans le ministère. Si on avait agi ainsi pour le bien du pays, ou même si c’eût été d’une manière polie, j’aurais été satisfait ; mais tant que le ministère ne montrera pas qu’il avait de bonnes raisons de me traiter ainsi, je dirai que sa conduite est injustifiable. Quand j’acceptai la place d’Orateur [président] du Conseil, je stipulai qu’elle ne serait point politique. J’ai abandonné pendant quatre ans mes affaires et je considère que le ministère n’a aucun droit de m’ôter cette place sans m’offrir ce qu’il donne à tout officier du gouvernement qui est privé de son emploi. »
Après la session de 1847, au cours de l’été, on fonda à Québec une association politique appelée « Comité constitutionnel de la réforme et du progrès » dont Caron fut élu président. L’association lança, au début de novembre, un manifeste contre le gouvernement dont une résolution réclamait que les principaux aviseurs du gouverneur fussent des « hommes jouissant de la confiance des représentants du peuple ». Aux élections de décembre 1847 qui se terminèrent au début de janvier 1848, le parti réformiste obtint une majorité dans les deux parties du pays. Caron retrouva son poste de président du Conseil législatif et il entra en même temps dans le ministère La Fontaine-Baldwin. À la session de 1849, il fut parmi ceux qui, à la Chambre haute, appuyèrent chaleureusement le projet de loi pour l’indemnisation des pertes subies par les personnes du Bas-Canada pendant les insurrections de 1837 et de 1838. À l’occasion d’un remaniement ministériel qui eut lieu en novembre 1849, Caron quitta le gouvernement comme représentant de la région de Québec et il fut remplacé par un avocat de Québec, Jean Chabot*, à titre de commissaire en chef des Travaux publics. Il demeura cependant à la présidence du Conseil législatif. Quelques semaines auparavant il avait signé le manifeste loyaliste que publia la Minerve du 15 octobre et qui s’opposait au Manifeste des annexionnistes ; le document commençait par cette proclamation de foi : « Sincèrement attachés aux institutions que la mère patrie a depuis peu reconnues et convaincus que ces institutions sont suffisantes pour nous assurer, au moyen d’une législation sage et judicieuse, un remède prompt et efficace à tous nos maux dont la province puisse se plaindre, nous croyons devoir nous empresser à protester d’une manière publique et solennelle contre les opinions énoncées dans ce document. »
Caron, toujours à titre de président du Conseil législatif, entra le 28 octobre 1851 dans le gouvernement de Francis Hincks* et de Morin. Il y demeura jusqu’au 15 août 1853 alors qu’il fut nommé juge de la Cour supérieure pour y remplacer Jean-Baptiste-Édouard Bacquet, décédé. Le 29 janvier 1855, il devint juge de la Cour d’appel à la suite du décès du juge Philippe Panet*.
Le juge Caron fit partie de la Cour spéciale créée sous l’autorité de l’acte seigneurial de 1854 et que présida le juge en chef Louis-Hippolyte La Fontaine. Avec d’autres juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure, il se prononça le 11 mars 1856 sur les problèmes de droit qui leur avaient été soumis. Chaque juge eut le droit de formuler séparément ses observations, ce que fit le juge Caron ; ses remarques furent publiées en 1856 dans les Décisions des tribunaux du Bas-Canada ; questions seigneuriales. Il y fait une étude assez fouillée sur les trois problèmes suivants : nature et étendue du droit de propriété des seigneurs du pays sur leurs fiefs et seigneuries ; nature et étendue de leur droit de banalité ; propriété des rivières et eaux courantes, tant celles qui sont navigables que celles qui ne le sont pas.
Le nom de Caron est resté étroitement lié à la codification du droit civil du Bas-Canada. Le 27 avril 1857, George-Étienne Cartier présentait à l’Assemblée législative de la province du Canada l’« acte pour pourvoir à la codification des lois du Bas-Canada qui se rapportent aux matières civiles et à la procédure ». Le projet devint loi le 10 juin suivant (20 Vict., c. 43). On y prévoyait que le gouverneur nommerait trois personnes à titre de commissaires pour « réduire en un code qui sera appelé le Code civil du Bas-Canada les dispositions des lois du Bas-Canada qui se rapportent aux matières civiles et qui sont d’un caractère général et permanent, soit qu’elles se rattachent aux affaires de commerce ou à des affaires de tout autre nature ». Une fois cette tâche terminée, les commissaires devaient réduire en « un autre code qui sera appelé le Code de procédure civile du Bas-Canada, les dispositions des lois du Bas-Canada qui se rapportent à la procédure en matière et causes civiles et sont d’un caractère général et permanent ». Les deux codes devaient s’inspirer autant que possible de la structure des codes français « connus sous les noms de code civil, code de commerce et code de procédure civile ». Le préambule de la loi rappelait les raisons d’entreprendre la codification. Les lois civiles en vigueur dans le Bas-Canada découlaient, pour la plus grande partie, de la Coutume de Paris, qui s’était appliquée en Nouvelle-France et dont l’acte de Québec avait assuré le maintien. Ces lois avaient toutefois été modifiées par des lois d’origine anglaise si bien qu’on n’avait pas toujours de bonnes versions comparables dans les deux langues utilisées devant les tribunaux. La France, en codifiant son droit au début du siècle, avait donné l’exemple au Bas-Canada qui pouvait aussi s’inspirer du dernier code civil que la Louisiane s’était donné en 1825. Par ailleurs, la codification française avait tari les commentaires des lois antérieures à la révolution et, dans certains cas, il semblait nécessaire de modifier les règles anciennes.
Le 28 novembre 1857, Cartier s’adressa d’abord au juge en chef du Bas-Canada, Louis-Hippolyte La Fontaine, pour lui confier la direction de la commission mais il refusa en ces termes : « de trop fortes raisons s’y opposent ; la première qui est la seule qu’il me suffit de donner, est l’état de ma santé ». Le 4 février 1858 les trois commissaires suivants étaient nommés par le gouvernement : René-Édouard Caron, Augustin-Norbert Morin et Charles Dewey Day*, ces deux derniers étant juges de la Cour supérieure. Dans les lettres de nomination, le secrétaire provincial leur demandait de consacrer tout leur temps au travail de codification à compter du 1er avril, ce qui signifiait qu’ils devaient abandonner toutes les causes qu’ils avaient entendues. Le juge Caron ne fut pas nommé officiellement président de la commission mais il agit comme tel. Les commissaires se réunirent la première fois à Québec, le 20 mai 1858, et ils furent autorisés à louer un bureau dans une maison appartenant à Caron. Le 10 juin, eut lieu une nouvelle réunion « aux fins de s’entendre sur le meilleur plan à suivre » et on distribua le travail entre les commissaires et les secrétaires.
La nomination de Caron souleva une brève controverse dont témoignent les journaux québécois de mars 1859. Le juge prétendit qu’il n’avait accepté d’être membre de la commission qu’à la condition de pouvoir rendre jugements dans les causes qu’il avait entendues. Ses deux collègues soutinrent qu’il n’avait pas le droit de siéger et il se rendit finalement à leur argumentation. Lorsque Morin mourut, en 1865, Joseph-Ubalde Beaudry le remplaça comme commissaire et il eut comme successeur au poste de secrétaire Louis-Siméon Morin. En 1862, Thomas Kennedy Ramsay*, un des secrétaires de la commission, fut démis de son poste pour des raisons politiques et on le remplaça par Thomas McCord*.
Caron rédigea des « Notes sur le plan à suivre dans les travaux préparatoires de la codification » mais c’est au juge Day que fut confiée la rédaction du premier rapport consacré aux obligations. Le 12 octobre 1861, les commissaires le soumettaient au gouvernement. Les autres rapports devaient s’échelonner jusqu’au 25 novembre 1864 alors que fut remis le rapport sur les lois commerciales. Les recommandations des codificateurs furent ensuite présentées au parlement par le gouvernement et elles firent l’objet d’une loi adoptée en 1865 (29 Vict., c. 41). Caron et ses collègues travaillèrent ensuite à la rédaction du code de procédure civile qui entra en vigueur le 28 juin 1867. Les deux codes ne furent pas uniquement l’œuvre de Caron mais parmi les codificateurs il fut certainement celui qui les marqua davantage par sa science du droit et l’équilibre de son jugement.
Caron retourna ensuite à l’exercice de sa fonction de juge et, le 14 février 1873, il était nommé lieutenant-gouverneur du Québec pour succéder à Narcisse-Fortunat Belleau*, le premier titulaire de la fonction. Il adopta comme devise les mots latins suivants, « suaviter in modo fortiter in re ». Il remplit sa charge avec beaucoup de dignité. Il donna à la résidence de Spencer Wood, que son prédécesseur n’avait guère habitée, un cachet vice-royal. Très pieux, il voulut y avoir une chapelle où la messe fut célébrée la première fois le 23 octobre 1873. Caron mourut le 13 décembre 1876 et ses funérailles eurent lieu à la basilique de Québec, le 20 décembre suivant. Les journaux se plurent à souligner le fait que la ville de Québec n’avait pas été témoin depuis plus d’un siècle des funérailles d’un chef d’État. L’oraison funèbre fut prononcée par le grand vicaire Thomas-Étienne Hamel, qui rappela la piété du disparu et souligna qu’à Spencer Wood « la prière du soir et le chapelet se récitaient par le lieutenant-gouverneur », probablement comme cela se faisait à Sainte-Anne-de-Beaupré pendant l’enfance du jeune paysan. Caron était resté profondément attaché à son village natal, lieu célèbre de pèlerinage et, peu de temps avant sa mort, le 26 juillet 1875, il avait présenté au nom de plusieurs souscripteurs, en présence de 7 000 pèlerins, une bannière de procession à l’église de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il fut enterré au cimetière Belmont.
Le 10 juillet 1865, Caron avait reçu de l’université Laval le titre de docteur en droit honoris causa. Le 24 novembre 1875 il avait été promu au grade de grande-croix de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand. Le 20 juin 1848 il avait été fait conseiller de la reine. Il avait été officier dans la milice, lieutenant le 6 décembre 1825, et capitaine dans le bataillon d’artillerie de Québec le 30 décembre 1837. Le 15 septembre 1853, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec le remerciait des « services importants » qu’il avait rendus à cette société comme son second président de 1842 à 1852.
Le 16 septembre 1828, Caron avait épousé, à Notre-Dame de Québec, Marie-Vénérande-Joséphine Deblois, fille de Joseph Deblois et de Marie-Vénérande Ranvoyzé. Ils eurent plusieurs enfants dont Joseph-Philippe-René-Adolphe*, ministre dans les cabinets de John Alexander Macdonald*, John Joseph Caldwell Abbott* et Mackenzie Bowell*, Corine, épouse de sir Charles Fitzpatrick* et Marie-Joséphine, épouse de Jean-Thomas Taschereau* et mère de Louis-Alexandre*, futur premier ministre du Québec.
Parmi les personnages de second plan sous l’Union, Caron occupe une des premières places. Jusqu’à un certain point, il représente les sentiments modérés de sa région, ayant un désir sincère d’en arriver à des compromis pour tenter de profiter de l’Union, mais il ne céda jamais sur les principes qu’il regardait comme essentiels. Il a été un des artisans de la conquête de la responsabilité ministérielle et, d’autre part, ses connaissances juridiques lui ont permis de mener à bien l’œuvre importante de la codification. Louis-Philippe Turcotte semble avoir bien traduit le jugement de ses contemporains lorsqu’il écrivit à sa mort : « Sa carrière a été utile à son pays. Il a toujours été droit son chemin, uniquement guidé par sa conscience et le sentiment du devoir. »
On trouve les papiers de Caron aux ANQ, et aux ASQ, Fonds Caron, 1–4 et mss, 764–817. Ils sont formés d’un certain nombre de lettres personnelles et officielles, de cahiers de comptes et surtout de documents qui ont servi à la codification. Un inventaire succinct en a été dressé dans une étude du professeur J. E. C. Brierley, Quebec’s civil law codification ; viewed and reviewed, McGill Law Journal (Montréal), XIV (1968) : 521–589.
La correspondance entre Caron, Draper et La Fontaine a été publiée : Correspondance entre l’Hon. W. H. Draper et l’Hon. R.-É. Caron ; et entre l’Hon. R.-É. Caron, et les honorables L.-H. Lafontaine et A.-N. Morin, dont il a été question dans un débat récent dans l’Assemblée législative (Québec, 1846). Cette correspondance a aussi été publiée en anglais la même année.
Aucune véritable biographie de Caron n’a été écrite. Celle que publiait le Journal de Québec, 14 déc. 1876, signée L.T., au lendemain de la mort du lieutenant-gouverneur, n’était que la reproduction, avec quelques variantes de circonstances, d’une brochure de L.-P. Turcotte, L’honorable R.-É. Caron, lieutenant-gouverneur de la province de Québec (Québec, 1873). On se réfère souvent à la biographie de Caron de Le Jeune, Dictionnaire, I, mais elle est très incomplète. Elle s’inspire d’ailleurs d’une biographie plus complète de Dent, Canadian portrait gallery, I.
Les ouvrages généraux sur l’Union parlent abondamment de Caron : Chapais, Histoire du Canada, V, VI ; Dent, Last forty years ; Antoine Gérin-Lajoie, Dix ans au Canada de 1840 à 1850 ; histoire de l’établissement du gouvernement responsable (Québec, 1888) ; Turcotte, Canada sous l’Union ; Monet, Last cannon shot. Ce dernier ouvrage, le plus récent, place bien Caron dans sa véritable perspective. [j.-c. b.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
J.-C. Bonenfant, « CARON, RENÉ-ÉDOUARD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/caron_rene_edouard_10F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/caron_rene_edouard_10F.html |
| Auteur de l'article: | J.-C. Bonenfant |
| Titre de l'article: | CARON, RENÉ-ÉDOUARD |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1972 |
| Année de la révision: | 1972 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |


![Titre original : [L'Honorable R. E. Caron] [image fixe] / L. P. Vallée (Louis Prudent)](/bioimages/w600.3466.jpg)