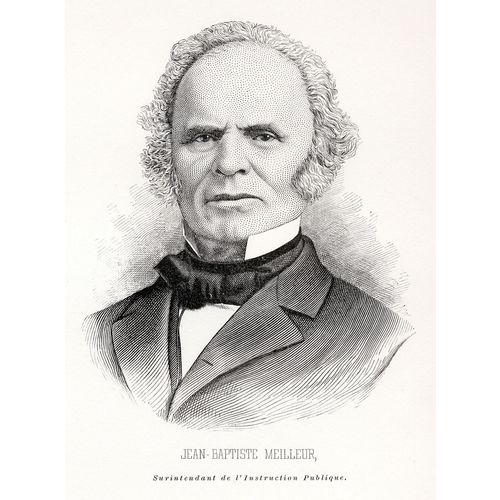MEILLEUR, JEAN-BAPTISTE, médecin, éducateur, fondateur du collège de L’Assomption, député, premier surintendant de l’éducation du Bas-Canada, né le 8 mai 1796 à la Petite-Côte, paroisse Saint-Laurent (Île-de-Montréal), du mariage de Jean Meilleur et de Marie-Suzanne Blaignier, décédé à Montréal, le 6 décembre 1878.
Fils unique, Jean-Baptiste Meilleur avait 14 mois quand son père mourut. Sa mère se remaria en 1798 et ses grands-parents paternels l’élevèrent. On ne sait de quelle façon il fit ses études élémentaires. Une tradition familiale veut qu’à 19 ans il ait réalisé son héritage et se soit inscrit au collège de Montréal pour y faire ses études classiques au milieu de condisciples plus jeunes que lui. Il y connut un jeune Américain converti, John Holmes*, natif du Vermont, futur professeur au petit séminaire de Québec. Meilleur désirait devenir avocat mais Holmes lui conseilla d’aller étudier la médecine en Nouvelle-Angleterre.
Il quitta le collège, fréquenta une école anglaise de Montréal, s’inscrivit en 1821 à la Castleton Academy of Medicine (Vermont), qui était affiliée au Middlebury College de Montpelier (Vermont), et suivit les cours de science et de médecine de ces deux institutions. La chimie et la botanique y étaient enseignées par un pédagogue célèbre, Amos Eaton, tandis que Frederick Hall, qui exerça sur Meilleur une grande influence, y enseignait la physique expérimentale et la minéralogie. Le 18 novembre 1824, Meilleur soutint une thèse, « On scrofula », qui lui valut le doctorat en médecine conféré en 1825 par Middlebury College, alors qu’il était inscrit, comme étudiant gradué, à Dartmouth College à Hanover (New Hampshire). Pendant son séjour à Middlebury et à Hanover, Meilleur donna des leçons privées de français et publia en 1825 A treatise on the pronunciation of the French language [...], ainsi que plusieurs autres courts ouvrages également introuvables aujourd’hui. Ce séjour aux États-Unis fut bénéfique à Meilleur. Il remarqua le zèle que déployaient les habitants de ce pays pour l’instruction publique en regard du peu de cas qu’on en faisait dans le Bas-Canada. De plus, il acquit des connaissances scientifiques qui serviraient à éduquer ses compatriotes.
De retour au Canada, Meilleur s’établit à L’Assomption en février 1826. Le Bureau des examinateurs en médecine lui accorda son permis le mois suivant et il commença sa pratique médicale qu’il mena de pair avec ses activités éducatives, scientifiques et politiques. Le 26 juin 1827, il épousa à Repentigny, Joséphine Éno, dit Deschamps. De ce mariage naquirent dix enfants, dont Joséphine-Charlotte qui épousa Georges-Isidore Barthe*.
Durant les 15 années qu’il vécut à L’Assomption, Meilleur pratiqua la médecine et participa activement à la vie publique. Il acquit bientôt une honnête aisance et ses diverses fonctions officielles lui valurent une solide réputation de citoyen éclairé. En 1827, il reçut une commission de lieutenant dans le 1er bataillon de milice de Leinster (comté de L’Assomption) et, cinq ans plus tard, celle de chirurgien du 2e bataillon de milice de Berthier (comté de Berthier). Choisi en 1831 membre du Bureau des examinateurs en médecine, il fut nommé recenseur et juge de paix du comté de Leinster, et, en 1834, il devint maître de poste à L’Assomption. Dès 1827, il s’était occupé activement des élections à la chambre d’Assemblée et, en novembre 1834, il fut élu, en même temps que Édouard-Étienne Rodier*, député du comté de L’Assomption jusqu’en 1838.
L’aventure politique de Meilleur fut de courte durée, mais ce fut dans l’atmosphère enfiévrée qui précéda la rébellion de 1837 qu’il siégea à la chambre d’Assemblée. Son collègue Rodier, un des membres les plus en vue du parti patriote, veilla, sans y réussir, à ce que Meilleur, qui passait pour un modéré, ne suivît pas ceux qui se détachèrent de Louis-Joseph Papineau. Lorsque le tribun vint haranguer les collégiens de L’Assomption, Meilleur répliqua vertement à ses appels enflammés. Sympathique à la cause des Patriotes, il réprouvait leurs appels à la violence et il parcourut toutes les paroisses de son comté pour exhorter la population à obéir au mandement de Mgr Jean-Jacques Lartigue*.
Siégeant aux comités permanents de la chambre sur l’éducation, les hôpitaux et les institutions charitables, Meilleur contribua à l’adoption de la loi créant des écoles normales. Mais l’opposition du Conseil législatif empêcha le renouvellement de la loi des écoles élémentaires de 1829, forçant ainsi quelque 1 300 écoles à fermer leurs portes. Meilleur fit aussi voter l’achat du musée que Pierre Chasseur avait créé et il fut chargé du classement de la collection d’animaux que Chasseur avait placés dans leur habitat naturel. Ce musée fut presque complètement détruit dans l’incendie qui ravagea le Parlement de Québec en 1854.
L’intérêt de Meilleur pour l’éducation et les sciences se manifesta parallèlement par les nombreuses lettres et par les articles qu’il fit paraître à partir de 1826 dans la Minerve de Montréal dont il était le correspondant, la Bibliothèque canadienne de Michel Bibaud*, l’Écho du Pays et le Glaneur de Saint-Charles-sur-Richelieu. Il écrivit sur la chimie, l’économie domestique, l’eau saline de L’Assomption, la géologie, l’agriculture, la mouche hessoise ; il fit paraître en 1826 et en 1827, dans le Journal de médecine de Québec, le premier journal canadien de médecine, deux articles, l’un intitulé « On Prussic acid » et l’autre, « On scrofula », qui était sa thèse de doctorat. Meilleur commença en 1828, dans la Minerve, la publication de lettres sur l’éducation, qui provoquèrent une longue polémique, entretenue par lui-même qui signa quelques-unes de ses lettres de divers pseudonymes. Il préparait ainsi les esprits à la fondation d’un collège à L’Assomption où il était devenu syndic des écoles paroissiales créés par la loi de 1829. Il se chargea de donner régulièrement chaque semaine, dans les écoles du village, des explications et des exercices de grammaire, d’arithmétique et de géographie. En 1833, il publia une Nouvelle grammaire anglaise et son Cours abrégé de leçons de chymie, qui parut à Montréal. Destiné à la jeunesse des écoles, ce dernier ouvrage fut le premier du genre rédigé par un Canadien et publié au Canada. Ayant enfin gagné à sa cause le curé de la paroisse, l’abbé François Labelle, et son confrère le docteur Louis-Joseph-Charles Cazeneuve, il fonda avec eux le collège de L’Assomption, qui ouvrit ses portes en 1834. Les fondateurs, les frères du curé et quelques amis souscrivirent les fonds requis pour sa construction et Meilleur obtint de la chambre d’Assemblée une subvention pour son fonctionnement. L’enseignement y suivait le système mutuel de Lancaster, très en vogue à cette époque (sous la direction du maître, les élèves les plus avancés enseignaient aux plus jeunes). Sauf le curé Labelle, les professeurs étaient tous laïques [V. Dupuy] ; les élèves pensionnaires, ainsi que les professeurs, prenaient leurs repas au presbytère.
L’état lamentable de l’éducation dans le Bas-Canada et les moyens d’y remédier furent l’une des préoccupations de lord Durham [Lambton*]. Aussi émit-il en juillet 1838 des lettres patentes publiées dans les journaux, commettant Arthur Buller*, qui faisait partie de son personnel administratif, pour « s’enquérir et s’informer des modes passés et présents de disposer de tous biens ou fonds destinés ou applicables à l’éducation dans la dite province du Bas-Canada ». Meilleur répondit à cette invitation. Un échange de lettres commença le 3 août 1838 dans le Populaire de Montréal ; une première signée des initiales A.B. fut suivie d’une réponse signée C.D. dont Meilleur revendiqua la paternité, disant aussi que celle signée A.B. était d’Arthur Buller. Il exposa dans quatre lettres, que reproduisit le Canadien de Québec, des projets en vue d’organiser et de soutenir financièrement l’instruction publique depuis l’école élémentaire jusqu’au collège classique. A.B. fit paraître trois lettres et d’autres correspondants prirent part à cette intéressante discussion à laquelle Meilleur répondit dans une cinquième lettre.
Opposé au prélèvement d’un impôt foncier en raison de la pauvreté et même de la misère des habitants, Meilleur, dans ses lettres, propose, au moins pour les débuts, la gratuité de l’enseignement élémentaire. Pour en solder le coût, on utiliserait les biens des jésuites, qui serviraient surtout à subventionner les collèges classiques dont il désire que la direction et l’enseignement soient réservés au clergé. Il suggère d’augmenter les droits de douane sur le tabac, les boissons et les spiritueux, et le prix des permis des aubergistes. Enfin, on affecterait à l’éducation les épargnes réalisées en diminuant les salaires énormes de certains fonctionnaires.
Dans sa deuxième lettre, Meilleur analyse les causes de la triste situation de l’enseignement : apathie, ignorance et préjugés d’un trop grand nombre d’habitants, mauvaise administration des syndics parfois illettrés, incompétence et mauvaises mœurs de trop d’instituteurs, émoluments dérisoires des maîtres d’école. Dans la troisième, il décrit l’organisation scolaire qu’il préconise. Il prévoit quatre degrés : enseignement classique préparant au sacerdoce et aux professions ; enseignement académique comprenant des écoles modèles, analogues aux high schools qu’il a admirés aux États-Unis, et préparant au commerce, aux affaires, au cours classique et, au besoin, formant des maîtres pour l’école élémentaire ; des écoles normales pour la formation des instituteurs. L’école élémentaire serait obligatoire et Meilleur veut que, dans dix ans, personne ne puisse occuper un emploi public s’il n’a pas au moins ce degré d’instruction. Des bureaux d’examinateurs décerneraient les brevets d’instituteurs, et des visiteurs verraient au bon fonctionnement pédagogique et financier des écoles administrées par des syndics élus par toutes les parties de la paroisse. Intimement convaincu du succès d’une loi de ce genre, il est prêt à en partager toute la responsabilité.
Les observations de Meilleur furent bien accueillies par lord Durham qui en fit une mention élogieuse dans son célèbre Rapport, mais le projet ne correspondait pas à ses vues. Lorsque l’Union des deux Canadas fut un fait accompli, l’avocat montréalais Charles-Elzéar Mondelet fit paraître dans The Canada Times de novembre et décembre 1840, une série de lettres. Il y proposait des écoles communales où l’enseignement religieux serait fait sous la surveillance des ministres des divers cultes et qui seraient financées par un impôt foncier, la création de districts scolaires administrés par des commissaires dont les uns seraient élus et les autres désignés par l’inspecteur du district, le tout sous la juridiction d’un surintendant nommé par le gouverneur. Le projet fut mal reçu par les autorités religieuses ; cependant la loi de l’éducation de 1841 fut en partie basée sur les propositions de Mondelet dont chacun croyait qu’il serait nommé surintendant de l’éducation. Mais lorsqu’il fut nommé juge par le gouverneur, sir Charles Bagot*, Meilleur sollicita le poste de surintendant. Bagot, jugeant qu’un seul homme ne pouvait remplir cette charge convenablement, nomma en 1842 un surintendant non rémunéré, responsable au parlement, et deux surintendants adjoints : Meilleur pour le Bas-Canada, et le révérend Robert Murray* pour le Haut-Canada.
Meilleur qui pratiquait la médecine à Montréal depuis 1840 était tout désigné pour remplir les fonctions qu’on lui confiait. Bilingue, intègre, il avait acquis une précieuse expérience en matière d’éducation. Il lui fallait cependant mettre en marche, dans des conditions déplorables et dans le climat politique malsain des premières années de l’Union, une loi qui allait contre ses convictions. La loi de 1841 concernait à la fois les écoles et les municipalités rurales et, en pratique, confondait les conseils municipaux et les commissions scolaires qui en étaient comme une émanation. Les membres de ces commissions, élus par les contribuables des districts scolaires, devaient administrer les écoles tandis que les maires et les trésoriers des municipalités, nommés par le gouverneur, recevaient les subventions versées par le surintendant pour les écoles et étaient autorisés à imposer et à percevoir les taxes scolaires aussi bien que municipales. Le peuple, qui n’en avait jamais payé, détestait d’autant plus l’impôt qu’il lui était infligé par des fonctionnaires non élus. Cette loi ne prévoyait pas de frais d’établissement, d’entretien et de personnel pour le bureau du surintendant adjoint qui dut en outre se contenter d’un salaire inférieur à celui de son homologue du Haut-Canada. Dans ces conditions dont il se plaignit sans cesse, Meilleur dut d’abord faire revivre des écoles fermées depuis six ans et en créer d’autres, sachant qu’il n’y avait pas assez d’instituteurs compétents pour satisfaire à la demande. Il n’avait en pratique aucune autorité pour imposer des programmes scolaires et des manuels, non plus que pour contrôler le choix des maîtres d’école.
Pendant les 13 années que dura son administration, Meilleur dut faire observer sept versions différentes de la loi des écoles. Celle de 1845, corrigeant quelques anomalies de la loi originale, fit de Meilleur le surintendant de l’éducation pour le Bas-Canada et mit la paroisse plutôt que la municipalité à la base du système scolaire. De plus, la loi remplaça l’impôt obligatoire par une contribution volontaire dont Meilleur prévoyait que la perception serait difficile et incertaine. En 1846, une loi créa les commissions scolaires de paroisse, dont les membres, élus par les propriétaires fonciers, devaient prélever par cotisation un montant égal à celui de la subvention accordée par le surintendant. Un bureau d’examinateurs devait approuver les manuels scolaires et les certificats des instituteurs mais les commissaires engageaient ces derniers et pouvaient déterminer les programmes en usage dans leurs écoles. On a dit de cette loi qu’elle était la grande charte de l’instruction publique du Québec mais les contemporains ne la prirent pas de cette façon. Les habitants des campagnes, spontanément ou à l’instigation de démagogues, dont plusieurs députés, n’y virent que le spectre redouté de l’impôt et c’est ainsi que commença ce qu’on a appelé la « guerre des éteignoirs ». Les parents retirèrent les enfants des écoles, on sabota l’élection des commissaires, on intimida les notables et les membres du clergé qui appuyaient le surintendant et le gouvernement ; on incendia des écoles. Il fallut, en certains endroits, demander au gouvernement de faire appel à la milice pour rétablir l’ordre. Ces troubles durèrent jusque vers 1850 alors que, devant la ferme attitude du surintendant, du clergé et des autorités civiles, la population des campagnes se calma et reconnut les bienfaits que l’instruction pouvait lui apporter. Les lois de 1849 et 1851 n’apportèrent à Meilleur qu’une partie de ce qu’il réclamait depuis longtemps : des visiteurs puis des inspecteurs d’écoles, qu’il fit nommer immédiatement, et la création d’écoles normales qui ne virent le jour que sous l’administration de son successeur.
Surtout dans les débuts de son administration, Meilleur avait raison de dire qu’ayant dû lutter sans cesse contre des difficultés et des obstacles indépendants de sa volonté, il avait eu plus de soucis et de fatigue que de succès dans l’application d’une loi impopulaire, et que personne ne semblait savoir ce qu’était le département de l’Éducation. Plus tard il put se féliciter du nombre toujours croissant des écoles et des élèves qui les fréquentaient. Cela lui occasionnait un surcroît de travail et de responsabilités dépassant les capacités d’un seul homme qui approchait de la soixantaine. Le caractère de Meilleur n’était pas de nature à faciliter les choses. Il était tout d’une pièce et n’aimait pas qu’on se mêlat de ses affaires. Ses portraits nous font voir un homme au front haut et large, aux lèvres minces et à la forte mâchoire ; le regard paraît d’abord sévère et inquisiteur mais on y décèle une certaine douceur. Ses écrits didactiques témoignent du culte qu’il avait pour la science, source de certitude, et de son sens de l’ordre et de la méthode, qui devenait volontiers systématique. Sa mémoire prodigieuse et sa curiosité presque universelle le poussaient, sauf pendant qu’il fut surintendant, à communiquer aux journaux son avis sur toute espèce de sujet. S’il a beaucoup écrit c’est peut-être parce que, timide et peu communicatif, il préférait la plume à la parole pour convaincre et, au besoin, pour se justifier.
Sa correspondance avec l’abbé Louis-Édouard Bois*, qui fut son seul confident, fait voir que dans son dessein d’échapper aux interventions des politiciens, Meilleur était intransigeant à l’extrême. Ses lettres sont remplies de ses doléances, de ses inquiétudes au sujet de sa famille qu’il s’accusait de négliger, mais aussi des soupçons qu’il avait à l’égard des députés et des ministres et des accusations qu’il portait contre eux. Sa méfiance, qui n’était pas toujours justifiée, l’empêcha de fréquenter ceux d’entre eux qui auraient pu l’aider.
Lorsque le gouvernement quitta Montréal, après les émeutes et l’incendie du Parlement en 1849, Meilleur ne le suivit ni à Toronto ni à Québec où il siégea alternativement. Loin du pouvoir, le surintendant se trouva de plus en plus isolé et négligé. Pendant ce temps qui fut celui de l’apogée de l’enseignement classique dans le Bas-Canada et du renouveau intellectuel dont l’Institut canadien fut le centre à Montréal et à Québec, des hommes plus jeunes arrivaient au parlement et d’autres mieux instruits que ceux dont il s’était plaint de l’incompétence, étaient commissaires d’école. Ceux que Meilleur appelait ses adversaires mirent en doute la qualité des maîtres et de l’instruction qu’ils dispensaient. Afin de se rendre compte de la situation, l’Assemblée législative nomma en 1853 un comité spécial, présidé par Louis-Victor Sicotte*, député de Saint-Hyacinthe, « pour s’enquérir de l’état de l’éducation ». Meilleur, qui jugeait Sicotte fier, vindicatif et hautain, considéra cette enquête comme une insulte personnelle.
Le rapport Sicotte fit ressortir des faits tels que l’analphabétisme de la moitié des commissaires, le manque de préparation de la majorité des instituteurs et des institutrices, la plupart trop jeunes et tous mal rémunérés, choses que le surintendant, pressé d’ouvrir des écoles et manquant de maîtres, n’avait pu empêcher, la loi ne lui donnant ni l’autorité ni les moyens de le faire. Le comité ne blâma pas directement Meilleur mais conclut que le système scolaire avait besoin « d’une direction active, énergique, intelligente et ayant droit d’initiative [...] ». Le rapport recommanda cependant de conserver la structure et les principes de la loi de 1846 en en modifiant les détails et en augmentant la participation financière du gouvernement afin de réaliser les projets que le comité soumettait. Les plus importants étaient la nomination d’inspecteurs compétents, moins nombreux et mieux rémunérés, qui présideraient les bureaux d’examinateurs des districts scolaires et formeraient, avec le surintendant, le conseil d’instruction ; ce conseil serait chargé d’appliquer la loi des écoles et, entre autres, de choisir, d’approuver et de faire imprimer les manuels scolaires, et d’assurer l’uniformité des méthodes d’enseignement. On recommanda enfin d’ouvrir des écoles normales à Québec et à Montréal, de mieux payer les instituteurs et de leur assurer une pension après 30 années d’enseignement.
L’Assemblée législative ne donna pas suite à ce rapport. De son côté, Meilleur prépara un projet afin de corriger une situation qu’il déplorait, mais le gouvernement de Francis Hincks* et d’Augustin-Norbert Morin* ne jugea pas à-propos de le présenter à l’Assemblée. La situation du surintendant devint rapidement intenable et le 19 juin 1855, Meilleur démissionna. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau* lui succéda. Plus heureux que son prédécesseur, dont il loua, dans son premier Rapport annuel, « les efforts intelligents et continuels, la persévérance opiniâtre, la patience pour ainsi dire surhumaine, pour seulement parvenir à mettre en opération une loi malheureusement impopulaire », Chauveau eut pour le seconder un conseil et un département de l’Instruction publique créés en 1856. Meilleur ne pardonna jamais à Chauveau de ne pas avoir mentionné son nom dans ce Rapport et il lui chercha une vaine querelle dans la Minerve en 1859, à propos d’une vague question de botanique.
La carrière de Meilleur ne fit ensuite que décliner, bien que ses concitoyens lui aient marqué à plusieurs reprises leur reconnaissance. Immédiatement après sa démission, il fut nommé directeur, puis en 1861, inspecteur des postes à Montréal. Il eut alors de sérieuses difficultés, devant combler de ses propres deniers le déficit de sa caisse, dont il n’était pas responsable, et il quitta son emploi. Ne pouvant plus vivre qu’en épuisant ses maigres ressources, il accepta la fonction de juge de paix et, en réponse à la supplique de 30 députés inquiets de son sort, le gouvernement le nomma temporairement vendeur de timbres de loi. Enfin, la Confédération qu’il avait combattue étant venue, il devint registraire adjoint provincial, avec résidence à Québec, et son salaire lui fut payé jusqu’à sa mort.
Dans la retraite, l’ancien surintendant trouva une nouvelle vigueur intellectuelle. En 1857, il assista au congrès de l’American Association for the Advancement of Science, à Montréal, fit partie du comité local d’organisation et déplora l’apathie de ses concitoyens de langue française. L’année suivante, il s’inscrivit en faux contre l’opinion de ceux qui prétendaient que les Canadiens français n’avaient pas d’aptitude pour les sciences. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal l’avait élu président « en reconnaissance des services signalés qu’il avait rendus au pays dans la cause de l’éducation » et il était président de la Société de construction du district de Montréal. Pendant ce temps il rédigea l’œuvre qui devait couronner sa carrière d’éducateur et, en quelque sorte, venger sa mémoire. Le Mémorial de l’éducation du Bas-Canada parut à Montréal en 1860 ; tirée à 1 009 exemplaires, cette première édition fut rapidement épuisée. Une deuxième, considérablement augmentée, fut publiée à Québec en 1876. C’est un ouvrage indispensable à qui veut connaître l’histoire de l’éducation au Canada. L’auteur y donne une version objective des faits dont il fut l’acteur et le témoin, sans manifester d’animosité contre ceux dont il dit cependant qu’ils contrecarrèrent son action.
Pendant qu’il habitait Québec, Meilleur s’intéressa de nouveau aux sciences naturelles et collabora activement avec son ami, l’abbé Léon Provancher*, qui le fit élire, en 1870, président de la Société d’histoire naturelle de Québec. Il fit paraître plusieurs articles dans le Naturaliste canadien, fondé par Provancher en 1868. Dans sa vieillesse, Meilleur revint ainsi à ses premières amours après avoir consacré à l’éducation les 30 années les plus fécondes de sa longue carrière. Sa vie fut un exemple de détermination opiniâtre et désintéressée au service de ses concitoyens.
Les écrits de Meilleur sont nombreux. En premier lieu, citons ses rapports comme surintendant de l’Éducation du Bas-Canada, publiés en appendice dans les JALPC, 1843–1855. Viennent ensuite dans l’ordre : A treatise on the pronunciation of the French language or a synopsis of rules for pronouncing the French language with irregularities exemplified (2e éd., Montréal, 1841) ; Agriculture et chimie, Bibliothèque canadienne (Montréal), VI (1828) : 72ss ; VII (1828) : 73ss ; Analyse de l’eau saline de L’Assomption, Bibliothèque canadienne, II (1826) : 142, 199 ; Cours abrégé de leçons de chymie, contenant une exposition précise et méthodique des principes de cette science, exemplifiés (Montréal, 1833) ; Dissertation on scrofula, Journal de médecine de Québec, I (1826) : 233 ; II (1827) : 81ss ; Géologie ; réponse à J. M. B., Bibliothèque canadienne, V (1827) : 215 ; Lettre à l’abbé Provancher au sujet du Traité de botanique de l’abbé O. Brunet, Le Naturaliste canadien (Québec), 11 (1870) : 150–152 ; Lettre au sujet des recherches du docteur J. A. sur la « bufonine », Le Naturaliste canadien, II (1870) : 239–241, 268–270 ; Lettre de remerciement à l’abbé Provancher, Le Naturaliste canadien, IV (1872) : 100–102 ; Mémorial de l’éducation du Bas-Canada (1re éd., Montréal, 1860 ; 2e éd., Québec, 1876) ; Nouvelle grammaire anglaise [...] (1re éd., Saint-Charles-sur-Richelieu, Qué., 1833 ; 2e éd., Montréal, 1854) ; On Prussic acid, Journal de médecine de Québec, I (1826), no 3 : 171ss ; Quelques-unes de nos plantes les plus intéressantes, Le Naturaliste canadien, II (1870) : 355–364 ; Supplément critique au Petit traité d’agriculture de Valère Guillet, Bibliothèque canadienne, IX (1829) : 170–177, 189–195, 210–214.
Outre ces publications, nous retrouvons plusieurs articles signés de sa main ou d’un pseudonyme, dans les journaux suivants : L’Écho du pays (Saint-Charles-sur-Richelieu, Qué.), 10 oct. 1833, 4 juill., 11 juill. 1833 ; Le Glaneur (Saint-Charles-sur-Richelieu, Qué.), avril, mai, juin, sept. 1837 ; Mélanges religieux (Montréal), 1841 ; La Minerve (Montréal), 1826, 1829, 9 juin 1831, 23 août 1832, 3 mars, 17 mars, 19 mars, 9 avril 1859 ; Le Populaire (Montréal), 6 août, 13 août, 17 août, 27 août, 3 sept., 5 sept., 7 sept., 26 sept. 1838.
AJM, Registre d’état civil.— ASJCF, Collège Sainte-Marie, Fonds Meilleur (microfilm en possession de Léon Lortie).— ASN, Collection Bois, lettres de Jean-Baptiste Meilleur (microfilm en possession de Léon Lortie).— L.-P. Audet, Le système scolaire de la province de Québec, I.— Anastase Forget, Histoire du collège de L’Assomption (Montréal, [1933]).— J. K. Jobling, The contribution of Jean-Baptiste Meilleur to education in Lower Canada (thèse de m.a., McGill University, 1963).— André Labarrère-Paulé, Les instituteurs laïques au Canada français, 1836–1900 (Québec, 1965), 161ss.— Léon Lortie, Notes sur le « Cours abrégé de leçons de chymie » de Jean-Baptiste Meilleur (« Publ. du laboratoire de chimie de l’université de Montréal », no 1, Montréal, 1937).— L.-P. Audet, Index analytique du Mémorial de l’éducation dans le Bas-Canada du Dr Jean-Baptiste Meilleur, MSRC, 4e sér., II (1964), sect. i : 49–62 ; Jean-Baptiste Meilleur était-il un candidat valable au poste de surintendant de l’Éducation pour le Bas-Canada en 1842 ?, Cahiers des Dix XXXI (1966) : 163–201.— Léon Lortie, Deux notaires amateurs de science ; Jean De Lisle et son fils Augustin-Stanislas De Lisle, MSRC, 3e sér., LV (1961), sect. i : 39–47 ; L’étrange aventure de quelques documents officiels concernant Jean-Baptiste Meilleur, Annales de l’ACFAS (Montréal), IX (1943) : 171–175 ; Le retour de Jean-Baptiste Meilleur au Canada, MSRC, 3e sér., L (1956), sect. i : 69–83 ; Les lettres de J.-B. Meilleur sur l’éducation en 1838, Revue trimestrielle canadienne (Montréal), XXIV (1938–1939) : 251–271.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Léon Lortie, « MEILLEUR, JEAN-BAPTISTE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/meilleur_jean_baptiste_10F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/meilleur_jean_baptiste_10F.html |
| Auteur de l'article: | Léon Lortie |
| Titre de l'article: | MEILLEUR, JEAN-BAPTISTE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1972 |
| Année de la révision: | 1972 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |


![Titre original : Jean-Baptiste Meilleur. Surintendant de l'Instruction publique [image fixe]](/bioimages/w600.4304.jpg)