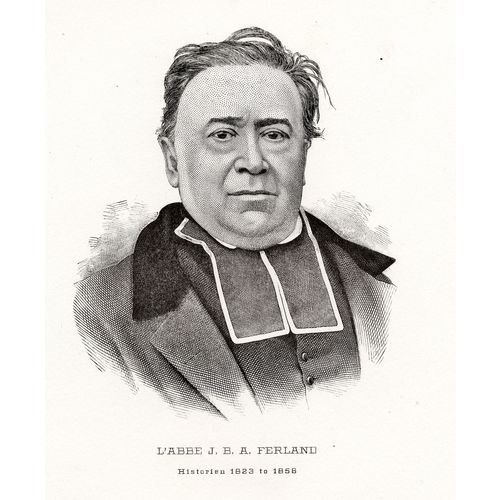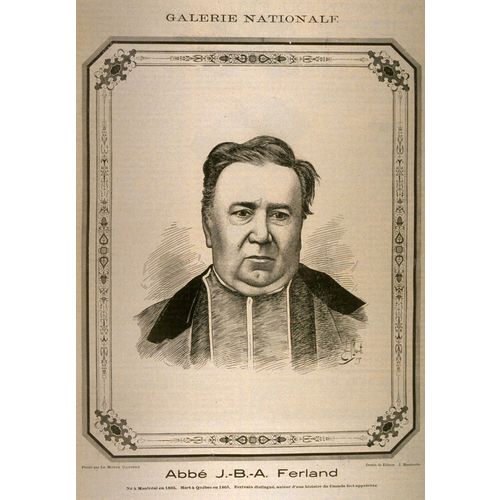Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
FERLAND, JEAN-BAPTISTE-ANTOINE, prêtre, professeur, historien, né à Montréal le 25 décembre 1805, fils d’Antoine Ferland, marchand, et d’Élizabeth Lebrun de Duplessis, décédé à Québec le 11 janvier 1865.
On a peu de renseignements sur l’ascendance paternelle de Jean-Baptiste-Antoine Ferland. Son père, né à Saint-Pierre, île d’Orléans, est mort avant sa naissance. Devenu prêtre, Jean-Baptiste-Antoine sera ainsi pendant longtemps le soutien financier de sa mère. Celle-ci est la fille de Jean-Baptiste Lebrun* de Duplessis, arrivé au Canada en qualité de volontaire des armées françaises en 1755. Au début du Régime anglais, ce grand-père et parrain de Jean-Baptiste-Antoine s’était lié avec Francis Maseres*, procureur général de la province de Québec de 1766 à 1769, dont il partageait les vues politiques. En 1778, Maseres lui écrivait : « Je ne sais si vous avez appris l’anglais, mais un homme de votre intelligence et de votre talent aurait dû le faire. » Il semble bien que, par son ascendance maternelle du moins, Ferland appartenait à une famille convertie au « bilinguisme » dès les débuts du Régime anglais. Très jeune il apprend l’anglais et, alors qu’il n’a que huit ans, sa mère déménage à Kingston, Haut-Canada. Il y fait la connaissance de sa cousine Julia Catherine Beckwith, auteur du roman St. Ursula’s convent, or the nun of Canada, containing scenes from real life, paru en 1824, avec qui il correspondra pendant ses études au collège de Nicolet.
Grâce à l’abbé Rémi Gaulin*, missionnaire dans le Haut-Canada et plus tard évêque de Kingston, Ferland entre au collège de Nicolet en 1816 où, sous la protection de Mgr Joseph-Octave Plessis* (dont il publiera plus tard la biographie), il fait de brillantes études classiques : en 1821, il est premier de classe en philosophie. En 1822, il opte pour le sacerdoce et, l’année suivante, alors qu’il n’est encore que candidat à la prêtrise, il devient secrétaire temporaire de Mgr Plessis. En 1828, à l’âge de 22 ans, Ferland est ordonné prêtre, ce qui n’est pas prématuré à cette époque où la pénurie de prêtres favorisait les ordinations précoces.
Le jour de son ordination, le 14 septembre, l’abbé Ferland est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de Québec (1828–1829). Après avoir été vicaire à Fraserville (Rivière-du-Loup) et à Saint-Roch de Québec, il devient, en 1834, premier chapelain de l’hôpital de la Marine et des Émigrés de Québec. De 1834 à 1841, il est successivement curé de Saint-Isidore, près de Lévis, de Sainte-Foy et finalement de Sainte-Anne-de-Beaupré. En 1836, il accompagne Mgr Pierre-Flavien Turgeon, alors coadjuteur de l’archevêque de Québec, au cours de sa visite des côtes de la Gaspésie, voyage dont Ferland publiera le récit 25 ans plus tard. À cause de sa connaissance de l’anglais, Ferland est souvent appelé, au cours de ses années de ministère paroissial, à exercer ses fonctions auprès des minorités anglo-catholiques. Son dévouement en 1847 à la Grosse Île auprès des immigrants irlandais atteints du typhus [V. George Mellis Douglas] lui vaudra une excellente réputation au sein de la communauté irlandaise de Québec.
En 1841, l’abbé Ferland entre au collège de Nicolet où il restera neuf ans. Professeur de littérature, d’histoire et de philosophie, il gravit les divers échelons de la hiérarchie administrative en devenant préfet des études (1841–1850), directeur (1842–1848) et supérieur (1848–1850) de l’institution. La curiosité intellectuelle du futur historien se développe au cours de ces années durant lesquelles il touche aussi à la botanique. Intéressé aux questions sociales et politiques, il lit à quelques étudiants les Mélanges religieux et la Gazette de Québec. Ceux-ci prennent des notes en anglais pour se familiariser avec la langue seconde. Encouragé par l’épiscopat, l’abbé Ferland s’adonne particulièrement aux études historiques et, en 1842, il soutient et patronne la fondation au collège d’une société littéraire où des sujets d’histoire nationale sont abordés.
À la fin des années 1840, le collège fait face à des difficultés financières imputables en bonne partie à une pénurie d’étudiants. Les déficits sont tels qu’il est question de vendre l’établissement à l’État pour le convertir en pénitencier. L’abbé Ferland, alors supérieur, déclare sans prétention à son évêque que si les difficultés lui paraissent causées par sa mauvaise administration, il se fera un plaisir de quitter l’institution. Pour augmenter le nombre de pensionnaires, il prétend qu’il faudrait peut-être songer à imiter les collèges de L’Assomption et de Saint-Hyacinthe qui permettent aux étudiants de prendre leurs repas à l’extérieur. Entre temps, le déficit persiste et, à la rentrée de septembre 1849, on ne compte que 70 pensionnaires. Ferland attribue cette baisse à la rareté du numéraire. En décembre de la même année, le supérieur fait part à Mgr Turgeon de son inquiétude face à la situation financière du collège, les comptes recevables de pensions pour les deux dernières années scolaires ne totalisant que £600. Se prétendant peu apte aux tâches administratives, il espère être nommé curé. Plus intime avec son ami l’abbé Louis-Jacques Casault, Ferland lui donne une version quelque peu différente des faits. Dès 1847, il lui confie qu’il s’est agrégé contre son gré au personnel du collège. Il se dit victime de « tracasseries [...] qui s’adressent à la place [de supérieur] et non à la personne ». Le refus de l’aide financière du gouvernement que d’autres institutions semblables acceptaient à l’époque est, à ses yeux, la cause déterminante de la situation peu reluisante de Nicolet.
Après avoir résigné sa charge de supérieur pendant l’été de 1850, Ferland partage son temps entre la recherche, l’enseignement et quelques tâches administratives et pastorales. Le futur historien réside à Québec à titre de conseiller de l’archevêché. Nommé trésorier de l’Œuvre de la propagation de la foi, il en rédige le rapport annuel. En 1852, il visite l’île d’Anticosti d’où il tirera la légende du sorcier Gamache. En 1855, il est nommé aumônier militaire dans la ville épiscopale. En 1858, à la demande de Mgr Charles-François Baillargeon, administrateur de l’archidiocèse, il visite la population catholique établie sur la côte du Labrador. Il y seconde l’oblat François Coopman à Mécatina.
C’est au cours des années 1850 que se dessine la carrière d’historien de l’abbé Ferland. Nommé, en 1854, professeur à la faculté des arts de l’université Laval, dont il deviendra doyen en 1864, il est chargé d’un cours public d’histoire du Canada. Cette tâche l’oblige à faire un séjour dans différents dépôts d’archives européens en 1856–1857 où il s’occupe, entre autres, de faire transcrire des documents. En effet, le séminaire de Québec s’était engagé à payer la moitié de ses frais de voyage en France à la condition qu’il fasse copier « tout ce qu’il juge[ait] intéressant sur l’Amérique et le Canada en particulier ». À son retour, ses cours publics, échelonnés sur plusieurs années, attirent un auditoire dont il est difficile de préciser l’importance et la composition. Néanmoins, il semble que ce petit homme trapu, obèse, intelligent, enjoué, peu éloquent a attiré des foules considérables. En effet, selon Antoine Gérin-Lajoie*, élève de Ferland à Nicolet, sa conférence sur les années de la Conquête fut donnée devant une assistance de 300 à 400 personnes. Cette série de conférences, que Ferland aurait voulu poursuivre jusqu’à l’avènement du régime constitutionnel, fut publiée en deux volumes parus en 1861 et 1865. Cependant, sa mort prématurée l’a empêché de surveiller lui-même l’impression du second volume qui s’arrête à la Conquête. À sa mort, Jean-Baptiste-Antoine Ferland laisse une modeste bibliothèque ainsi qu’une petite somme épargnée pour ses vieux jours, qu’il lègue à l’asile du Bon-Pasteur de Québec où il fut chapelain de 1853 à 1856.
On a l’habitude de faire remonter la vocation littéraire de Ferland à la publication de l’Histoire du Canada, de son Église et de ses missions depuis la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours [...] de Charles-Étienne Brasseur* de Bourbourg, parue à Paris en 1852. Les Observations sur un ouvrage intitulé Histoire du Canada [...], publiées en 1853 mais parues d’abord sous forme d’articles dans le Journal de Québec en janvier et février de la même année, sont en effet le premier essai où Ferland a pu se familiariser avec l’histoire nationale. Mais cet incident ne saurait expliquer à lui seul pourquoi le clergé s’est donné, en la personne de l’abbé Ferland, au cours des années 1860, un porte-parole de son interprétation du passé. En réalité, la volumineuse histoire du Canada du prêtre historien s’inscrit dans la lutte sociale du xixe siècle, au cours de laquelle le clergé est sorti vainqueur de cette fraction de plus en plus marginale de notables nourris du libéralisme doctrinal européen. Durant la première moitié du xixe siècle, le clergé catholique du Canada, en position de faiblesse par rapport à la bourgeoisie, avait été passablement malmené par les historiens. Au cours des années 1840, 30 ans après l’histoire anticléricale et anticanadienne-française de William Smith*, François-Xavier Garneau s’était fait le défenseur des valeurs libérales dans son interprétation du passé canadien. Nationaliste, sa version des faits pouvait être préférée à celle de Michel Bibaud*. L’Histoire du Canada [...] de Carneau apparaissait comme une compensation, aux yeux de la petite bourgeoisie professionnelle canadienne-française, de la défaite de 1837–1838. Dès 1845, la version cléricale du passé s’annonçait par la réfutation des pages de Garneau consacrées à Mgr François de Laval* ; cette année-là, en effet, paraissaient deux opuscules consacrés au prélat : l’un de l’abbé Louis-Édouard Bois*, l’autre de l’abbé Brasseur de Bourbourg. Au cours des années 1850, la synthèse de Brasseur de Bourbourg, pas plus que les ouvrages de l’abbé Étienne-Michel Faillon, n’avait réussi à faire l’unanimité au sein du clergé canadien. Tout ultramontaine qu’elle fut, l’interprétation de Brasseur de Bourbourg avait plutôt servi les notables libéraux, en condamnant généreusement l’action jugée trop timide de l’épiscopat vis-à-vis les « empiètements » de l’État. Faillon, de son côté, s’était attaqué aux personnalités ecclésiastiques de Québec, jugées injustes à l’égard de Montréal. Au cours des années 1860, le moment semblait venu de faire l’unanimité sur le rôle historique des clercs, en vue de favoriser un certain consensus à l’égard de l’emprise croissante du clergé sur les destinées du Canada français. C’est à cette tâche que s’est voué l’abbé Ferland.
Ses Cours d’histoire du Canada sont, en effet, une réponse aux libéraux ainsi qu’aux prêtres historiens trop bavards sur les conflits qui avaient divisé le clergé dans l’histoire nationale. En lisant attentivement la synthèse de Ferland, on peut constater ce souci de créer l’unanimité idéologique autour des clercs. On y trouve de timides allusions aux conflits entre l’Église et l’État qui ont divisé les élites de la Nouvelle-France. Contrairement à Faillon, l’historien québécois fait jouer à l’Église de Montréal un rôle qui ne laisse plus soupçonner les rivalités dévoilées par Faillon et que l’abbé Henri-Raymond Casgrain* avait voulu atténuer, en 1864, dans sa biographie de Marie de l’Incarnation [Guyart*]. Dans la synthèse de Ferland, tout se déroule comme si le clergé n’avait presque jamais été aux prises avec des problèmes aigus qui le mettaient en concurrence avec l’autorité civile. Le peuple, à la suite des beaux exemples de vertu des élites aussi bien laïques que religieuses, aurait suivi la voie tracée par les chefs et se serait conformé aux modèles de comportement proposés par eux. Les Amérindiens auraient obéi aux missionnaires, l’exemple des chrétiens de race blanche et la parole de l’Évangile ayant suffi à les convaincre de la vérité du christianisme.
À part cette préoccupation centrale qui avait pour but de démontrer l’influence bienfaisante du clergé et du catholicisme sur la société coloniale, Ferland a notamment réussi, mieux que tout autre écrivain canadien-français du xixe siècle, à décrire la civilisation amérindienne sans donner dans la discrimination de l’autochtone si courante à l’époque. Il a compris que les Amérindiens se sentaient aliénés par la présence européenne. De là, explique-t-il, leur acharnement contre l’homme blanc. Certes, les Amérindiens de Ferland sont cruels et sanguinaires, mais, comme il l’écrit, c’est de la « politique sauvage ». À ses yeux, celle-ci était peut-être aussi valable que celle des colonisateurs qu’il condamne, çà et là, d’avoir abusé de la force ou d’avoir manqué de franchise et de justice à l’égard des populations de couleur. C’est à Ferland que l’on doit les condamnations des enlèvements de Jacques Cartier*, de l’alliance militaire de Samuel de Champlain* avec les Hurons et des procédés de Jacques-René de Brisay* de Denonville vis-à-vis l’« ennemi » des Blancs. L’organisation sociale amérindienne inspire à Ferland des pages que l’on chercherait en vain dans la littérature historique canadienne-française traditionnelle. Alors qu’il était de mode de mettre l’accent sur le caractère superstitieux des croyances aborigènes, Ferland se penche sur ce qu’il appelle leur « théologie » et étudie les « philosophes sauvages ». La société amérindienne semble avoir un penchant prononcé pour le respect des libertés individuelles. Cette constatation permet à l’auteur d’expliquer pourquoi les traités de paix ou d’alliance militaire qui ne liaient pas les individus étaient généralement peu respectés. Par contre, l’ultramontain ne saurait rester neutre en constatant l’existence du libéralisme, fût-ce au sein des tribus amérindiennes. « Il y aurait bien, écrit Ferland, des rapprochements à faire entre la ligue iroquoise et la fédération des États-Unis. Fondées toutes deux sur le principe de la liberté de l’homme, elles en ont largement adopté les conséquences : assemblées de la nation, de l’état, de la commune, conseils fréquents, harangueurs nombreux (stump-orators) ; indépendance de l’homme, de la femme, des enfants ; et, au milieu de toutes ces libertés, l’esclavage. » On ne saurait s’étonner d’un pareil rapprochement chez un auteur qui a beaucoup lu sur l’histoire des États-Unis et qui correspondit assez régulièrement avec l’historien John Gilmary Shea.
Au moment de leur publication, les Cours d’histoire du Canada de Ferland se sont mérité les éloges de la critique. Ils correspondaient à l’idéologie cléricale nationaliste en voie de dominer la pensée canadienne-française. C’est durant les années 1880 que la représentation du passé construite par le clergé fait l’objet de la censure libérale. Dans son Histoire des Canadiens-français, 1608–1880 [...], publiée en huit volumes à Montréal de 1882 à 1884, Benjamin Sulte* discute certaines interprétations de l’abbé Ferland. L’ouvrage de ce dernier étant en quelque sorte un récit de l’œuvre missionnaire, on comprend aisément que pour Sulte la condamnation de l’activité missionnaire devait nécessairement impliquer la censure des auteurs qui l’avaient exaltée. Mais les attaques isolées de quelques francs-tireurs libéraux ne devaient pas mettre en péril la crédibilité de Ferland. Compte tenu du contexte éminemment conservateur de la seconde moitié du xixe siècle, il fut préféré à son adversaire. Dans son Histoire du Canada et des Canadiens français, de la découverte jusqu’à nos jours publiée en 1884 à Paris, le libéral français Eugène Réveillaud ne qualifiait-il pas Ferland d’historien ultramontain ? Il n’en fallait pas davantage, dans les dernières décennies du xixe siècle, pour être considéré comme le héraut de la vérité intégrale.
Relativement nombreuses, les œuvres de Ferland ont comme particularité commune d’avoir connu au moins deux éditions chacune. Les Observations sur un ouvrage intitulé Histoire du Canada, etc, par M. l’abbé Brasseur de Bourbourg (Québec), parues d’abord dans le Journal de Québec, les 22, 25, 29 janvier et 1er février 1853, sont publiées sous forme de brochure la même année avant d’être rééditées dès 1854 à Paris. Après Notes sur les registres de Notre-Dame de Québec (Québec, 1854 ; 2e éd., 1863), Ferland publie son ouvrage le plus marquant en histoire, Cours d’histoire du Canada (2 vol., Québec, 1861–1865). Une deuxième édition paraît en 1882 puis une troisième, publiée conjointement à Tours, France, et Montréal, en 1929 sous le titre la France dans l’Amérique du Nord. Enfin, en 1969, une maison américaine réimprime la première édition. Le Foyer canadien ; recueil littéraire et historique (Québec), I : 70–312, publie, en 1863, un long article de Ferland intitulé « Notice biographique sur Monseigneur Joseph Octave Plessis, évêque de Québec ». Dès 1864, T. B. French en fait une traduction anglaise sous forme d’un volume : Biographical notice of Joseph Octave Plessis, bishop of Quebec (Québec) ; en 1878, un ouvrage portant le titre Mgr. Joseph-Octave Plessis évêque de Québec paraît à Québec.
Dans les années 1860, Ferland publie quelques articles qui connaîtront plusieurs éditions : d’abord un « Journal d’un voyage sur les côtes de la Gaspésie », paru dans les Soirées canadiennes ; recueil de littérature nationale (Québec), 1 (1861) : 301–476. En 1877 et 1879, des réimpressions de cet article en volume sont publiées à Québec sous le titre la Gaspésie. Enfin, Ferland signe deux articles dans la Littérature canadienne de 1850 à 1860 (2 vol., Québec, 1863–1864), I : « Louis Olivier Gamache » (pp.259–274) et « Le Labrador » (pp.289–365). Ces articles paraissent en volume en 1877 : Louis Gamache, le Labrador, opuscules (Québec). Ce volume, communément appelé Opuscules, connaît par la suite plusieurs rééditions et le titre est parfois modifié.
Les sources manuscrites concernant la vie et l’œuvre de Jean-Baptiste-Antoine Ferland sont peu considérables et souvent peu dignes d’intérêt. La consultation des ASQ, des archives de l’université Laval (Québec) et du séminaire de Nicolet n’a fourni que peu de renseignements de même que celle des papiers Ferland conservés aux AAQ dans la série T. Les sources imprimées intéressantes sont assez rares en raison probablement de la pauvreté des sources manuscrites. Toutefois, la critique littéraire a accordé beaucoup d’importance à l’œuvre littéraire et historique de Ferland. En dernier lieu, pour plus de détails sur les études ayant servi à la rédaction de la biographie de Ferland, nous renvoyons le lecteur à J.-B.-A. Ferland ; textes, T.-M. Charland, édit. (Montréal et Paris, 1958). Le lecteur peut aussi consulter avec profit les titres suivants : le Monde illustré (Montréal), 30 août 1890 ; J.-A.-I. Douville, Histoire du collège-séminaire de Nicolet, 1803–1903, avec les listes complètes des directeurs, professeurs et élèves de l’institution (2 vol., Montréal, 1903), I : passim ; Frère Fernando [Gérard Bédard], L’abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland ; son œuvre historique et littéraire (thèse de m.a., université de Montréal, 1953). [s. g.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Serge Gagnon, « FERLAND, JEAN-BAPTISTE-ANTOINE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/ferland_jean_baptiste_antoine_9F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/ferland_jean_baptiste_antoine_9F.html |
| Auteur de l'article: | Serge Gagnon |
| Titre de l'article: | FERLAND, JEAN-BAPTISTE-ANTOINE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1977 |
| Année de la révision: | 1977 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |