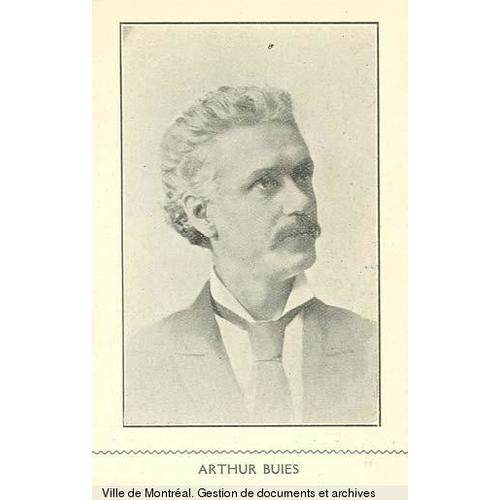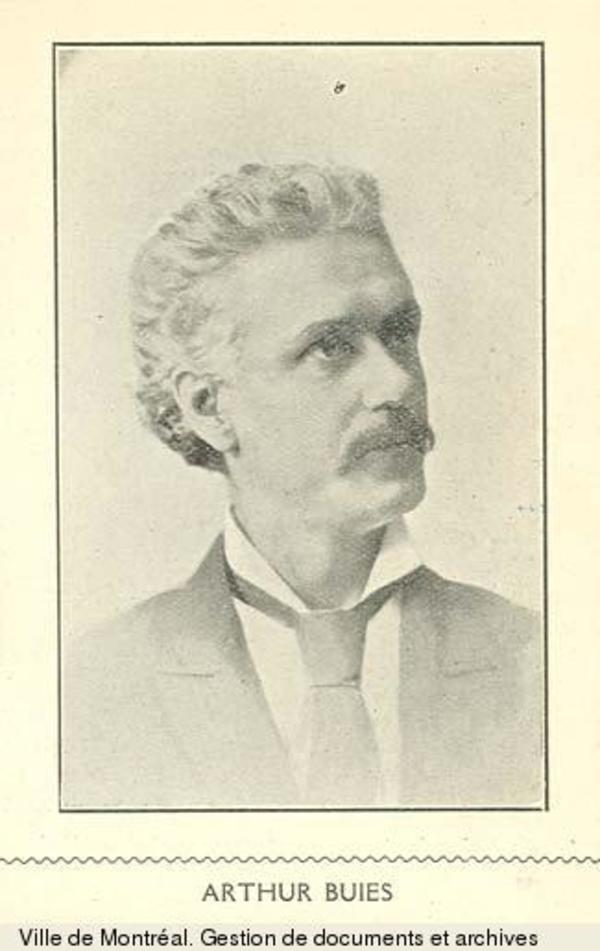
Provenance : Lien
BUIES, ARTHUR (baptisé Joseph-Marie-Arthur Buie), journaliste, homme de lettres et fonctionnaire, né le 24 janvier 1840 à Côte-des-Neiges (Montréal), fils de William Buie, banquier d’origine écossaise, et de Marie-Antoinette-Léocadie d’Estimauville ; décédé le 26 janvier 1901 à Québec.
Le père d’Arthur Buies, qui habite à New York au moment de sa naissance, s’installera avec sa femme à Berbice (Guyana) en 1841, laissant à Québec son jeune garçon et sa fille Victoire (née à New York en 1837) aux bons soins de deux grand-tantes maternelles. De 1849 à 1854, Buies fréquente le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis le séminaire de Nicolet en 1854–1855 et le petit séminaire de Québec en 1855–1856. À 16 ans, son père, qui a été maître des postes à Berbice de 1842 à 1855, l’appelle auprès de lui et, au bout de quelques mois, l’envoie étudier à Dublin. Il offre de payer ses études, à condition qu’il les poursuive en anglais. Le jeune Arthur se rebelle et part étudier de son propre chef à Paris. Inscrit au lycée Saint-Louis de 1857 à 1859, il envisage de préparer dans un premier temps un baccalauréat ès sciences et de s’inscrire ensuite en droit à l’université Laval. Il essuie quatre échecs au baccalauréat.
Cette rupture avec l’autorité paternelle peut avoir fortifié chez Buies le goût de la révolte contre toute forme d’autorité. Elle a des conséquences graves sur le plan financier, car le jeune homme doit vivre dans des conditions matérielles difficiles, qui ne sont pas sans avoir d’incidence sur ses études. En outre, selon l’abbé Thomas-Étienne Hamel, c’est à Paris qu’il « prend des idées », « et il sait fort bien choisir les plus perverses ». Il cesse alors toute pratique religieuse, qu’il ne reprendra qu’en 1879.
Talonné par les créanciers, Buies donne en 1860, à Palaiseau, dans la banlieue de Paris, des leçons de latin et d’anglais, puis rejoint l’armée de Garibaldi en Sicile. Campagne d’opérette selon le journaliste français Ulric de Fonvielle, au cours de laquelle il se livre surtout aux plaisirs de la table. Rentré à Paris en septembre, il continue à vivre dans des conditions précaires jusqu’au jour où, à la fin de 1861 ou au début de 1862, il se décide à rentrer au Canada, après six années d’absence.
Dès son retour, Buies devient membre de l’Institut canadien. Il prononce des conférences, participe aux débats, occupe tour à tour les fonctions de vice-président (1865) et de secrétaire d’administration (1868), écrit dans le Défricheur (L’Avenir) [V. Jean-Baptiste-Éric Dorion*] et le Pays (Montréal) [V. Édouard-Raymond Fabre*], et se lance dans la polémique, où il excellera.
Ainsi paraissent à Montréal en 1864 les deux premières Lettres sur le Canada [...], réquisitoire contre le clergé canadien : « Le clergé est partout, il préside tout, et l’on ne peut penser et vouloir que ce qu’il permettra [...] ce n’est pas le triomphe de la religion qu’il cherche, mais celui de sa domination. » Ces Lettres (il en publiera trois, la dernière en 1867) se veulent aussi une dénonciation du retard que connaît l’Amérique française par rapport à l’Amérique anglo-saxonne et un appel à la jeunesse canadienne à se soulever contre l’apathie qui règne au Canada français. L’anticléricalisme de leur auteur n’exclut pas pour autant un christianisme plus proche du protestantisme que du catholicisme libéral : « je crois à Dieu et aux sublimes vérités du christianisme ; mais je ne veux pas de votre usurpation de ma conscience, [...] je veux chercher la vérité que Dieu lui-même a déclaré difficile à trouver ». Buies entend donc bien continuer la tradition radicale de l’Institut canadien, celle de « la brillante pléïade de 1854 [...] la pléïade rouge », comme il l’appellera dans Réminiscences ; les jeunes barbares (Québec, [1892]), celle des Joseph Papin*, Jean-Baptiste-Éric Dorion, Gonzalve Doutre*, Louis-Antoine Dessaulles* et d’autres.
En 1864, également, Buies publie dans le Pays deux articles intitulés « le Progrès », dans lesquels il fait l’apologie de la science. L’année suivante, il reprend plusieurs fois la plume, notamment sur les États-Unis, dont il se fait le défenseur contre les attaques conservatrices, et sur la langue française, dans une série d’articles intitulés « Barbarismes canadiens », où il relève nombre de tournures fautives utilisées couramment dans la langue parlée et dans les journaux. Il écrit qu’« il faut conserver à chaque langue son caractère propre, et ne pas la violenter par l’introduction de locutions étrangères, quand elle offre elle-même des mots qui rendent mieux l’idée qu’on veut exprimer ».
En 1866, Buies réclame dans « l’Instruction » une double réforme du système d’éducation canadien. D’une part, il croit indispensable l’introduction d’un enseignement scientifique beaucoup plus poussé dans les écoles. D’autre part, il juge nécessaire l’établissement d’un système scolaire non confessionnel, sur le modèle américain. Il a la ferme conviction que les Canadiens français ne sortiront de leur état d’infériorité que le jour où ils seront au moins aussi scolarisés que leurs voisins anglo-saxons.
Pendant ce temps, comme certains de ses amis libéraux, Buies combat le projet de Confédération, qui finit par aboutir en 1867. Cette année-là, il quitte le Canada à nouveau, avec l’intention de s’établir définitivement à Paris et d’y faire une carrière de journaliste. Il part de Montréal le 29 mai et arrive à Brest, via New York, le 12 juin. Il publie dans une revue française un article contre la Confédération, se lie d’amitié avec le géographe Pierre-François-Eugène Cortambert et rencontre George Sand. Mais le Rubempré canadien se heurte à une concurrence farouche et il connaît, à nouveau, de graves soucis financiers. L’enthousiasme du début fait place au découragement et, en janvier 1868, il est de retour à Montréal.
Buies est plus que jamais actif au sein de l’Institut canadien, où les questions d’éducation continuent de le préoccuper. Par ailleurs, il réclame l’abolition de la peine de mort. Désireux de poursuivre la lutte contre le cléricalisme, il fonde la Lanterne canadienne, inspirée directement de la Lanterne, journal parisien d’Henri Rochefort.
Du 17 septembre 1868 au 18 mars 1869, il rédige chaque semaine – seul – une quinzaine de pages vitrioliques dans lesquelles il met toute sa rage et tout son esprit. Sa liberté de parole est absolue car il parle, non plus au nom d’un parti, mais en son nom personnel. Et il ne se prive pas de dénoncer ses ennemis, mais aussi ses amis, qu’il trouve trop complaisants : « Les seules canailles sont les honnêtes gens. » La campagne que Buies a entreprise ne vise pas que le cléricalisme, le Nouveau Monde (Montréal) ou la Minerve (Montréal) : « je ne puis être satisfait, ni tranquille, dit-il dans le troisième numéro, tant que je verrai autour de moi les méchants, les sots, et les lâches triompher ». Ce vaste programme lui permet de tirer à boulets rouges sur la presse conservatrice qui, elle non plus, à vrai dire, ne lui fait pas de cadeau. Il cherche à mettre les rieurs de son côté, ce qui ne l’empêche pas pour autant de revenir sur le thème de l’éducation qui lui tient particulièrement à cœur. Dénonçant le système alors en vigueur, il écrit : « La jeunesse sort des collèges, bouffie de prétentions, mais vide de science. »
Les distributeurs de la Lanterne sont toutefois l’objet de pressions diverses, et bientôt les lecteurs se font plus rares. Que Buies ait réussi à tenir le coup pendant 27 semaines constitue un exploit, car il fut toujours seul, en dépit d’une pressante invitation aux jeunes gens à se joindre à lui. Il gardera toujours pour la Lanterne une affection particulière, et l’on peut dire qu’elle occupe dans les annales de la presse québécoise une place considérable. Ce journal est demeuré, en effet, le symbole du courage intellectuel et moral, à une époque où beaucoup avaient courbé l’échine. En ce sens, il devait inspirer nombre de journalistes de talent, tels Jules Fournier*, Olivar Asselin* et Jean-Charles Harvey*.
Profondément découragé du peu d’appui qu’il a reçu de ses compatriotes, Buies songe à s’exiler de nouveau, à Paris d’abord, à New York ensuite. Il se rend à Paris, mais il est une de ces natures qui, promptes au découragement, sont aussi promptes à l’espoir, et, l’année suivante, de retour à Montréal, il fonde l’Indépendant, bilingue à ses débuts, unilingue ensuite, qui prône l’indépendance du Canada et un mode de gouvernement républicain. Il écrit : « Nous comprenons tous que nous ne pouvons avoir d’influence en Amérique qu’à la condition de personnifier l’idée française. » L’expérience est éphémère, quelques mois à peine, et il devient correspondant du Pays à Québec où il s’installe de façon permanente.
Ces années de lutte, Buies les évoquera plus tard avec nostalgie : « Nous avons vu les derniers jours du Montréal d’autrefois et nous avons été les derniers types des étudiants vieux modèle. Nous avons ainsi fermé le trait d’union entre une société qui s’éteignait et une nouvelle qui s’annonçait avec des goûts, un esprit et un genre tout différents. » À vrai dire, ce furent des années de formation intellectuelle et professionnelle. Les conférences et les articles lui permirent non seulement de développer ses talents d’orateur et de journaliste, mais de préciser sa vision de la société canadienne-française, dont l’épanouissement reposait, selon lui, sur la scolarisation universelle et une forte culture scientifique et technique. Par ailleurs, l’intégrité de la culture canadienne-française dépendait, d’après lui, d’une connaissance approfondie de la langue française, menacée au Canada par ses élites : avocats, hommes politiques, hommes d’affaires, journalistes, écrivains, qui s’acharnaient tous à corrompre le français. Enfin, fidèle en cela à l’idéologie de l’époque, il croyait, comme tous les intellectuels, que la colonisation non seulement arrêterait l’émigration vers les États-Unis, mais consacrerait l’occupation du territoire par les Canadiens français, minimisant ainsi les effets de l’immigration anglo-saxonne au Canada et permettant l’exploitation des vastes richesses naturelles.
C’est en 1871 que Buies entreprend sa carrière de chroniqueur, au Pays d’abord, au National (Montréal) ensuite, et occasionnellement à la Minerve et à l’Opinion publique (Montréal). La chronique joue un rôle important dans les journaux de l’époque. Elle est un mélange de commentaires de l’actualité, d’informations, de confidences, le tout sur un ton badin et humoristique. Le chroniqueur doit distraire le lecteur, le faire sourire, sinon rire. L’esprit de Buies, primesautier, ironique, sarcastique à l’occasion, convient admirablement à ce genre d’exercice. Selon lui, la chronique c’est « un plat hebdomadaire convenablement épicé, humoristique plus ou moins, pouvant se tenir deux colonnes durant, assez au point pour délasser le lecteur et lui permettre d’avaler la formidable argumentation des autres colonnes rangées en bataille et tonnant de toutes leurs pièces ». Mais il existe un côté plus sérieux à la chronique, qui peut aussi constituer une source importante de réflexion sur la société, et de ce type de chronique Buies donne une définition toute différente : « qu’est-ce en effet que la chronique, si ce n’est le récit, au jour le jour, des événements qu’on voit de près, des faits intimes auxquels on se trouve mêlé ou qui se passent sous vos yeux, un aperçu piquant et rapide de ces petits côtés de l’histoire de son temps, dont la critique historique, pour être sérieuse, ne peut plus se passer aujourd’hui ? »
Entre 1871 et 1878, Buies publie à Québec trois recueils de chroniques : Chroniques, humeurs et caprices (1873), Chroniques, voyages, etc., etc. (1875) et Petites Chroniques pour 1877 (1878). Des campagnes électorales aux stations balnéaires, en passant par des réflexions philosophiques et des récits de voyage, tel est le « menu » de ces trois recueils dont il est impossible de résumer les thèmes. Les Chroniques se laissent ouvrir au hasard et parcourir selon l’humeur du moment. Elles demeurent, mieux peut-être que la production littéraire conventionnelle, un témoignage irremplaçable sur un Québec en pleine mutation. Chroniques, voyages [...] contient « Deux mille deux cents lieues en chemin de fer », récit du voyage éclair que Buies fit en juin–juillet 1874 à San Francisco.
C’est pendant cette période que Buies s’impose comme le maître incontesté de la chronique au Québec, regrettant toutefois que ce genre lui donne la réputation d’un auteur peu sérieux, léger, incapable de produire des ouvrages de réflexion. C’est avec irritation qu’il écrira beaucoup plus tard : « Je sais bien que vous [lecteur], au moins, vous ne commettrez pas la banalité assommante de m’appeler « l’un de nos plus spirituels chroniqueurs. » Voilà plus de vingt ans que l’on m’écrase avec cette platitude. Il a fallu bien assurément, ma parole d’honneur, que je fusse un chroniqueur très spirituel, mais pas « l’un de nos plus », pour n’avoir pas encore été intoxiqué par cette décoction d’aloès de commerce et de myrrhe frelatée, à l’usage des débutants dans le journalisme. »
C’est aussi l’époque où les libéraux ont été élus à Ottawa, et Buies, en défenseur fidèle du parti depuis des années, s’attend à recevoir une sinécure et à rejoindre ses collègues journalistes et hommes de lettres déjà installés dans la capitale fédérale. Mais son attitude déplaît à l’élite du parti, et il doit continuer à pratiquer une profession qui, selon tous les témoignages, est l’une des plus ingrates, tant sur le plan financier que professionnel. Comme il l’écrira plus tard : « Le journaliste franco-canadien surtout est un véritable manœuvre, une bête de somme, un forçat, un casseur de pierres, un limeur de cables sous-marins. »
Il est vrai qu’en septembre 1875, au moment où Buies prononce une conférence publiée à Québec sous le titre de Conférences : la Presse canadienne-française et les Améliorations de Québec [...], il entend encore réformer un milieu qu’il considère comme fondamental au progrès de la société canadienne-française. En effet, héritier d’Étienne Parent*, il est convaincu que l’homme de lettres a une mission à accomplir, et que cette mission, il l’accomplira par l’entremise des journaux. Aussi prend-il à partie tous ceux qui, à ses yeux, trahissent leur mission et font de la presse canadienne-française la plus médiocre de toutes les presses des pays occidentaux. Cette médiocrité vient d’une méconnaissance de la langue, qui interdit les débats d’idées et fait que l’on tombe rapidement dans l’injure et la calomnie : « Et c’est là le plus grand malheur peut-être de notre presse qu’il ne soit pas permis d’y exprimer une opinion libre sans être aussitôt taxé d’hérésie par une petite légion de barbouilleurs aussi ignorants que bornés et prétentieux. »
L’année suivante, après l’abolition du ministère de l’Instruction publique par le conservateur Charles-Eugène Boucher* de Boucherville, avec l’assentiment de la députation libérale, Buies, furieux, lance en mai le Réveil. Il retrouve la combativité des années 1860 et s’insurge contre une mesure qui met l’enseignement sous la coupe exclusive de l’Église catholique. Il s’attaque violemment au clergé – ce qui vaut au journal une condamnation par Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau* – mais il dénonce aussi l’opportunisme du Parti libéral, « ce parti qui ne représente rien, qui ne signifie rien, qui n’a pas un principe exprimé dans un programme quelconque, et dont l’invariable devise, qu’il soit du pouvoir ou dans la minorité est : concession, louvoiement, équivoque, détours, temporisation, hypocrisie ». Contraint de quitter Québec, le journal s’installe à Montréal en septembre et disparaît en décembre. Le Réveil est la dernière tentative journalistique indépendante de Buies. Certains y verront le terme de son radicalisme. Disons plutôt que, forcé de rentrer dans le rang, il n’en demeurera pas moins toujours fidèle à son idéal d’enseignement non confessionnel.
Après que Buies eut repris la plume du chroniqueur dans le National en 1877, on perd quelque peu sa trace. Grâce à sa correspondance avec son ami Alfred Garneau, on sait cependant qu’en 1879, par suite d’une crise physique et morale très profonde, il revient à la pratique du catholicisme : « Enfin je suis sorti de la fondrière. Depuis le jour où j’ai communié de nouveau, après 23 ans d’abstention, je n’ai pas éprouvé un pareil soulagement. »
En juin 1879, sur l’intervention du curé François-Xavier-Antoine Labelle*, Buies est appelé par le commissaire des Terres de la couronne, Félix-Gabriel Marchand*, à faire partie de son département. Ainsi commence sa carrière de « colonisateur ». À vrai dire, dans son premier article, intitulé « Colonisation » et paru dans le Défricheur du 19 novembre 1863, il déclarait : « l’agriculture [...] est la base essentielle de notre prospérité ». Mais son intérêt pour la colonisation est indissociable de sa passion pour la géographie, dont il dit en 1875 qu’« elle est [alors] la science la plus indispensable pour celui qui se mêle d’écrire dans les journaux » ; d’ailleurs, il est secrétaire de la Société de géographie de Québec depuis 1878.
Sa nomination au département des Terres de la couronne vaut à Buies d’écrire son premier ouvrage géographique » : le Saguenay et la Vallée du Lac St-Jean ; étude historique, géographique, industrielle et agricole (Québec, 1880). Ce type d’ouvrage correspond parfaitement à son idéal de « littérature nationale ». Comme il le répète à maintes reprises, les écrivains canadiens doivent cesser d’imiter les auteurs français, et il est de leur devoir de choisir des sujets « canadiens » et, avant tout, utiles. Ainsi qu’il l’expliquera quelques années plus tard à Hector Garneau, petit-fils de François-Xavier Garneau*, « une littérature qui n’est pas utile, qui n’enseigne point, est une littérature perdue ». Par conséquent, il n’a nullement le sentiment de trahir sa vocation d’écrivain en rédigeant des monographies pour ce département ou, plus tard, pour celui de l’Agriculture et de la Colonisation.
En 1881, après avoir visité Boston, où il fait la connaissance de Francis Parkman*, Buies envisage de partir pour La Nouvelle-Orléans, mais remet son voyage à cause du report de son mariage, qui sera finalement annulé. Il parcourt, cette année-là, les cantons du Nord et la vallée de l’Outaouais, et publie une série d’articles dans le Nord (Saint-Jérôme). Ces activités ne l’empêchent pas de collaborer à la Nouvelle-France, revue bimensuelle à caractère littéraire et scientifique que lance en mai à Québec son ami Jacques Auger, dans laquelle, s’adressant à la jeunesse, il écrit : « Étudiez, étudiez ; savoir, c’est pouvoir. Soyez prêts pour toutes les découvertes, pour toutes les qualifications de la science moderne. C’est pour avoir été pris au dépourvu par le prodigieux épanouissement de cette science que nous sommes restés à l’écart, justement dédaignés, et que les étrangers ont pris notre place. »
L’année suivante est marquée par sa collaboration aux Nouvelles Soirées canadiennes, revue littéraire fondée à Québec par Louis-Hyppolite Taché, Edmond Lortie et Elzébert Roy, et par un séjour de trois semaines en décembre à l’hôpital Notre-Dame de Montréal causé, semble-t-il, par des problèmes d’alcoolisme. Peu de temps après, Buies est d’ailleurs destitué de ses fonctions par le premier ministre conservateur Joseph-Alfred Mousseau*, épisode qu’il décrit en ces termes : « J’ai essayé en outre d’égarer le gouvernement dans des entreprises plus qu’incertaines, mais après avoir pataugé à la crèche deux ans pendant lesquels je n’ai rien fait, j’ai été congédié avec une trentaine d’abrutis dont les services ont été jugés inutiles, après un long temps d’expérience. » Il est forcé alors de reprendre la plume du chroniqueur, et on retrouvera régulièrement sa signature dans la Patrie (Montréal).
À l’été de 1883, Buies part pour l’Ouest canadien, voyage dont il fait le récit dans « Lettres du Nord-Ouest » parues dans la Patrie d’août à novembre et rééditées en 1890, à Québec, sous le titre de Récits de voyage [...]. En 1884, il réédite à Montréal les chroniques de 1873 sous le nouveau titre de Chroniques canadiennes, humeurs et caprices, et la Lanterne. Il a aussi l’intention de rééditer les deux autres recueils de chroniques, mais son projet ne verra jamais le jour. L’affaire Riel [V. Louis Riel*] le pousse à publier à Montréal en 1885 le Signal, journal dont un seul numéro paraîtra, qui se veut « avancé » et dans lequel il écrit : « De la question Riel va sortir « l’agitation » sur nombre d’autres questions qu’il semblait tout récemment encore impossible de discuter, et qui en paraîtront bientôt comme le corollaire naturel, en quelque sorte inévitable. » L’année 1886 voit la condamnation de la Lanterne par Mgr Taschereau, qui intervient personnellement auprès de l’Institut canadien de Québec pour faire annuler une conférence de Buies.
Tombé amoureux, le célibataire endurci qu’est Buies se marie le 8 août 1887, dans la basilique Notre-Dame de Québec, à Marie-Mila Catellier, fille de Ludger-Aimé Catellier, sous-registraire général du Canada ; le couple aura cinq enfants. En mai 1888, le curé Labelle est nommé, par le premier ministre Honoré Mercier*, sous-commissaire au département de l’Agriculture et de la Colonisation de la province de Québec. Le mois suivant, Buies, qui a maintenant des responsabilités familiales, devient agent de la colonisation, poste qu’il occupera jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions par les conservateurs en juillet 1892.
En outre, Buies écrit régulièrement dans l’Électeur (Québec) depuis 1887 et publie finalement à Québec en 1889 l’Outaouais supérieur, ouvrage auquel il a commencé à travailler au début de la décennie. Puis, coup sur coup, paraissent à Québec quatre ouvrages : les Comtés de Rimouski, Matane et Témiscouata [...], recueil de trois rapports, et la Région du Lac Saint-Jean, grenier de la province de Québec [...] en 1890 ; Au portique des Laurentides ; une paroisse moderne ; le curé Labelle en 1891 ; enfin, Réminiscences ; les jeunes barbares en 1892. Cette activité fébrile se déroule en dépit de la maladie et du décès de son premier enfant et de la mort du curé Labelle.
Dans un article remarquable intitulé « le Coup d’État Angers et la Chute de Mercier », paru dans la Patrie du 6 août 1892, Buies tente d’expliquer la chute du gouvernement Mercier. Il écrit ces mots, que les amis de l’ex-premier ministre ne lui pardonneront point : « Il avait la plus brillante partie en main qui jamais ait échu à un homme d’État canadien : il avait tout un peuple derrière lui et un rôle glorieux à remplir : sa vanité, son égoïsme, son dénûment absolu de sens moral ont tout perdu. »
Au cours des années 1890, naissent trois enfants, dont deux mourront en bas âge, et l’état de santé de Buies lui-même, déjà précaire, va en se détériorant. Les soucis financiers s’accumulent, et il doit solliciter l’aide du Secrétariat provincial, qui lui achète un certain nombre de ses ouvrages. Il tente également, après 1896, d’obtenir l’appui de ses amis libéraux au pouvoir à Ottawa.
Les déboires n’ont toutefois pas raison de la verve de Buies et, pour ceux qui auraient l’illusion de le voir rentrer dans le rang, il a la dent dure. Son anticléricalisme s’exprime avec force dans un article intitulé « Interdictions et Censures », publié en 1893 dans Canada-Revue (Montréal) : « Rappelons-nous que la population canadienne-française souffre depuis plus de quarante ans d’un déchainement inouï de prétentions ecclésiastiques. Jamais on [n’a] vu prôner pareille intolérance. » Il reprend momentanément en 1895 sa carrière de chroniqueur dans la Revue nationale (Montréal), publie ses derniers ouvrages sur la colonisation, dont une nouvelle édition du Saguenay et la Vallée du Lac St-Jean [...] – intitulée le Saguenay et le Bassin du Lac Saint-Jean ; ouvrage historique et descriptif (Québec, 1896) –, le Chemin de fer du lac Saint-Jean [...] (Québec, 1895), la Vallée de la Matapédia [...] (Québec, 1895) et deux commandites : l’une du département de l’Agriculture d’Ottawa, les Poissons et les Animaux à fourrure du Canada (1900), et l’autre du département de l’Agriculture de la province, la Province de Québec (1900). Les préoccupations littéraires ne l’ont pas quitté pour autant et, dans Réminiscences ; les jeunes barbares, il stigmatise certains jeunes écrivains qui, selon lui, se mêlent d’écrire sans connaître la langue française, puis s’en prend une fois de plus au système d’éducation et au climat anti-intellectuel qui règne dans la province : « Nous sommes le peuple le plus arriéré du monde [...] Tout homme qui a réussi, dans notre petite province, à acquérir une valeur réelle et un fonds intellectuel sérieux, ne le doit qu’à ses propres et pénibles efforts, sans aucune aide, voire même en dépit de tout et à travers tous les obstacles entassés sur la route. »
Malade depuis plusieurs années déjà, Arthur Buies meurt le 26 janvier 1901. Son corps est inhumé le 29 janvier, au cimetière Notre-Dame de Belmont à Sainte-Foy, près de Québec. Il laisse le souvenir d’un homme bon, intelligent, qui tenta toute sa vie d’aider ses compatriotes. Sur le plan littéraire, il est considéré comme l’un des meilleurs stylistes de son temps. Il fut, sans aucun doute, l’un des esprits les plus curieux, les plus avancés du Québec, convaincu que l’Amérique francophone ne devait pas vivre repliée sur elle-même, mais s’ouvrir aux grands courants politiques, culturels et économiques contemporains. Son attitude courageuse, son talent de polémiste, son esprit critique furent une source d’inspiration pour un grand nombre d’intellectuels. Grâce à ses Chroniques et à la Lanterne, il demeure l’une des figures marquantes de la scène littéraire et intellectuelle canadienne du dernier quart du xixe siècle.
On trouvera une partie de la correspondance d’Arthur Buies aux ANQ-Q, P-18, ainsi qu’une version dactylographiée déposée dans le fonds M.-A. Gagnon, à la Bibliothèque de la ville de Montréal, Salle Gagnon. Deux autres fonds importants, l’un contenant sa correspondance avec sa femme et l’autre avec Alfred Garneau, se trouvent, pour le moment, respectivement dans les Arch. privées d’Arthur Buies jr (Québec), corr. avec Mme Buies et divers, et dans celles de Suzanne Prince (Québec), corr. avec Alfred Garneau. On trouve aussi de sa correspondance : aux AN, dans les fonds de Louis Fréchette (MG 29, D40), d’Alphonse Lusignan (MG 29, D27), de la famille Papineau (MG 24, B2), et de Benjamin Sulte (MG 29, D5) ; aux Arch. de l’univ. du Québec à Montréal, Fonds C.-A.-Dansereau, doc. relatifs à Arthur Buies (en cours de classement) ; aux Arch. du séminaire de Nicolet, Québec, F004 (J.-A.-I. Douville), Succession ; aux AAQ, 31–17 A ; aux AUL, dans le fonds Gérard-Malchelosse (P121) et dans la coll. Maurice-Brodeur (P209.1) ; aux ANQ-BSLGIM, dans le fonds Ulric-Joseph Tessier (P-1) ; au Centre de recherche en civilisation canadienne-française (Ottawa), P 6/1/3 et P 263 (non classé) ; aux ANQ-M, dans le fonds de la famille Papineau (P-7) ; aux ANQ-Q, dans le fonds François-Xavier-Antoine Labelle (P-124/217) ; aux ASJCF, BO-78-28 ; aux ASQ, dans la volumineuse correspondance de Louis-Jacques Casault* et de Thomas-Étienne Hamel (Univ., 39) ; et dans les Arch. privées, Francis Parmentier (Hull, Québec), Lettres d’Arthur Buies à Alfred Duclos De Celles, 26 nov., 29 déc. 1898 (copies). Nous avons publié une édition critique des Chroniques [...] (2 vol., Montréal, 1986–1991) et de la Correspondance (1855–1901) (Montréal, 1993) d’Arthur Buies. [f. p.]
AC, Québec, État civil, Catholiques, Saint-Jean-Baptiste (Québec), 29 janv. 1901.— ANQ-M, CE1-51, 12 févr. 1840.— ANQ-Q, CE1-1, 8 août 1887.— DOLQ, 1.— Raymond Douville, la Vie aventureuse d’Arthur Buies ([Montréal, 1933]).— Alfred Duclos De Celles, « Arthur Buies », la Presse, 16 févr. 1901 : 4.— J.-C. Falardeau, « Arthur Buies, l’anti-zouave », Cité libre (Montréal), no 27 (mai 1960) : 25, 32.— M.-A. Gagnon, le Ciel et l’Enfer d’Arthur Buies (Québec, 1965).— C.-H. Grignon, « Arthur Buies ou l’Homme qui cherchait son malheur », Académie canadienne-française, Cahiers (Montréal), 7 (1963) : 29–42.— Charles ab der Halden, Nouvelles Études de la littérature canadienne française (Paris, 1907), 49–184.— Léopold Lamontagne, Arthur Buies, homme de lettres (Québec, 1957).— Edmond Lareau, Histoire de la littérature canadienne (Montréal, 1874), 463–466.— Laurent Mailhot, Anthologie d’Arthur Buies ([Montréal], 1978).— Francis Parmentier, « Arthur Buies et la littérature nationale » et « Arthur Buies et la critique littéraire », Rev. d’hist. littéraire du Québec et du Canada français (Ottawa), 7 (hiver–printemps 1984) : 57–59 et 14 (été–automne 1987) : 29–35.— Virgile Rossel, Histoire de la littérature française hors de France (Lausanne, Suisse, 1895), 328–331.— Marcel Trudel, l’Influence de Voltaire au Canada (2 vol., Montréal, 1945), 2 : 101–130, 152–160.— J.-P. Tusseau, « la Fin édifiante d’Arthur Buies », Études françaises (Montréal), 9 (1973) : 45–53.— G.-A. Vachon, « Arthur Buies, écrivain », Études françaises, 6 (1970) : 283–295.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Francis Parmentier, « BUIES, ARTHUR (baptisé Joseph-Marie-Arthur Buie) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/buies_arthur_13F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/buies_arthur_13F.html |
| Auteur de l'article: | Francis Parmentier |
| Titre de l'article: | BUIES, ARTHUR (baptisé Joseph-Marie-Arthur Buie) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1994 |
| Année de la révision: | 1994 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |