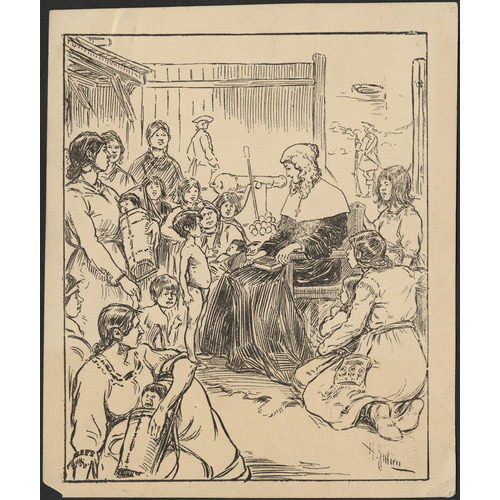MANCE, JEANNE, fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal, née à Langres, en Champagne (France), baptisée le 12 novembre 1606, fille de Catherine Émonnot et de Charles Mance, procureur au bailliage de Langres, décédée à Montréal le 18 juin 1673.
La famille Mance était originaire de Nogent-le-Roi (aujourd’hui Nogent-au-Bassigny, Haute-Marne) et la famille Émonnot, de Langres, où les parents de Jeanne Mance allèrent s’installer. Les deux familles appartenaient à la bourgeoisie de robe ; Charles Mance et Catherine Émonnot s’étaient mariés en 1602. Ils eurent six garçons et six filles. Jeanne, leur deuxième enfant, fut probablement parmi les premières élèves confiées aux Ursulines, venues s’installer à Langres en 1613. Elle comptait un peu plus de 20 ans lorsqu’elle perdit sa mère. Très pieuse et sachant s’oublier elle-même, elle devint, aux côtés de sa sœur aînée, le soutien de son père et veilla à l’éducation de ses jeunes frères et sœurs. Elle connut les misères de la guerre de Trente Ans qui n’épargnait guère les villes frontières de la France. Des hôpitaux furent fondés à Langres. L’évêque, Mgr Sébastien Zamet, concentrait ses efforts et répandait son or pour la construction d’un hôpital de charité dans sa ville. Mieux encore, il établissait une société de dames pieuses orientée vers les œuvres de charité extérieure et sociale. C’est probablement dans ces œuvres que Jeanne Mance se dévoua tout d’abord comme garde-malade. Elle y apprit sans doute à donner des soins d’urgence aux blessés et aux malades. Comment expliquer autrement sa dextérité à Ville-Marie au chevet des victimes affreusement mutilées par les Iroquois ? À mesure que ses frères et ses sœurs grandissaient, elle disposait de plus de temps pour vaquer aux œuvres charitables, et son père n’était plus là pour réclamer ses soins. Il était mort vers 1635.
Vers la mi-avril 1640, Jeanne apprit la présence à Langres, chez son oncle Simon Dolebeau, du fils aîné de la maison, Nicolas, chapelain de la Sainte-Chapelle à Paris et précepteur du duc de Richelieu, neveu de la duchesse d’Aiguillon. Jeanne estimait ce cousin. Elle suivait volontiers ses conseils, quoiqu’il fût à peu près de son âge (il était né le 18 août 1605 à Nogent-le-Roi). Jeanne s’empressa d’aller lui rendre visite. Le jeune homme l’entretint de la Nouvelle-France. Il contenait avec peine son émotion, car son frère cadet, Jean. [V. Dolebeau], religieux de la Compagnie de Jésus, venait de s’embarquer pour les missions de la colonie. Nicolas annonça en outre à Jeanne que non seulement de courageux hommes de Dieu se hâtaient vers ces contrées, mais que depuis l’été de 1639, des femmes du monde et des religieuses y abordaient aussi, témoignant du même élan de foi et de la même intrépidité que leurs compagnons missionnaires. Il raconta la prodigieuse vocation de Mme de Chauvigny de La Peltrie et des ursulines qu’elle emmenait en Nouvelle-France, et aussi celle des hospitalières de Saint-Augustin, qu’y envoyait la duchesse d’Aiguillon. Dollier* de Casson, auquel nous devons le récit de ces faits, nous assure que c’est à ce moment que Jeanne Mance ressentit pour la première fois le désir d’aller en Nouvelle-France.
Quelques jours se passèrent. Jeanne réfléchissait et priait. Elle se décida à consulter son directeur sur son intention de partir pour l’Amérique. Le temps de la Pentecôte approchait. Son directeur, resté inconnu, l’engagea à mettre sous le regard de l’Esprit saint toutes ses aspirations. Enfin, le religieux finit par lui permettre de s’embarquer pour le Canada. Il fut convenu qu’elle partirait pour Paris « le mercredi d’après la Pentecôte ; que là elle s’adressât au Père C[harles] Lalemant qui avait soin des affaires du Canadas, que pour la direction de sa conscience elle prit le Recteur de la Maison des Jésuites qui seroit la plus voisine du lieu où elle logeroit. » Elle parla ensuite à ses parents et amis de ses Projets.
Ce fut le dernier jour de mai que Jeanne Mance partit de Langres. À Paris, elle entra chez sa cousine, Mme de Bellevue (née Antoinette Dolebeau, unique sœur de Nicolas). Elle demeurait au faubourg Saint-Germain, non loin d’un autre de ses frères, le père Charles Dolebeau, carme déchaussé. Devant la sympathie témoignée, Jeanne se départit de sa réserve. Elle parla de ses grands espoirs missionnaires. Elle s’empressa aussi d’exécuter point par point le programme que son directeur de Langres lui avait tracé. Elle frappa d’abord au couvent des Jésuites de la rue du Pot-de-Fer) (aujourd’hui rue Bonaparte). Elle vit le père Charles Lalemant, procureur des missions du Canada, qui s’intéressa tout de suite à ses projets. Jeanne vit aussi au couvent le père Jean-Baptiste Saint-Jure, que la Compagnie de Jésus, même en ces temps, considérait comme un de ses plus grands maîtres. Malheureusement, durant plusieurs mois, le père Saint-Jure fut dans l’impossibilité de la recevoir. Jeanne partagea, en attendant, la vie active et charitable de sa cousine. Elle fit de nombreuses connaissances. Entre autres, on lui présenta une grande dame parisienne, Mme de Villesavin (née Isabelle ou Isabeau Blondeau ; femme de Jean Phélypeaux, seigneur de Villesavin). Jeanne ne se doutait point que, dans quelques mois, cette femme aimable lui rendrait un service signalé. Car c’est Mme de Villesavin qui, un jour, se récria en entendant Jeanne regretter de ne pas avoir l’avis du père Saint-Jure sur ses dispositions missionnaires. Elle promit à Jeanne de plaider sa cause auprès du religieux. Elle y réussit en effet, et Jeanne fut priée de se rendre au parloir aussi souvent qu’elle le jugerait bon. D’autres personnalités féminines désirèrent faire la connaissance de Jeanne, notamment Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse de Condé, la chancelière Pierre Séguier, la duchesse d’Aiguillon, la marquise de Liancourt, Louise de Marillac, Marie Rousseau, la célèbre voyante parisienne. Enfin, la reine elle-même, la pieuse Anne d’Autriche, voulut la voir.
Dollier de Casson nous apprend qu’ « un Provincial des Récollets, homme de grand mérite nommé le Père Rapin, vint à Paris, or comme elle [Jeanne] le connoissoit dabord elle le visita et lui dit les choses comme elles étoient ». Le père Rapine fut heureux de revoir Jeanne. Il fut touché de sa confiance en la Providence. Aussi, ayant approuvé sa décision de se rendre au Canada pour y travailler à la conversion des sauvages, il ajouta « que cela étoit bien, qu’il falloit ainsi qu’elle s’oubliât elle-même, mais qu’il étoit bon que d’autres en eussent le soin nécessaire ». À quelques jours de là, le père Rapine lui écrivit de vouloir bien se rendre à l’hôtel de Bullion, rue Platrière. Jeanne y retrouva le père Rapine, qui lui présenta une grande dame fort riche, protectrice discrète, mais munificente, de la plupart des œuvres de charité françaises. Il s’agissait d’Angélique Faure, veuve de Claude de Bullion, surintendant des Finances de France, cousin du père Rapine. Angélique Faure était la fille de Guichard Faure de Berlise, secrétaire du roi, maître ordinaire de Sa Majesté, et de Madeleine Brulart de Sillery, sœur de Noël Brulart de Sillery, fondateur de la mission de Sillery au Canada, et de Nicolas, chancelier de France. De son union avec Claude de Bullion, Angélique Faure avait eu cinq enfants.
L’impression première ayant été excellente de part et d’autre chez ces deux grandes chrétiennes, les visites de Jeanne à l’Hôtel de Bullion se multiplièrent. À la quatrième, Mme de Bullion demanda à Jeanne Mance « si elle ne voudroit pas bien prendre le soin d’un hôpital dans le pays où elle alloit, parcequ’elle avoit le dessein d’y en fonder un avec ce qui seroit nécessaire pour sa propre subsistance, que pour cela elle eut été bien aise de savoir qu’elle étoit la fondation de l’hôpital de Kebecq faite par Mad. Deguillon. » Jeanne formula quelques objections, mais sans repousser absolument le projet. Mme de Bullion la pria alors de bien vouloir s’enquérir du coût approximatif de l’Hôtel-Dieu de Québec. Car elle était disposée à donner autant d’argent pour son hôpital, sinon davantage. Jeanne accepta. La duchesse d’Aiguillon, apprit-elle, avait affecté à l’Hôtel-Dieu de Québec une somme de 22 000# qu’elle portait, un peu plus tard, à la somme de 40 500. La cardinal de Richelieu, naturellement, avait pris à sa charge une partie de ces dons. Jeanne se rendit entre-temps chez les Jésuites et consulta le père Saint-Jure pour savoir si elle devait accepter les offres que lui faisait Mme de Bullion.
Après avoir prié et réfléchi, le père Saint-Jure lui répondit qu’elle devait aller au Canada, « que c’étoit infailliblement Notre Seigneur qui vouloit cette liaison » avec la riche dame. Mme de Bullion fut heureuse de la décision de Jeanne. Elle lui demanda de vouloir bien garder, à l’avenir, le secret le plus absolu sur tout ce qui la concernait, sur son nom, sa personne et les dons qu’elle comptait faire. Jeanne, très émue d’un tel désintéressement, s’engagea à garder le silence. À la dernière visite qu’elle fit à l’hôtel de Bullion, elle reçut une bourse et d’autres riches cadeaux.
En avril 1641, Jeanne fit ses adieux à ses parents et amis, et se mit en route pour La Rochelle. À son arrivée, elle vit le jésuite Jacques de La Place qui la mit au courant des merveilles qui allaient accompagner le voyage en Nouvelle-France. Le lendemain, Jeanne, en entrant à l’église des Jésuites, croisa un gentilhomme. Ils échangèrent un regard chargé d’une extraordinaire clairvoyance, car, disent les Véritables motifs, « s’étant salués sans s’être jamais vu ni ouï parler l’un de l’autre, en un instant Dieu leur imprima en l’esprit une connaissance de leur intérieur et de leur dessein si claire, que s’étant reconnus, il ne purent faire autrement que remercier Dieu de ses faveurs ».
Ce pieux personnage, dans la quarantaine, était Jérôme Le Royer de La Dauversière, receveur des tailles à La Flèche, en Anjou, auquel Dieu aurait inspiré le dessein de Montréal à Notre-Dame de Paris, en 1635. Depuis cette date, il avait mûri et fait approuver son projet par les Jésuites, ses anciens maîtres du collège de La Flèche. En 1639, ses efforts conduisirent à la fondation de la Société Notre-Dame de Montréal, dont les Associés acquirent l’île de Montréal. Paul de Chomedey de Maisonneuve fut choisi pour assurer le gouvernement du nouveau poste.
Ce furent de pressants appels que M. de La Dauversière adressa à Jeanne. Les Associés de Montréal avaient justement besoin d’une personne comme elle, sage, pieuse, intelligente et résolue, pour devenir l’économe et plus tard l’infirmière de la recrue de Montréal. M. de La Dauversière obtint son consentement dès qu’elle eut consulté par lettres le père Saint-Jure d’abord, puis Mme de Bullion. Jeanne devint alors membre de la Société Notre-Dame de Montréal.
Le 9 mai 1641, la recrue s’embarqua sur deux vaisseaux. M. de Maisonneuve monta dans l’un avec une partie de la recrue ; le père de La Place, jésuite, Jeanne Mance et 12 hommes, dans le second. Mais avant qu’on pût mettre les voiles, M. de La Dauversière s’entretint une dernière fois avec Jeanne. C’est alors qu’elle lui suggéra de donner de l’extension à la Société de Montréal, pour obtenir l’appui indispensable aux travaux de colonisation. Elle proposa à M. de La Dauversière de donner par écrit un aperçu du « dessein de Montréal », qu’il lui remettrait ensuite en plusieurs copies. Elle adresserait alors une invitation à devenir membre de la Société de Montréal aux grandes dames généreuses et aux dévotes qu’elle avait fréquentées à Paris, et y joindrait l’écrit de M. de La Dauversière pour chacune d’elles. M. de La Dauversière promit de distribuer les missives dès son entrée à Paris.
Jeanne Mance débarqua à Québec au commencement d’août, le 8, nous apprend Dollier de Casson, qui ajoute que « le vaisseau où était Mademoiselle Mance n’expérimenta quasi que de la bonasse, celui de M. de Maison-neufve éprouva de si furieuses tempêtes qu’il fut obligé de relacher par trois fois ». Le chef de la recrue n’arriva à Tadoussac, semble-t-il, que le 20 septembre, alors qu’on désespérait de le voir apparaître cette année-là.
L’opposition qu’on manifestait à Québec pour la fondation d’un poste au Montréal, que l’on qualifiait de « Folle entreprise », consterna Jeanne Mance. Mais, M. de Maisonneuve, une fois à destination et dûment averti de cet état de choses, décida de passer outre, tout en y mettant sa courtoisie habituelle. La fondation fut toutefois remise au printemps suivant à cause de la saison tardive. Jeanne passa l’hiver à Sillery en compagnie de M. de Maisonneuve, de Mme de La Peltrie, dont la sympathie se montrait vive à son égard, et de M. Pierre de Puiseaux de Montrénault. L’hiver fut marqué, de quelques conflits avec le gouverneur Huault de Montmagny qui, au début, ne favorisait pas l’entreprise de la fondation de Montréal. Devant la fermeté de M. de Maisonneuve, il finit par céder. Selon la Relation, la fondation de Montréal eut lieu le « dix-septième de May de la presente année 1642. Monsieur le Gouverneur mit le sieur de Maisonneuve en possession de cette Isle, au nom de Messieurs de Mont-real, pour y commencer les premiers bastimens ».
La fondation de l’Hôtel-Dieu de Montréal eut lieu à l’automne de la même année. Ici encore, c’est un texte des Relations qui fixe la date : « De tous les Sauvages il ne nous en demeura [au printemps de 16431 qu’un nommé Pachirini qui [...] avoit tousiours voulu demeurer chez nous avec les deux autres malades dans le petit Hospital que nous y [au fort] avions dressé pour les blessez ». Toutefois, la construction de l’hôpital proprement dit n’eut lieu qu’en 1645.
En 1649, Jeanne se trouvait à Québec quand lu i parvinrent des lettres de France. En les lisant, elle fut frappée, dit Dollier de Casson, de « trois coups de massue ». Elle y apprit d’abord la mort du père Rapine, « qui lui faisoit avoir tous les besoins de sa Dame », Mme de Bullion. On lui annonçait également que M. de La Dauversière, gravement malade, était proche de la ruine. Enfin on lui narrait que les Associés de Montréal s’étaient tous séparés. Jeanne décida de partir le plus tôt possible pour la France. Elle écrivit à M. de Maisonneuve, le mit au courant de la situation critique du poste de Montréal et le prévint de son embarquement immédiat.
Quand elle revint, un an plus tard, toutes les difficultés étaient aplanies. M. de La Dauversière, parfaitement guéri, s’occupait avec zèle des intérêts de Montréal. La Société de Montréal avait repris vie sous la direction de Jean-Jacques Olier, un de ses fondateurs. Enfin, Mme de Bullion, toujours admirablement disposée pour Montréal et son hôpital, avait convenu avec Jeanne d’un nouveau mode de communication qui lui permettait de ne point divulguer son nom.
Mais la lutte contre les Iroquois devint, à partir du printemps de 1651, de plus en plus sanglante et constante. « Les Iroquois, écrit Dollier de Casson, n’ayant plus de cruautés à exercer [...] parcequ’il n’y avoit plus de Hurons à détruire, [...] tournèrent la face vers l’Isle de Montreal [...]. n’y a pas de mois en cet été où notre livre des morts ne soit marqué en lettre rouge par la main des Iroquois ». Jeanne Mance dut fermer l’hôpital et se réfugier au fort. Tous les habitants firent de même. Dans les lieux abandonnés, il fallut mettre des garnisons ; « nous diminuions tous les jours », dit encore Dollier de Casson.
A la fin de l’été de 1651, M. de Maisonneuve, découragé, angoissé même en voyant sans cesse tomber des colons qu’il aimait et avait mission de protéger, se décida à faire cesser ce carnage coûte que coûte. Il était clair que tous y passeraient à plus ou moins brève échéance. Il se rendrait en France, essaierait d’obtenir des ressources pour ramener un bon nombre de soldats à Ville-Marie. Ou bien, s’il échouait dans sa tentative auprès des Associés de Montréal, il abandonnerait l’œuvre et ordonnerait aux colons de rentrer en France.
C’est alors que Jeanne intervint. Sa confiance en la Providence lui avait soudain inspiré le moyen de venir au secours de tous. Elle se rendit chez M. de Maisonneuve et lui dit qu’ « elle lui conseilloit d’aller en France, que la fondatrice lui avoit donné 22 000 livres pour l’hôpital, lesquels étoient dans un certain lieu qu’elle lui indiqua, – qu’elle les lui donneroit pour avoir du secours ». M. de Maisonneuve accepta la proposition en principe. Il voulait, avant de prendre une décision finale, prier, réfléchir et consulter les aumôniers. Il songeait aussi au moyen de dédommager Mme de Bullion de la perte du capital qu’elle mettait à sa disposition. Il s’embarqua pour la France quelques semaines plus tard, avec un peu d’espoir. Par ce conseil donné au gouverneur, Jeanne Mance venait de sauver Montréal, car M. de Maisonneuve revint avec du secours.
Quelques années plus tard, le 28 janvier 1657, au retour de la messe, Jeanne Mance tomba sur la glace, se fractura le bras droit et se disloqua le poignet. Cette chute eut de graves conséquences. Les médecins parvinrent à guérir la fracture, mais ne s’aperçurent pas de l’état du poignet ; bien que guérie, Jeanne Mance fut dans l’impossibilité de se servir de son bras. À cause de cette infirmité, elle dut songer à se faire remplacer à la direction de l’hôpital. Elle attendit cependant le retour de M. de Maisonneuve, reparti en France en 1655. Il ne devait revenir qu’à la fin de juillet 1657, en compagnie du premier clergé paroissial de Ville-Marie, qui se composerait de trois sulpiciens sous l’autorité de l’abbé de Queylus [V. Thubières]. Mais le malheur voulut que M. Olier, qui avait choisi lui-même ces quatre missionnaires, s’éteignît quelques jours seulement avant l’embarquement des prêtres. Jeanne, qui s’était hâtée de consulter M. de Maisonneuve à son arrivée, dut remettre à l’année suivante son voyage en France. Son état de santé laissait fort à désirer. Elle partit à l’automne de 1658, en compagnie de Marguerite Bourgeoys, qui était devenue sa fidèle amie. M. de Queylus avait profité du départ prochain de Jeanne Mance, pour faire venir de Québec deux hospitalières. C’était pour faire suite à une promesse qu’il avait faite aux Hospitalières de Québec de leur confier la direction de l’hôpital de Montréal. Les religieuses de Québec durent cependant regagner leur couvent quand revint Jeanne Mance avec les hospitalières de La Flèche.
En France, Jeanne dut accomplir le trajet de La Rochelle à La Flèche sur un brancard. Elle souffrait terriblement de son bras. Avec M. de La Dauversière, elle mit tout au point afin de conduire bientôt dans la Nouvelle-France les trois hospitalières de Saint-Joseph qu’il choisirait lui-même. Elle lui avoua son espoir d’obtenir de Mme de Bullion quelques fonds pour aider à l’établissement de ces religieuses à Montréal. Son succès fut partout complet, et même un événement que l’on a considéré comme miraculeux vint s’y ajouter. À la chapelle des Sulpiciens, ayant posé la relique du cœur de M. Olier sur son bras malade, Jeanne Mance en avait recouvré l’usage. Elle se rembarqua pour la Nouvelle-France avec les mères Judith Moreau de Brésoles, Catherine Macé et Marie Maillet, pour arriver dans la colonie le 7 septembre 1659. Marguerite Bourgeoys était aussi du voyage avec quelques compagnes. M. de La Dauversière, qui s’était rendu à La Rochelle, donna à toutes une dernière bénédiction. Un de ses vœux les plus chers s’accomplissait.
En 1662, Jeanne effectuait son dernier voyage en France. Il s’agissait cette fois de veiller sur un événement de grande importance : la substitution à la Société Notre-Dame de Montréal, démissionnaire, de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, qui devenait seigneur-propriétaire de l’île de Montréal. La Société de Montréal était en train de se dissoudre et, de plus, M. de La Dauversière, l’infatigable fondateur et la providence de Ville-Marie, n’était plus là pour stimuler l’action des Associés. Il était décédé depuis le 6 novembre 1659. Jeanne revint à Montréal en 1664.,
À partir de 1663, de grands changements, s’étaient produits dans le gouvernement de la Nouvelle-France. Louis XIV avait tenu à diriger lui-même les destinées de sa colonie d’outre-mer. Il s’était occupé en premier lieu de dompter les Iroquois. Mais, à Ville-Marie, régnait depuis 1665 la plus grande désolation. M. de Maisonneuve avait été prié de retourner en France pour un congé indéfini. On n’avait tenu nul compte de ses incomparables services depuis 24 ans. Il avait accepté cette décision avec héroïsme et avait quitté la Nouvelle-France à l’automne de 1665. Bientôt Jeanne Mance connut, elle aussi, de la part d’autorités qu’elle vénérait, l’incompréhension de ses gestes sauveurs de jadis. Courageuse toujours et résignée, elle poursuivit sa tâche jusqu’à la fin. Son dernier acte d’administration date de janvier 1673. Elle mourut le 18 juin 1673 « en odeur de sainteté », assure mère Juchereau* de Saint-Ignace dans les Annales de l’Hôtel-Dieu de Québec.
Un tableautin signé L. Dugardin, conservé à l’Hôtel-Dieu de Montréal, semble représenter la figure véritable de Jeanne Mance. En tout cas, on peut lire, au dos de l’œuvre : « Vraie copie du portrait de Mademoiselle Mance ». Identification faite, cette inscription serait de la main de sœur Joséphine Paquet, archiviste de l’Hôtel-Dieu de 1870 à 1889.
Archives de l’hôtel de ville de Langres (Haute-Marne), Registres des baptêmes [...] de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul.— Dollier de Casson, Histoire du Montréal.— JR (Thwaites).— Juchereau, Annales (Jamet).— Morin, Annales (Fauteux et al.).— [Jean-Jacques Olier ?], Les véritables motifs de Messieurs et Dames de la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France, éd. H.-A. Verreau (« MSHM », IX, 1880).— Daveluy, Bibliographie, RHAF, VIII (1954–55) : 292–306, 449–455, 591–606 ; IX (1955–56) : 141–149 ; Jeanne Mance, 1606–1673, suivie d’un Essai généalogique sur les Mance et les De Mance par M. Jacques Laurent. (1ère éd., Montréal, 1934 ; 2e éd., Montréal et Paris, [1962]).— [Étienne-Michel Faillon], Vie de Mademoiselle Mance et histoire de l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie dans l’Ile de Montréal en Canada (2 vol., Paris, 1854).— Robert Le Blant, Notes sur Madame de Bullion, bienfaitrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal, après 1587–26 juin 1664, RHAF, XII (1958–59) : 112–125.— Lefebvre, Marie Morin.— Léo-A. Leymarie, Les commencements de Montréal, Cahiers Catholiques, 132 (1925) : 3 706s.— Mondoux, L’Hôtel-Dieude Montréal— Louis-N. Prunel, Sébastien Zamet, évêque-duc de Langres, 1588–1655 (Paris, 1912).— René Roussel, Le Lieu dé naissance et la Famille de Jeanne Mance (Langres, 1932), extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, X.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Marie-Claire Daveluy, « MANCE, JEANNE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/mance_jeanne_1F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/mance_jeanne_1F.html |
| Auteur de l'article: | Marie-Claire Daveluy |
| Titre de l'article: | MANCE, JEANNE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1966 |
| Année de la révision: | 1986 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |


![Titre original : Melle Jeanne Mance. Fondatrice des Hospitalières de Montréal [image fixe]](/bioimages/w600.724.jpg)