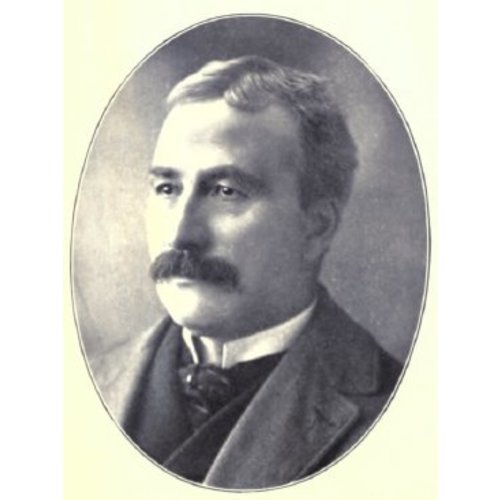Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
PIPES, WILLIAM THOMAS, avocat, homme politique, juge et homme d’affaires, né le 15 avril 1850 à Amherst, Nouvelle-Écosse, fils de Jonathan B. Pipes et de Caroline Fowler ; le 23 novembre 1876, il épousa à Fort Lawrence, Nouvelle-Écosse, Ruth Eliza McElmon, et ils eurent trois filles ; décédé le 7 octobre 1909 à Boston.
William Thomas Pipes était d’ascendance méthodiste du Yorkshire et loyaliste. Il fit ses études à l’Amherst Academy et fut reçu au barreau de la Nouvelle-Écosse en 1875. Il entra en politique trois ans plus tard en se portant candidat libéral dans Cumberland aux élections fédérales contre Charles Tupper*, député de cette circonscription depuis 1867. Il ne pouvait espérer gagner, mais son énergie lui valut les louanges de son parti. Sa victoire dans Cumberland aux élections provinciales de 1882 eut des conséquences inattendues, voire bizarres, car les libéraux se retrouvèrent au pouvoir sans avoir de chef en titre. William Stevens Fielding*, qui avait dirigé officieusement la campagne libérale en sa qualité de rédacteur en chef du Morning Chronicle de Halifax, aurait probablement pu accéder au leadership, mais il refusa parce que ses ressources financières étaient limitées. La formation du cabinet fut donc laissée au caucus, où abondaient les cliques, avec toutes les intrigues et les jalousies que cela supposait. Non seulement le caucus nomma-t-il les trois ministres avec portefeuille, mais il désigna aussi le « premier ministre » (terme par lequel on commençait à désigner le « chef du gouvernement »), poste non reconnu par la loi, donc non rémunéré. À la surprise quasi générale, le choix se porta sur Pipes, qui n’était âgé que de 32 ans et n’avait pas la moindre expérience parlementaire. En le désignant premier ministre sans lui confier de portefeuille, le caucus le plaçait dans une situation impossible : pour subvenir aux besoins de sa famille, Pipes devait tenir un cabinet d’avocat à Amherst, et pour diriger le gouvernement, il devait aussi faire des séjours fréquents, et parfois longs, à Halifax.
Selon son collègue le député libéral James A. Fraser, Pipes était un « homme morose et distant ». Effectivement, le premier ministre ne noua guère de rapports véritables avec d’autres députés que Fielding, qu’il convainquit bientôt d’accepter un poste de ministre sans portefeuille. Mais il avait tout de même des qualités – il n’avait pas son pareil pour rassembler des séries complexes de faits et parvenir à des conclusions difficilement contestables – si bien qu’il traversa sans encombre la session de 1883. Personne, disait-il, ne devait croire que la situation dont il avait hérité était « agréable, et qu’[il avait] trouvé le ciel sans nuage ». Comme le trésor était à sec, le gouvernement fit peu, à part s’occuper des chemins de fer, qui exigeaient une attention immédiate. Dans ce secteur, il prit l’importante décision de ne pas donner suite aux arrangements du précédent gouvernement conservateur de Simon Hugh Holmes*. Obsédé par les chemins de fer et les coûts de plus en plus élevés qu’ils représentaient pour la province, Holmes avait conclu une entente selon laquelle un consortium formé par l’entrepreneur et propriétaire de chemin de fer Edmund W. Plunkett achèterait tous les chemins de fer qui appartenaient à la province. Les modalités de l’entente étaient terriblement complexes, et la somme que la province devait recevoir était imprécise. En outre, la santé financière du consortium laissait à désirer. Pipes refusa absolument de traiter avec une société qui n’existait que sur papier et dans laquelle les administrateurs n’avaient personnellement rien investi : « Nous n’avons pris, disait-il, que les précautions que nous aurions jugées nécessaires si nous avions traité notre propre affaire. » Le gouvernement résolut aussi d’emprunter 2,46 millions de dollars et, dans les faits, de créer une dette provinciale, et ce dans un double but : acheter au gouvernement fédéral la section de Pictou du chemin de fer Intercolonial ; acheter aux intérêts privés qui en étaient propriétaires l’Eastern Extension Railway, qui devait relier New Glasgow au détroit de Canso, et le terminer. Selon Pipes, tout cela ouvrirait « de nouvelles avenues au commerce [...] et donnera[it] un nouvel élan à la prospérité [provinciale]. Alors, poursuivait-il, devrions-nous rester là à trembler et tourner casaque, effrayés par cette crise dans l’histoire de notre pays ? »
Au cours de la session, les problèmes personnels de Pipes se manifestèrent de façon poignante. Un jour, il écrivit d’Amherst à Fielding que sa femme était « très faible » et allaitait un bébé de six mois dont les pleurs incessants nuisaient à son rétablissement, mais que bien qu’il ait été « très démoli » lui-même, il irait à Halifax si sa présence était indispensable. Entre-temps, Fielding devait demander de l’aide à James Wilberforce Longley* ou à quelque autre membre du gouvernement qu’il jugeait capable. Le fait que Pipes s’appuyait sur un ministre d’État révèle à quel point ses relations avec les ministres à portefeuille étaient tièdes.
En 1884 non plus, le gouvernement ne proposa pas grand-chose. Après s’être rendus à Ottawa plusieurs fois, Pipes et Fielding conclurent que les conditions posées par le gouvernement fédéral au transfert de l’embranchement de Pictou étaient inacceptables. Réaliser la transaction reviendrait, disait Pipes, à « prendre un quart ou un demi-million de dollars et à les jeter dans le détroit de Canso ». Son gouvernement renonça donc à ses projets ferroviaires et vendit au gouvernement fédéral ses intérêts dans l’Eastern Extension Railway. Quand le Morning Herald de Halifax, organe de l’opposition, critiqua les dispositions financières de la vente et accusa Pipes et Fielding d’essayer de « faire avaler de force [une mauvaise affaire] à leurs partisans », ils répliquèrent que, étant donné les limites définies par Ottawa, ils n’auraient pu faire mieux. Pipes laissa même entendre que, en pratique, le gouvernement fédéral avait intégré l’Eastern Extension Railway au chemin de fer Intercolonial, ce qui impliquait qu’il s’était engagé à construire dans l’île du Cap-Breton le chemin de fer que ses représentants réclamaient depuis un moment.
Au début de 1884, le gouvernement Pipes fit savoir qu’il présenterait sous peu des revendications financières à Ottawa. Comme le précédent gouvernement conservateur avait déjà réduit les dépenses au maximum, Pipes n’avait réussi à faire que de petites économies. En fait, en équilibrant son budget par des réductions de services draconniennes, la province avait amoindri ses chances d’obtenir l’amélioration des modalités financières de son union avec le reste du Canada qu’elle réclamait depuis longtemps. Fraser prit le cabinet de vitesse en présentant des motions bien senties qui exigeaient de meilleures conditions et demandaient si la Nouvelle-Écosse « devrait [...] toujours s’aplatir devant les hommes politiques d’Ottawa » et ne jamais pouvoir atteindre le « glorieux trône » de Sa Majesté sans passer « par les mesquineries et les embûches de la politique canadienne ». À la demande de Pipes, Fraser retira ses motions afin que la Chambre puisse en présenter une qui recueillerait l’unanimité, mais la formulation en était si modérée que Fraser prédit qu’elle ne donnerait rien.
La session de 1884 avait beau s’être bien passée pour Pipes, ses difficultés financières, familiales et personnelles persistaient. Le lieutenant-gouverneur Matthew Henry Richey le trouvait bien réservé, même avec ses ministres à portefeuille. Ceux-ci avaient soulevé des objections quand il avait nommé Fielding au Conseil exécutif sans les consulter, et ils avaient résisté aux tentatives visant à doter Fielding ou lui-même d’un poste ministériel rémunéré. En mai 1884, Pipes soumit, à titre hypothétique, plusieurs questions à Richey. Sa démission entraînerait-elle la dissolution du ministère ? Le lieutenant-gouverneur répondit par l’affirmative. S’il recommandait un successeur, Richey l’accepterait-il ? Oui, si le ministère paraissait agir de concert et avait la majorité à l’Assemblée.
Le 14 juillet, Pipes remit sa démission et, sur sa recommandation, on nomma Fielding à sa place. Il s’ensuivit un débat sur la question de savoir si les usages britanniques s’appliquaient en Nouvelle-Écosse. Dans une lettre au Morning Herald, un citoyen affirma que le lieutenant-gouverneur était tenu de suivre l’avis de la majorité du Conseil exécutif, et non celui d’un soi-disant premier ministre. Certains conseillers exécutifs entreprirent une « sorte de protestation ». Ils dirent à Richey que la démission du chef du gouvernement n’entraînait pas la dissolution du ministère puisque, en vertu des mandats délivrés au lieutenant-gouverneur avant la Confédération, celui-ci devait agir sur l’avis de son Conseil exécutif et que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique stipulait que le Conseil exécutif demeurait inchangé. Toutefois, il n’y avait aucun doute pour Richey : le ministère Pipes n’existait plus.
Selon un témoignage apocryphe, lorsque Fielding avait demandé à Pipes qui allait lui succéder, il avait reçu en guise de réponse ce verset du Deuxième Livre de Samuel : « Natân dit alors à David : « Cet homme, c’est toi ! » (chap. xii, 7) En constituant son ministère, Fielding connut, avec les « fauteurs de troubles » du caucus, des difficultés identiques à celles que Pipes avait rencontrées naguère. Au bout de deux semaines, il obtint le poste de secrétaire de la province pour lui-même mais non celui de procureur général pour Pipes. Toutefois, ce dernier le félicita d’avoir donné une leçon aux députés récalcitrants et ajouta que, s’ils ne soutenaient pas Fielding à son élection ministérielle à Halifax, il « les abreuverai[t] d’injures et leur dirai[t] qu’ils [devaient le] faire élire coûte que coûte ». « J’en suis capable, poursuivait-il. Ils ne veulent rien savoir de ce « chenapan » de Pipes. »
Pipes assista régulièrement à la session de 1885. Il prit bien soin de ne pas plonger Fielding dans l’embarras, surtout lorsqu’il réagit à la motion franche dans laquelle Fraser réclamait l’abrogation de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Soulignant qu’il avait toujours été favorable à la Confédération, il fit valoir que la question de « l’abrogation n’avait jamais été soulevée » aux dernières élections, que pas un seul de ses électeurs ne lui en avait parlé et que, si quelqu’un devait proposer pareille chose, c’étaient les députés fédéraux de la province. Néanmoins, il appuya l’amendement de Fielding selon lequel la Nouvelle-Écosse devrait examiner la possibilité de l’abrogation si elle n’obtenait pas rapidement un allègement. Pour lui, c’était le meilleur moyen d’écarter la question et de mettre un terme au « tintamarre de cymbales retentissantes et d’airain résonnant qui accompagnait la vaine poursuite du spectre trompeur de l’abrogation ».
Comme Ottawa ne réagissait pas, Fielding présenta en 1886 sa propre motion abrogatoire. Pipes se contenta de déclarer que si l’on obtenait l’abrogation, seule l’union commerciale ou l’annexion permettrait à la Nouvelle-Écosse de bénéficier de la réciprocité avec les États-Unis que tout le monde semblait souhaiter. À ceux qui l’accusaient de déloyauté, il répliqua que la Nouvelle-Écosse serait « moins apte, en tant que petite contrée au commerce insignifiant, à obtenir la réciprocité [après l’abrogation] que si [la province] restait ce qu’[elle] était ». Les résolutions de Fielding furent adoptées à 15 voix contre 6, Pipes ne les ayant pas appuyées. Plus tard en 1886, le premier ministre remporta aisément les élections provinciales, au cours desquelles la question de l’abrogation fut chaudement débattue.
Pipes ne se présenta pas à ce scrutin, probablement parce qu’il s’opposait à l’abrogation, mais il fut amené à se porter candidat dans Cumberland aux élections fédérales de 1887. Au début, son adversaire n’était pas Tupper, mais celui-ci ayant été rappelé d’Angleterre pour prêter main forte aux conservateurs en Nouvelle-Écosse, les deux hommes se trouvèrent de nouveau face à face. Pipes défendit vigoureusement la réciprocité et condamna l’extravagance et la corruption. Il ne gagna pas, mais il se battit si bien contre Tupper que la vieille garde du Parti libéral le considéra quasiment comme un héros. Peut-être parce qu’il n’avait pas la politique dans le sang, il laissa passer presque 20 ans avant de briguer de nouveau les suffrages. Comme le disait un journal de New Glasgow, courtiser les électeurs lui inspirait « un dégoût quasi inexplicable » et « les ruses des solliciteurs [de votes] lui [étaient] inconnues ». Au lieu de faire de la politique, il fut juge successoral dans le comté de Cumberland à compter de 1887 et s’employa à consolider sa situation financière. Heureusement pour lui, le comté de Cumberland se trouvait dans une région de la province qui bénéficiait de la Politique nationale. Il devint actionnaire, et parfois administrateur, de la plupart des industries d’Amherst ainsi que de propriétés forestières situées dans tous les coins de la province.
Pipes demeura toutefois lié à Fielding et au Parti libéral. À la fin de 1887, Fielding, dans la gêne, sollicita de lui un emprunt de 1 000 $ en lui offrant une police d’assurance-vie en garantie. Pipes ne put apparemment pas l’obliger puisque Fielding s’adressa ailleurs. En 1891, au cours d’un déjeuner, Fielding se demanda si Pipes accepterait de combler une vacance au Conseil législatif. Ce dernier répondit, par lettre, qu’il serait à son « service [...] si cela était pour le mieux », et précisa qu’il ne posait pas sa candidature, mais se contentait de donner une réponse. Il n’eut pas le poste.
Une passe d’armes survenue en 1894–1895 éclaire davantage les relations entre les deux hommes. Furieux que les libéraux n’aient présenté aucun candidat à une élection partielle dans Cumberland, Pipes pressa Fielding et ses collègues d’être « des chefs de file en fait et en titre » et de ne pas rester « muets comme des carpes ». Fielding répondit, avec « franchise et simplicité égales », que Pipes ne devait pas espérer soulager sa conscience politique en ne faisant rien d’autre que rouspéter contre des amis qui consacraient du temps, des efforts et de l’argent à leur parti. Un homme aussi doué que Pipes, disait-il, ne devait pas se contenter d’être sous-fifre, et « mutin » en plus. Sans repentir, Pipes répéta qu’on ne gagnait pas les élections avec des motions, des discours et des batailles sans suite. Et puis de toute façon, pourquoi devrait-il donner son avis à Fielding ? « Vous savez tout. Rien à apprendre. Ô heureux homme ! » Piqué d’avoir été accusé de mutinerie, il demanda si c’était être un mutin que d’attaquer ceux qui étaient prêts à abandonner la victoire électorale pour « le spectre de l’abrogation ». Fielding répliqua que le terme de mutinerie ne s’appliquait à aucun de ses actes en particulier mais à ses « grommellements et ronchonnements » continuels : « Ne vous contentez pas de chercher des poux [...] Faites sentir [aux autres libéraux] que vous êtes avec eux. »
Pipes perdit sa femme en 1894, ce qui l’affecta durant des mois, mais comme ses enfants étaient grands, du moins aucun obstacle familial ni financier ne l’empêchait-il plus de faire de la politique active. Sur l’invitation de George Henry Murray*, successeur de Fielding au poste de premier ministre, il devint leader du gouvernement au Conseil législatif et membre du Conseil exécutif en janvier 1898. Pendant neuf ans, il fut le porte-parole du gouvernement à la Chambre haute et présida le comité des projets de loi gouvernementaux, où il déploya toutes ses compétences d’avocat. En dépit de sa réputation, il se montra presque toujours conciliant. Toutefois, lorsque le président du Conseil législatif, Robert Boak, et la plupart des conseillers refusèrent d’entendre même en première lecture un projet de loi gouvernemental visant à abolir le conseil, il leur dit sa façon de penser. La plupart d’entre eux, au moment de leur nomination, s’étaient engagés à accepter l’abolition, mais à présent, ils s’appuyaient sur l’opinion de distingués juristes selon qui, malgré leur promesse, ils ne pouvaient rendre un jugement indépendant sur le sujet. Pipes qualifia leur position d’« illogique et intenable [...] d’un côté [ils] disaient que les promesses ne valaient rien, et de l’autre affirmaient n’être pas liés par elles, et n’être pas libres d’agir ».
Pipes obtint son affectation politique suivante grâce à Fielding, qui eut toujours un faible pour celui qui avait recommandé son accession au poste de premier ministre. En 1904, Fielding, alors ministre fédéral des Finances, proposa à Murray une série complexe de nominations fédérales et provinciales, dont celle de Pipes au poste ministériel de commissaire des Travaux publics et des Mines de la Nouvelle-Écosse. Des dissensions au sein du parti empêchèrent Pipes d’accéder au poste avant 1905, et il n’entra à l’Assemblée qu’après les élections de 1906. En mars 1907, il passa à ses dernières fonctions, celles, plus prestigieuses, de procureur général et de commissaire des Terres de la couronne. En tant que ministre à portefeuille, il se montra équitable, comme toujours, et ne manifesta de la brusquerie qu’à l’occasion.
Pour le premier ministre, il se révéla le meilleur des atouts. Sans aucun doute joua-t-il un rôle important dans deux initiatives positives du gouvernement Murray, qui d’habitude ne se signalait pas par son audace. Il fit adopter à l’Assemblée un projet de loi en faveur d’une vérification indépendante des comptes publics auquel le gouvernement s’était opposé auparavant. De plus, il présenta un projet de loi en vue d’instituer un conseil des services publics, le premier du genre au Canada ; c’est lui qui le fit adopter à la Chambre, et peut-être même en était-il l’auteur. Il affirmait aussi avoir fait adopter, à titre de procureur général, la loi sur la tempérance la plus sévère jamais appliquée jusque-là en Nouvelle-Écosse. Toutefois, il reconnaissait la quasi-impossibilité d’empêcher le trafic d’alcool entre les comtés non prohibitionnistes et ceux qui l’étaient.
En qualité de commissaire des Terres de la couronne, Pipes eut à affronter l’impétueux Charles Smith Wilcox, infatigable censeur du département. Celui-ci affirmait que la préservation des forêts pouvait être « assurée par la loi aussi efficacement que par l’éducation populaire », ce que Pipes s’employa à réfuter en 1908. L’année suivante, comme Wilcox l’accusait d’avoir retardé l’inventaire forestier de la province qu’il avait promis de faire, il signala quelles étapes préliminaires avaient été franchies. Après la session, il fit deux voyages, en bonne partie pour cet inventaire. Il mourut subitement au cours du second, à Boston, d’une crise cardiaque ou d’apoplexie.
George Murray, qui était rarement démonstratif, déclara que William Thomas Pipes avait été « plus qu’un collègue », un « compagnon personnel » pendant des années. Homme à la double nature, il avait souvent des allures bourrues, mais quand il le voulait, il était plus agréable que quiconque. Sans être un homme politique pratique, être doté d’une éloquence frappante et avoir cultivé sa popularité, il connut le succès. Le Daily News, d’Amherst, louait « son physique agréable, sa présence magnétique, sa façon de parler convaincante et énergique », qui, alliés à un discours « logique et plein de substance », faisaient qu’il gagnait toujours l’attention des auditeurs. Grâce à sa grande intelligence, il avait acquis en droit une compétence de premier ordre. Sa conduite publique et privée fut toujours irréprochable, et personne ne mit jamais son intégrité en doute.
Beaucoup de renseignements sur William Thomas Pipes figurent dans notre étude intitulée Politics of N S. On trouve de la documentation additionnelle dans l’ouvrage de [C.] B. Fergusson, Hon. W. S. Fielding (2 vol., Windsor, N.-É., 1970–1971), 1. La principale source pour ce qui est de sa carrière est constituée par les Debates and proc. de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse pour 1883–1886 et 1907–1909 ; sont également utiles les Debates and proc. du Conseil législatif pour 1898–1906, les Journal and proc. de la Chambre d’assemblée pour 1883–1886 et 1898–1909, et les Statutes pour la même période. Des sources manuscrites importantes comprennent des lettres dans les papiers Macdonald aux AN, MG 26, A, 117 ; les papiers Fielding aux PANS, MG 2, 490 et 503 ; et, surtout, un dossier de correspondance entre Pipes et Fielding aux PANS, MG 100, 208. Des numéros du Morning Chronicle, du Morning Herald de Halifax, et de son successeur, le Halifax Herald, ont servi pour toute la période ainsi que les articles et éditoriaux parus au moment de sa mort dans le Daily News (Amherst, N.-É.), particulièrement le 8 oct. 1909, et dans le Eastern Chronicle, particulièrement le 12 oct. 1909. [j. m. b.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
J. Murray Beck, « PIPES, WILLIAM THOMAS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/pipes_william_thomas_13F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/pipes_william_thomas_13F.html |
| Auteur de l'article: | J. Murray Beck |
| Titre de l'article: | PIPES, WILLIAM THOMAS |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1994 |
| Année de la révision: | 1994 |
| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |