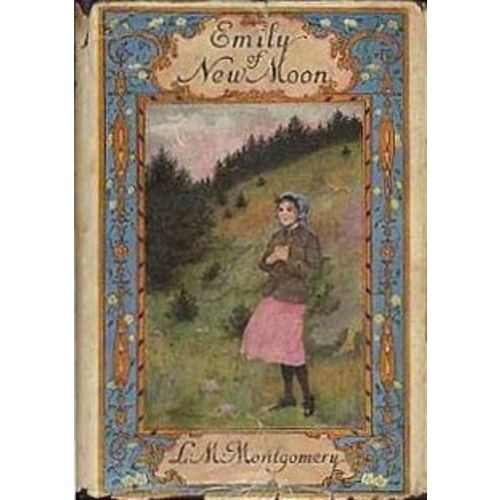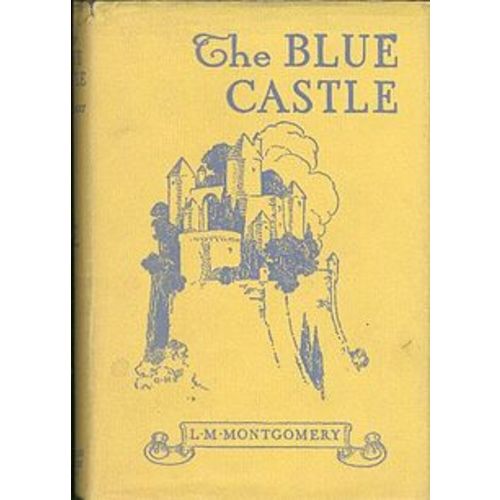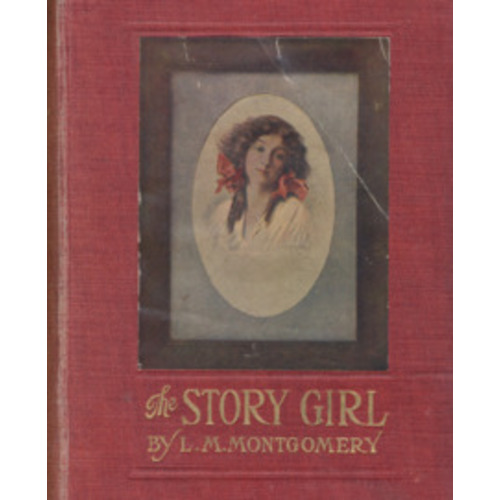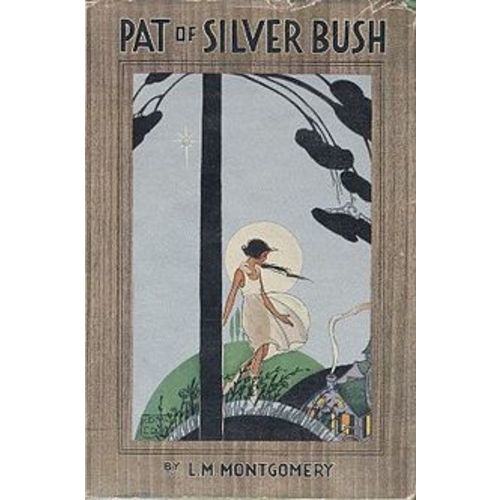Provenance : Lien
MONTGOMERY, LUCY MAUD (Macdonald), auteure d’un journal intime, écrivaine, institutrice, journaliste et conférencière, née le 30 novembre 1874 à Clifton (New London, Île-du-Prince-Édouard), fille unique de Hugh John Montgomery et de Clara Woolner Macneill ; le 5 juillet 1911, elle épousa à Park Corner, Île-du-Prince-Édouard, le révérend Ewen (Ewan) Macdonald (décédé en 1943), et ils eurent trois fils, dont le deuxième mourut à la naissance ; décédée le 24 avril 1942 à Swansea (Toronto), et inhumée à Cavendish, Île-du-Prince-Édouard.
Lucy Maud Montgomery, qu’on appelait Lucy Maud et Maudie quand elle était enfant, et Maud à l’âge adulte (elle affirma une fois que « [ses] amis [l]’appel[aient] “Maud” et rien d’autre »), fut élevée à Cavendish, près de la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard ; sous le nom fictif d’Avonlea, cette belle communauté rurale servit de décor à son roman le plus célèbre, Anne of Green Gables. Lucy Maud était issue de deux des plus éminentes familles de propriétaires fonciers de la province. Tant les Macneill que les Montgomery s’enorgueillissaient de liens avec des clans écossais distingués, dont certains membres étaient des auteurs publiés, et avec des parents actifs sur la scène politique de l’île. À mesure qu’elle prenait de la maturité, Lucy Maud se rendait compte de la tension entre son « sang passionné de Montgomery » et sa « conscience puritaine de Macneill ». Elle savait aussi qu’elle était née dans une famille que Cavendish jugeait de haut statut, parce que ses ancêtres s’étaient établis depuis longtemps au Canada, qu’ils avaient des liens avec la mère patrie, qu’ils jouissaient d’une sécurité financière et qu’ils exerçaient une influence politique. Sa mère mourut de tuberculose lorsqu’elle avait 21 mois ; son père, énergique mais irresponsable, laissa sa fille à la garde de ses grands-parents maternels, Alexander Marquis et Lucy Ann Macneill, née Woolner, qui appartenait à une autre famille importante de l’île. Quatre ans plus tard, il partit pour l’Ouest canadien en quête d’une fortune qu’il n’atteindrait jamais, abandon parental qui fournirait à Lucy Maud le thème récurrent de l’orphelin. Malgré la fierté qu’elle tirait de ses origines et le confort de sa vie quotidienne, qu’elle partageait avec de nombreux compagnons de jeu, Lucy Maud, une fois adulte, se souviendrait de son enfance comme d’une période où elle ne se croyait ni désirée ni aimée. Elle était une petite fille passionnée, expressive, souvent blessée par le langage acéré et sarcastique de son grand-père et l’autorité stricte de sa grand-mère. Elle se rendit rapidement compte que les garçons bénéficiaient de privilèges et pouvaient caresser des ambitions jugées inutiles ou inappropriées pour les filles.
Cavendish était un village agricole très uni, autosuffisant et plutôt isolé, peuplé d’Écossais et d’Anglo-Écossais sobres, laborieux et instruits. Il y avait une bonne école, deux églises (une presbytérienne, pour laquelle les Macneill avaient donné le terrain, et une baptiste, qui avait été fondée par des presbytériens mécontents), une salle de réunion pour accueillir des conférenciers itinérants, et un cercle littéraire qui faisait venir les livres les plus récents du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. Lucy Maud avait de nombreux cousins et autres camarades, et, malgré la perte de sa mère et l’absence d’un père idolâtré, elle passa une petite enfance heureuse et insouciante à jouer au bord de la mer, dans les champs avoisinants et les forêts pittoresques. Son amour profond pour la nature et la beauté de l’île occuperaient une place importante dans son œuvre.
Dès son jeune âge, Lucy Maud révéla des aptitudes pour écrire et raconter des histoires. À bien des égards, elle avait une vie idéale pour une future romancière. Le bureau de poste du village était tenu à même la cuisine familiale, ce qui permettait aux Macneill d’avoir une connaissance unique des affaires de leurs voisins. Lucy Maud était imprégnée de la tradition orale écossaise : elle écoutait son grand-père, maître conteur, transformer en histoires des événements locaux, tant passés que présents, et elle assimilait les structures et techniques des récits parlés. Elle assistait aux lectures quotidiennes de la version de la Bible King James et aux récitations fréquentes des œuvres de poètes favoris. Grâce à la bibliothèque familiale, à une bibliothèque de prêt novatrice et à un bon système scolaire, elle avait également accès à plus de livres que la plupart des enfants qui vivaient à l’extérieur de centres urbains. La collection de ses grands-parents comprenait les livres de lecture que ses tantes et ses oncles avaient utilisés à l’école, ainsi que des ouvrages commandés par la famille et ceux qu’apportait son oncle, Leander George Macneill, ministre brillant et réputé de Saint John, quand il venait en visite pendant les vacances d’été. Lectrice vorace à la mémoire fidèle, Lucy Maud recherchait des œuvres d’écrivains écossais, anglais et américains, notamment Robert Burns, sir Walter Scott, sir James Matthew Barrie, John Bunyan, William Wordsworth, lord Byron, Jane Austen, les sœurs Brontë, George Eliot, Edward Bulwer-Lytton, lord Tennyson, John Greenleaf Whittier, Henry Wadsworth Longfellow et Mark Twain. Puisque la plupart des familles locales étaient apparentées et vivaient à Cavendish depuis plusieurs générations, Lucy Maud pouvait à loisir observer des modèles de relations entre parents et diverses personnalités. Les membres de sa famille décourageaient son intérêt précoce pour l’écriture, qu’ils dénigraient et qualifiaient de « gribouillage », l’invitant plutôt à poursuivre des objectifs plus pratiques jugés convenables pour une femme. Toute sa vie, elle serait indignée par l’attitude de dérision des siens à l’égard des efforts littéraires de sa jeunesse et de ses tentatives de trouver un exutoire à son énergie créatrice exceptionnelle.
D’autres irritants psychologiques néfastes assombrissaient son univers généralement idyllique. Ses grands-parents, qui avaient déjà élevé six enfants, avaient atteint la cinquantaine quand Lucy Maud se joignit à leur ménage, et leur presbytérianisme écossais strict s’accentua avec l’âge. Lucy Maud était une enfant d’une grande intelligence, mais hypersensible et d’humeur changeante ; au fur et à mesure qu’elle grandissait, son tempérament impulsif devint plus difficile à maîtriser, et ses grands-parents se tourmentaient au sujet de sa conduite et des commérages qu’elle occasionnait. À l’instar d’Anne Shirley, personnage de ses futurs romans, l’instable Lucy Maud oscillait entre les rêves les plus fous et le « désespoir le plus profond ». Ces comportements extrêmes entraînaient des remarques négatives de la part de ses tantes et de ses oncles, et plus ses grands-parents essayaient de la guider et de la contenir, plus elle se sentait isolée, différente, persécutée. Elle avait idéalisé son père, mais après avoir passé l’année 1890–1891 avec lui et sa nouvelle famille à Prince Albert (Saskatchewan), elle dut admettre qu’il se préoccupait peu de son bien-être. La femme de ce dernier, Mary Ann McRae, qui avait 23 ans de moins que lui et était une nièce du magnat des chemins de fer William Mackenzie*, avait donné naissance à une fille et était enceinte de trois mois quand Lucy Maud, premier enfant de Hugh John Montgomery, vint habiter avec eux au mois d’août. Hostile à Lucy Maud, qui demandait beaucoup d’attention sur le plan psychologique, Mary Ann lui rendit la vie misérable, la retirant de l’école pour qu’elle s’occupe des enfants et aide aux tâches ménagères. N’ayant trouvé ni accueil bienveillant ni soutien, l’adolescente, qui avait alors 16 ans, retourna chez ses grands-parents en août 1891. Pendant son séjour à Prince Albert, elle avait toutefois publié sa première œuvre, un poème, dans le Patriot de Charlottetown, ce qui lui donna l’espoir de devenir un jour une auteure professionnelle. Ses premiers écrits révèlent un grand raffinement et un style élégant. Plus tard, elle déclarerait que ce fut durant cette période qu’elle « avait appris la première leçon, la dernière [leçon] et [celle] du milieu : “Ne jamais renoncer !” »
De retour à l’Île-du-Prince-Édouard, Lucy Maud entrevit le morne avenir réservé aux femmes célibataires et choisit le parcours d’études traditionnel, celui pour devenir institutrice. Excellente étudiante, elle accomplit deux années de formation en une seule (1893–1894) au Prince of Wales College de Charlottetown, alors dirigé par Alexander Anderson*. Longtemps après, elle décrirait cette année comme « la plus heureuse de [sa] vie ». Désormais titulaire d’un brevet d’enseignement, elle trouva un poste à Bideford. En juillet 1894, elle commença à travailler avec 20 enfants âgés de 6 à 13 ans ; enseignante talentueuse, elle finirait par avoir 60 élèves. Avec cette discipline qu’elle garderait toujours, elle consacrait chaque jour quelques heures à écrire de la prose et de la poésie pour des journaux et magazines, industrie en plein essor en raison de l’amélioration de l’instruction du public et de nouvelles méthodes de diffusion du matériel imprimé.
On attendait des jeunes femmes qu’elles enseignent jusqu’à ce qu’elles se marient, puis qu’elles se rangent pour élever une famille. Lucy Maud économisa plutôt son argent et, avec le soutien financier de sa grand-mère, elle put aller étudier au Dalhousie College de Halifax en 1895–1896. Son professeur le plus influent fut Archibald McKellar MacMechan*. L’un des pionniers dans la promotion de la littérature canadienne, il reconnut le talent de son étudiante qui trouva ses éloges extrêmement réconfortants. Tout en travaillant à ses cours, elle continua d’écrire et réussit à publier d’autres textes. Ce fut une année d’intense activité physique, mentale et sociale, mais elle manqua d’argent pour poursuivre ses études (et fut amèrement contrariée par le fait que son cousin Murray Macneill, esprit universel talentueux, lui aussi étudiant du Dalhousie College, bénéficierait d’aide et d’encouragement pour continuer les siennes). Elle retourna au métier épuisant et mal rémunéré d’institutrice en région rurale. Elle se fixa d’abord à Belmont, en 1896–1897, où elle se fiança à un cousin intelligent, séduisant et attentif, Edwin Simpson. Elle se sentait seule, et recherchait l’affection d’un mari et la joie d’avoir des enfants ; de plus, comme elle croyait qu’il avait l’intention de devenir avocat, elle pensait qu’épouser un homme de profession libérale lui apporterait la sécurité financière nécessaire à la poursuite de sa carrière littéraire. Or, elle le trouva bientôt repoussant physiquement et émotionnellement. Elle se sentit prise au piège et, de plus en plus consciente de ses propres sautes d’humeur extrêmes, avait soif de stabilité et d’une vie structurée. Elle enseigna à Lower Bedeque en 1897–1898, où elle tomba passionnément amoureuse d’un jeune cultivateur, George Herman Leard (il fut toujours connu sous son second prénom), peut-être déjà fiancé. Au printemps, elle écrivit à Edwin Simpson pour réclamer sa liberté. Pendant cette période très difficile, elle vendit régulièrement des poèmes et des récits à des périodiques au Canada et aux États-Unis.
Lucy Maud était convaincue qu’elle pourrait gagner sa vie comme auteure si elle se consacrait à l’écriture à plein temps. En mars 1898, son acariâtre grand-père Macneill mourut subitement. Cet événement donna l’occasion à Lucy Maud d’échapper à ses frustrations d’enseignante et à sa relation compliquée avec Leard au sujet duquel elle déclara dans son journal qu’elle « ne pourrait jamais [l’]épouser ». Elle retourna à son Cavendish bien-aimé pour vivre avec sa grand-mère veuve, qui lui avait toujours manifesté de la sympathie, même si elle ne comprenait pas les motivations de sa petite-fille et son tempérament hautement versatile. Lucy Maud gagna le respect de la collectivité en s’occupant de sa parente âgée et, dans cet environnement familier sûr, elle disposait de plus de temps pour écrire. En gérant le bureau de poste installé dans la cuisine, elle avait un accès continu au milieu ambiant et aux commérages – d’où elle tira la substance de ses livres –, et pouvait expédier ses textes à des éditeurs sans que personne le sache.
De 1898 à 1911, Lucy Maud connut une période dorée, au cours de laquelle elle établit solidement sa réputation d’auteure professionnelle en publiant des centaines de récits et de poèmes, ainsi que, en 1908, son premier roman : Anne of Green Gables, qui deviendrait le plus célèbre et connaîtrait un succès durable. Pendant un intermède de neuf mois, de septembre 1901 à juin 1902, elle travailla à Halifax pour le Daily Echo à titre de correctrice d’épreuves et de journaliste, mais, quand son oncle John Franklin Macneill essaya de mettre sa mère vieillissante à la porte de la maison où elle avait vécu toute sa vie de femme mariée, Lucy Maud fut ravie de retourner à Cavendish pour défendre les droits de sa grand-mère. Elle désirait se marier et, éventuellement, avoir des enfants, mais il n’y avait pas de prétendant valable dans ce village. Puis, en 1903, le tout nouveau révérend Ewen Macdonald y fut engagé comme ministre presbytérien. Cet homme réservé, rigide et peu sûr de lui, s’éprit du charme exceptionnel de Lucy Maud, de son sens de l’humour, de sa conversation spirituelle et de ses talents de conteuse. Il avait quatre ans de plus qu’elle, parlait le gaélique et ses grands-parents paternels avaient quitté l’île de Skye, en Écosse, pour s’établir à Bellevue, de l’autre côté de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle fut attirée par Ewan (c’est ainsi qu’elle écrivait son prénom), cet homme bon et aimable, et ils se fiancèrent en secret le 12 octobre 1906. Ils s’entendirent pour retarder le mariage jusqu’après la mort de sa grand-mère Macneill. Ragaillardi par cet engagement et confiant en son avenir, Ewan partit acquérir une formation supplémentaire à la University of Glasgow. Une fois en Écosse, il se sentit toutefois mal à l’aise et intellectuellement inadapté dans ce milieu, et sombra bientôt dans une dépression nerveuse. Ses lettres sporadiques, étranges, alarmèrent sa fiancée. Il revint à la maison au début du printemps de 1907 sans autres titres de compétence, et finit par trouver un poste si éloigné de Cavendish que Lucy Maud et lui ne purent passer de temps ensemble pour mieux se connaître.
Comme Ewan, Lucy Maud avait été stimulée par leurs fréquentations et leurs fiançailles, et l’exaltation engendrée par cette idylle avait entraîné la rédaction du manuscrit d’Anne of Green Gables. En 1917, dans une série d’articles publiés par le magazine Everywoman’s World (qui seraient réimprimés sous la forme d’une monographie intitulée The alpine path), elle écrirait que le manuscrit avait été refusé cinq fois avant d’être accepté en 1907 par la L. C. Page Company de Boston, qui publia aussi les écrits des Canadiens Margaret Marshall Saunders, Charles George Douglas Roberts et William Bliss Carman*. L’histoire d’Anne Shirley, orpheline intelligente, pleine d’imagination et loquace, envoyée par erreur chez un frère et une sœur âgés qui voulaient plutôt un garçon, eut un succès monstre. Bien qu’il existe des exemplaires datés d’avril 1908, Lucy Maud reçut le sien le 20 juin ; le 30 du même mois, le directeur de la maison d’édition, Louis (Lewis) Coues Page, annonça qu’il avait lancé un deuxième tirage de ce livre au succès immédiat. Désormais célèbre et sollicitée, Lucy Maud pouvait envisager une carrière à l’abri des soucis financiers. Ses écrits furent tout de suite populaires à l’extérieur du Canada, avec des traductions en néerlandais et en suédois qui parurent en moins d’un an. Page était impatient de faire paraître une suite, et le roman Anne of Avonlea, publié en 1909, connut des ventes énormes. Kilmeny of the orchard, assemblage d’autres textes publiés auparavant dans des magazines, parut en 1910. Cet automne-là, Lucy Maud fut invitée à rencontrer le gouverneur général, lord Grey*, admirateur enthousiaste qui vint en visite à l’Île-du-Prince-Édouard au cours d’une tournée au Canada. Il était entouré du médecin et poète John McCrae* et du professeur de lettres classiques de la McGill University John Macnaughton, collègue du compatriote de Lucy Maud, Andrew Macphail*. Le rendez-vous eut lieu à la résidence de ce dernier, à Orwell.
Tout en se réjouissant de sa réussite, Lucy Maud éprouvait de profondes inquiétudes quant à la santé psychologique de l’homme qu’elle avait accepté d’épouser. Elle-même connaissait des variations brusques d’humeur et de comportement, caractérisées par de l’insomnie, de l’épuisement et une frénésie mentale, qui l’effrayaient. En 1910, en quête d’une promotion, Ewan obtint un poste à Leaskdale, agglomération rurale au nord de Toronto, où il desservait deux paroisses. Après la mort de Lucy Ann Macneill, l’année suivante, Lucy Maud et Ewan se marièrent et, pendant l’été, à la faveur des énormes redevances de l’auteure, entreprirent une longue lune de miel en Écosse et en Angleterre. Elle visita des lieux décrits dans ses poèmes et romans favoris, et fit la connaissance du journaliste écossais George Boyd MacMillan, avec qui elle était en relation épistolaire depuis 1903. Elle échangerait des lettres avec lui et avec Ephraim Weber, professeur dans l’Ouest canadien, jusqu’à peu avant sa mort. Elle trouvait dans cette correspondance une stimulation intellectuelle qu’elle n’obtiendrait pas auprès de son mari, comme elle finirait par le découvrir.
Lucy Maud Montgomery passa les 31 dernières années de sa vie en Ontario, mais elle retournait fréquemment dans sa province natale – « la seule île qui soit » –, décor de presque tous ses romans. The Blue Castle y fait exception : l’histoire se déroule dans le district de Muskoka, en Ontario, où les Macdonald passeraient leurs vacances dans les années 1920. L’intrigue de Jane of Lantern Hill s’amorce dans un Toronto malsain et se déplace dans l’île roborative. Certains de ses derniers ouvrages furent inspirés par des personnes et événements liés aux paroisses ontariennes de son mari, par exemple A tangled web, ou influencés par des amis torontois comme Helen MacMurchy*, qui servit probablement de modèle pour la femme médecin dans Magic for Marigold. Lucy Maud se familiarisa rapidement avec ses nouvelles fonctions de maîtresse du presbytère, d’organisatrice de la plupart des activités de l’église et de membre de nombreuses associations communautaires. Chaque matin, elle écrivait assidûment pendant plusieurs heures. Pour satisfaire son éditeur, qui faisait fortune avec ses travaux, elle accepta d’écrire encore un autre livre sur Anne, même si elle s’était lassée de ce personnage et trouvait généralement que les suites étaient des corvées. Elle continua d’envoyer de courts textes à des magazines. En 1911 parut The Story Girl, suivi en 1912 de Chronicles of Avonlea, recueil de nouvelles qu’elle avait remaniées pour mettre Anne en scène dans des rôles secondaires. Elle se rendait à Toronto, où elle prononçait des conférences devant des organismes tels que le Canadian Women’s Press Club et était louangée par le milieu littéraire, dont faisaient partie Marjory Jardine Ramsay MacMurchy*, qui prit Lucy Maud sous son aile, et Mary Esther MacGregor [Miller*], connue sous le nom de Marian Keith, qui serait l’une de ses collaboratrices pour une compilation de biographies intitulée Courageous women. Les Macdonald fondèrent leur famille l’année suivant leur mariage avec l’arrivée de Chester Cameron. Hugh Alexander mourut à la naissance en 1914 et le troisième fils, Ewan Stuart, vint au monde en 1915. Malgré sa très petite taille, Lucy Maud déployait une énergie phénoménale, et la vie au presbytère se déroula dans une tranquillité et une sérénité relatives jusqu’au déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui enleva de nombreux jeunes hommes à leur collectivité, et causa d’énormes tensions et bouleversements sociaux dans tout le pays. Ses journaux intimes pendant les quatre années du conflit sont remplis de réactions angoissées aux mauvaises nouvelles du front et d’expressions de vive gratitude à la suite des progrès des Alliés.
La période de la guerre souleva une autre anxiété chez Lucy Maud : elle se rendit compte que son éditeur était malhonnête. Après que son contrat avec Page eut expiré en 1915 et qu’il eut refusé de publier l’un de ses recueils de poèmes, elle avait commencé à regarder ailleurs. Elle choisit comme éditeur le distingué Canadien John McClelland*, cofondateur de la société qui deviendrait McClelland and Stewart. À une époque où normalement les femmes ne défendaient pas leurs droits, en particulier devant les tribunaux, Montgomery poursuivit l’arrogant et tyrannique Page pour non-paiement de redevances et dommages pour la vente frauduleuse des droits de reproduction pour Anne’s house of dreams, roman publié par McClelland en 1917. Ainsi s’amorça plus d’une décennie de poursuites et de contre-poursuites. Quand il devint clair que Lucy Maud ne lâcherait pas prise, Page essaya d’autres tactiques et offrit une entente à l’amiable. En 1919, désireuse de couper tous les liens, elle lui vendit pour près de 18 000 $ tous les droits des sept livres qu’il avait déjà publiés, avec ceux de quelques récits inédits. Pour l’époque, c’était une somme considérable, mais cet arrangement se révélerait désastreux au bout du compte, car ses livres, surtout ceux qu’elle avait écrits au début de sa carrière, continueraient de bien se vendre. Malgré cet accord, les poursuites traînèrent en longueur, occasionnant une tension constante, et Page réussit à immobiliser ses redevances américaines, menaçant ainsi le revenu de l’écrivaine.
D’autres perturbations survinrent. Pendant la pandémie d’influenza de 1919, la mort de sa chère cousine Frederica Elmanstine McFarlane, la plus importante des « âmes sœurs » qui enrichissaient sa vie, porta un coup terrible à Lucy Maud. La politique religieuse entra dans une période d’instabilité qui, en 1925, aboutit à la création de l’Église unie du Canada [V. Clarence Dunlop Mackinnon*], qui rassembla les congrégationalistes, les méthodistes et de nombreux presbytériens. Les deux communautés de Ewan votèrent pour rester indépendantes. Cette décision plut au révérend, et Lucy Maud, qui avait prévu qu’il trouverait extrêmement difficiles les répercussions de la fusion, fut contente pour lui. Au fond, ce changement la laissait indifférente ; elle écrivit dans son journal : « l’esprit de Dieu n’opère plus par l’entremise de l’Église pour l’humanité […] Aujourd’hui, il opère par l’entremise de la science […] Les “dirigeants” [de l’Église] tentent d’insuffler un semblant de vie à quelque chose que la vie a quitté. » Par ailleurs, Ewan dut subir un procès à la suite d’un accident d’automobile, et le juge de Toronto William Renwick Riddell rendit un verdict de culpabilité à son endroit. Des commérages malveillants se firent entendre dans la population locale au sujet du style de vie de Lucy Maud (non seulement elle menait une brillante carrière, mais elle pouvait aussi se payer une bonne) et des liens d’amitié qu’elle entretenait avec le flamboyant révérend Edwin Smith, ancien camarade de classe de son mari et ministre de l’Église unie (ancien presbytérien) qui s’était distingué pendant la guerre. Sans surprise, les Macdonald finirent par vouloir déménager, même s’ils avaient été très aimés dans la communauté de Leaskdale. Après 1919, Ewan avait connu des troubles mentaux (il souffrait de dépression clinique et présentait des symptômes de schizophrénie, comme des hallucinations auditives) et le couple espérait qu’un changement serait stimulant pour lui.
En 1926, Ewan fut appelé dans une collectivité, à l’ouest de Toronto, que la politique de l’union des Églises avait divisée. Les Macdonald s’installèrent dans un splendide presbytère en brique dans le charmant hameau de Norval (Halton Hills), situé dans la vallée pittoresque de la rivière Credit. C’était un endroit parfait pour élever de jeunes garçons et la famille fut très heureuse au début. Ewan assumait encore une fois une double responsabilité et Lucy Maud s’engagea activement dans les activités de l’église et la collecte de fonds, tout en continuant d’écrire et de se tenir au courant de l’actualité littéraire à Toronto. Grandement sollicitée comme conférencière, elle choisissait souvent, comme sujets, des livres ou son île chérie, et se plaisait à lire des extraits de ses publications ou à déclamer de la poésie. Au cours des années 1920, elle poursuivit ses démêlés judiciaires avec la L. C. Page Company. Les cinq procès furent finalement réglés en sa faveur en octobre 1928. Elle investit les indemnités (environ 4 000 $ après avoir rétribué ses avocats), mais perdit bientôt cet argent et une bonne partie de ses économies dans le krach boursier de 1929. Malheureusement, Page avait réussi à financer ses batailles judiciaires à même les revenus des titres qu’il avait achetés d’elle en 1919. De plus, avant de la pousser à renoncer à ses droits, il lui avait caché avoir vendu les droits d’adaptation d’Anne of Green Gables pour le film muet réalisé à Hollywood mettant en vedette Mary Miles Minter. Même si le sens de la justice de Lucy Maud lui donnait la ténacité nécessaire pour se battre en vue d’obtenir un traitement équitable, les coûts furent exorbitants et la bataille entama profondément ses revenus, sa vie familiale, ses réserves émotionnelles et le temps consacré à l’écriture.
Lucy Maud aimait la beauté de Norval et sa proximité de Toronto, dont elle chérissait toujours la culture littéraire en émergence. Sa célébrité avait pris son essor après la guerre et elle fut nommée membre de la Royal Society de Grande-Bretagne en 1923. Elle participa aux activités de la Canadian Authors Association, qui l’amenèrent à faire la connaissance d’écrivains et d’éditeurs tels que Helen Letitia McClung [Mooney*] et Bernard Keble Sandwell*. Ses revenus lui permirent d’envoyer ses fils au St Andrew’s College, excellente école secondaire d’Aurora, non loin de Norval. Les Macdonald espéraient s’établir de façon permanente dans ce hameau qui dégageait beaucoup du charme de Cavendish. Or, les choses finirent par se dégrader dans cette collectivité aussi. La dépression de Ewan devint débilitante, et il prenait de plus en plus de médicaments qui, on le sait maintenant, aggravèrent probablement son état. En 1934, il passerait près de deux mois au Homewood Sanitarium [V. Stephen Lett*] à Guelph. Leur fils aîné, Chester Cameron, même s’il était indéniablement brillant, obtint des résultats médiocres à l’université (c’était sa mère qui payait ses droits de scolarité) en raison de problèmes de comportement qui s’étaient manifestés dès son enfance ; à la consternation de ses parents, il se maria en secret en novembre 1933 et devint père six mois plus tard. Le benjamin, Ewan Stuart, étudiant exceptionnel et gymnaste récompensé, était attiré par une jeune fille du coin, de laquelle Lucy Maud n’avait pas une haute opinion. Dans ses romans, l’auteure avait décrit les conséquences fâcheuses de l’ingérence des gens plus âgés dans les idylles des plus jeunes, mais elle n’hésita pas à essayer d’influencer les relations de ses propres enfants. En 1935, son mari, souvent incapable d’assumer ses fonctions en raison de sa maladie, démissionna après un malentendu avec les conseillers presbytéraux au sujet de son salaire et prit sa retraite. Les Macdonald partirent s’installer à Swansea, à la limite ouest de Toronto, où leurs deux fils poursuivaient leurs études. Lucy Maud acheta la seule résidence qu’elle posséderait, une grande maison de brique située à l’époque au 210A, Riverside Drive, dans une nouvelle enclave de résidences prestigieuses juchées sur une falaise surplombant la rivière Humber. Elle la baptisa Journey’s End.
Lucy Maud souhaitait depuis longtemps se libérer des tâches paroissiales et participer plus activement au milieu littéraire de Toronto par le truchement de la Canadian Authors Association et du Canadian Women’s Press Club. Elle s’était évertuée à promouvoir de jeunes auteurs canadiens dans une période de nationalisme grisant après la guerre. Les profits générés par ses livres aidèrent la McClelland and Stewart à publier de nombreux écrivains en herbe, et la firme s’afficherait ultérieurement comme « la maison d’édition canadienne ». D’autres honneurs attendaient la romancière à succès. En mars 1935, elle apprit qu’elle avait été élue à l’Institut de France et, en mai de la même année, elle reçut une lettre du premier ministre, Richard Bedford Bennett, l’informant qu’elle avait été faite officier de l’ordre de l’Empire britannique. Ces premières années à Swansea furent relativement heureuses pour Lucy Maud et Ewan ; leurs fils étaient revenus vivre avec eux tout en prenant des cours à la University of Toronto (la femme de Chester Cameron habitait chez son père avec sa fille). Mais Chester Cameron, qui étudiait le droit, préoccupait de plus en plus ses parents ; il leur causa une vive déception et des soucis constants pendant la dernière décennie de leur vie. Ewan Stuart s’inscrivit en médecine et deviendrait un médecin réputé à Toronto. Le « seul bon fils » consterna pourtant ses parents quand il sécha des cours pour aller jouer aux cartes et échoua sa deuxième année. Mortifié par l’expérience, il s’assagit et finit par réussir ses études.
Les lecteurs du monde entier adoraient Montgomery et ses écrits. Elle se rendit toutefois compte que son style d’écriture avait de moins en moins la cote auprès des critiques d’après-guerre. En octobre 1928, elle constata avec regret que les réimpressions de ses livres publiés auparavant continuaient à bien se vendre, mais que leur popularité nuisait au succès de ses nouveaux, plus coûteux à produire. Pour aggraver les choses, elle avait prêté beaucoup d’argent à des membres de sa famille élargie (la grande partie ne fut jamais remboursée) et était obligée de continuer à publier pour des raisons financières. Sa réputation était de plus en plus mise à mal. L’ambitieux journaliste et critique William Arthur Deacon* dénigra ses romans, les citant comme des exemples de sentiments et de style victoriens qui n’avaient aucune place dans la littérature canadienne moderne ; en 1926, il avait affirmé catégoriquement que « le roman canadien ne devait pas descendre plus bas » que les livres de Lucy Maud Montgomery. Son opinion était partagée par d’autres, tels Oscar Pelham Edgar, l’un des fondateurs de la Canadian Authors Association, et Frederick Philip Grove, que Lucy Maud avait encouragé à ses débuts. Par une manœuvre qui l’anéantit, Deacon la fit évincer du comité de direction de la Canadian Authors Association en 1938. La diminution de son statut professionnel et de son revenu pendant la décennie de la grande crise économique, conjuguée à des tensions familiales aiguës causées par la maladie mentale de Ewan et les échecs personnels et professionnels de Chester Cameron, provoqua chez Lucy Maud une dépression clinique. À l’instar de son mari, elle fut traitée aux barbituriques et aux bromures dont les effets secondaires néfastes n’étaient pas compris à l’époque. Tout comme lui, elle devint graduellement dépendante de doses de médicaments de plus en plus fortes ; en outre, leur médecin de famille bien intentionné leur administrait des injections hypodermiques. Entraînée sur cette pente descendante qui ravagea sa santé physique, mentale et émotionnelle à partir de 1937, elle avait du mal à se concentrer sur son écriture, ce qui la privait de l’une des joies fondamentales de son existence et amenait une sérieuse diminution de ses revenus. Ses livres rapportèrent de son vivant des recettes totales dépassant 350 000 $, somme considérable pour l’époque, mais ses cadeaux monétaires et prêts généreux ainsi que des pertes financières pendant la grande dépression lui causèrent du souci dans ses dernières années. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale souleva la crainte que Ewan Stuart soit mobilisé, ce qui amplifia sa détresse. Elle s’éteignit le 24 avril 1942 après une longue période de maladie marquée par l’anxiété, la dépression et une importante perte de poids.
La cause précise du décès de Lucy Maud Montgomery est incertaine. Peu au courant de la façon dont sa mère tenait son journal intime, son fils Ewan Stuart, alors médecin, crut par erreur qu’une page d’écriture datée de deux jours avant sa mort était une note de suicide. Depuis quelque temps, Lucy Maud transcrivait à la machine à écrire chacun de ses dix journaux intimes manuscrits. La dernière page de la transcription dactylographiée du neuvième journal portait le numéro 175. La présumée note de suicide, numérotée du chiffre suivant, disait : « Cette copie n’est pas terminée et ne le sera jamais. Elle est dans un terrible état car je l’ai transcrite quand j’ai commencé à sombrer dans ma terrible dépression de 1940. C’est ici qu’elle doit prendre fin. Si des éditeurs souhaitent […] publier des extraits [du tapuscrit des premiers neufs journaux,] selon les conditions de mon testament ils doivent s’arrêter ici. Le dixième volume [, manuscrit dont seulement quelques pages ont été dactylographiées,] ne doit jamais être retranscrit et ne doit pas être rendu public de mon vivant. Certaines parties sont trop terribles et blesseraient des gens. J’ai perdu l’esprit par périodes et je n’ose imaginer ce que je peux faire dans ces moments. Que Dieu puisse me pardonner et j’espère que tous les autres me pardonneront même s’ils ne peuvent pas comprendre. Ma situation est trop affreuse à supporter et personne ne s’en rend compte. Quelle fin pour une vie tout au long de laquelle j’ai toujours essayé de faire de mon mieux malgré de nombreuses erreurs. » La cause de son décès fut consignée par le médecin de famille, Richard Arthur Gordon Lane, comme étant une « thrombose coronaire » attribuée à de « l’artériosclérose et un très haut degré de neurasthénie », mot utilisé pour décrire la maladie nerveuse. Aucune autopsie ne fut pratiquée. Ni son fils ni son médecin ne souhaitaient une enquête : à cette époque, un suicide aurait jeté l’opprobre tant sur la famille que sur le médecin. S’il y eut effectivement surdose de médicaments, comme ils le pensaient, on ne sait pas si elle était volontaire ou accidentelle, et la cause exacte de la mort de Lucy Maud ne sera jamais connue. Son mari mourut l’année suivante et repose à ses côtés à Cavendish.
La position de Lucy Maud Montgomery dans le canon littéraire au Canada changea énormément au cours du xxe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, l’auteure était adulée par des lecteurs du monde entier, et parmi ses admirateurs se trouvaient deux hommes, Stanley Baldwin et James Ramsay MacDonald, qui devinrent premiers ministres de la Grande-Bretagne, ainsi que son collègue écrivain Mark Twain. Son nom était bien connu partout où l’on parlait anglais et, en 1925, ses livres avaient déjà été traduits en suédois, néerlandais, polonais, danois, norvégien, finnois et français. (Selon l’érudit Benjamin Lefebvre, la première version française d’Anne of Green Gables fut publiée à Genève en 1925 sous le titre Anne, ou les illusions heureuses ; des traductions canadiennes-françaises de ses œuvres ne paraîtraient que dans les années 1980.) Ses lecteurs appartenaient à tous les groupes d’âge. Les critiques louangeaient ses livres en les qualifiant de romans régionaux délicieux, imprégnés d’une atmosphère vibrante, peuplés de personnages habilement décrits, ponctués d’incursions perspicaces dans la nature humaine et d’une critique sociale pleine d’esprit.
Mais après la guerre, le modernisme privilégia un style et des sujets différents. Le changement dans les normes et les goûts littéraires fit en sorte que ses écrits commencèrent à tomber en défaveur auprès des critiques qui tentaient d’établir une distinction entre ce qu’ils appelaient la « littérature intellectuelle » et la « littérature peu intellectuelle ». Comme le sérieux sous-jacent de ses récits leur échappait à cause de l’humour et des intrigues classiques qu’ils recelaient, les critiques et universitaires masculins – en particulier les Canadiens agacés par sa popularité – décriaient en général son écriture « sentimentale » et « naïve », convenant seulement aux femmes et aux enfants. Ces détracteurs et, de plus en plus, les lecteurs sophistiqués (et ceux qui souhaitaient être considérés comme tels) voulaient une approche dure, mordante, épurée, ainsi qu’un contenu réaliste qui semblait approprié à un monde en évolution rapide marqué par la guerre, la criminalité, l’anxiété sexuelle, l’urbanisation et les nombreuses autres tensions de la modernité. Montgomery elle-même préférait les œuvres d’auteurs tels que sir Walter Scott, James Matthew Barrie, les Brontë et les poètes romantiques anglais. Dans une lettre à Weber datée du 29 avril 1929, elle prit un ton amusé et acide pour parler d’un roman qui satisfaisait aux critères modernistes, Strange fugitive, de Morley Edward Callaghan*, publié à New York en 1928. Dans une note inscrite à son journal quelques mois auparavant, elle avait déclaré que cet écrivain, plus jeune, était sans « vision, imagination [… ni] profondeur » et qu’il était « d’un ennui mortel ». Sa propre écriture, même débordante d’énergie, ne cadrait plus avec le nouveau credo. Son centre d’intérêt était la vie des femmes et des enfants ; son style narratif puisait ses racines dans la tradition orale des contes écossais ; son ton montrait une bienveillance perplexe envers les préjugés de la nature humaine et les luttes de pouvoir. Ses récits, pleins d’esprit et d’éclats sensuels de prose ornée, présentaient les dénouements heureux des romans traditionnels. Elle n’aimait pas l’obligation d’y « inclure une “morale” », mais, depuis ses débuts, savait qu’il fallait combler les attentes du public ; même en 1924, elle sentait qu’elle « devait le satisfaire encore un moment ».
Montgomery déploya quelques efforts pour manifester sa sensibilité au changement. Dans The Blue Castle, publié en 1926, son unique roman se déroulant entièrement en Ontario (dans la communauté de Bala, où les Macdonald passèrent leurs vacances en 1922), l’un des personnages est une mère célibataire, et l’héroïne du roman demande en mariage un homme qui ne lui avait témoigné aucun intérêt romantique et que, par surcroît, sa famille et son milieu considéraient comme un « récidiviste ». Trois ans plus tard, dans Magic for Marigold, une femme médecin poursuit sa carrière après son mariage. Montgomery était exaspérée par ses éditeurs et lecteurs qui exigeaient des intrigues classiques et des dénouements bien soignés. Pendant qu’elle écrivait Emily climbs, elle se plaignit dans son journal, le 20 janvier 1924, de ne pas pouvoir décrire Emily Byrd Starr (une autre orpheline) comme étant sujette aux pulsions sexuelles normales d’une adolescente. Ironiquement, et étonnamment, les « simples petites histoires », comme elle les avait une fois qualifiées modestement, avaient à l’occasion été considérées comme des livres subversifs ou dangereux ; par exemple, The Blue Castle s’était bien vendu, mais il avait été banni de certaines bibliothèques.
Le dédain des milieux littéraires canadiens se maintint jusque dans le dernier quart du xxe siècle, malgré la popularité constante de Montgomery dans son propre pays et dans le monde entier. Lorsque des approches critiques telles que le féminisme et les études culturelles démolirent les normes antérieures qui avaient exclu les romans féminins et la littérature populaire, son œuvre fit l’objet d’un nouvel examen minutieux, et l’écrivaine occupe désormais une place sûre dans l’histoire littéraire du Canada. De nombreuses auteures de la deuxième moitié du xxe siècle, notamment Alice Ann Munro et Jean Margaret Laurence [Wemyss*], ont décrit son influence sur leur choix de carrière et leurs thèmes. Des femmes dans d’autres professions parlent aussi de son incidence sur leur estime de soi et leur valeur personnelle dans une société patriarcale. Les admirateurs de Montgomery continuent de relire ses livres, réagissent à l’énergie qui s’en émane, y trouvent des idées nouvelles et une pertinence à divers moments de leur vie.
L’attrait durable pour les écrits de Montgomery semble venir de différentes sources selon les pays. En Suède, où ses livres se vendent bien depuis 1909, son humour, son insistance sur la valeur de la femme et sa compréhension de la psychologie humaine sont particulièrement prisés. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’aile éditoriale de l’armée polonaise fit peut-être paraître Anne of the Island à l’intention des soldats, car le livre fournissait une image puissante d’une vie domestique heureuse pour laquelle il valait la peine de se battre. Après la guerre, le gouvernement soviétique tenta de bannir ses livres en Pologne, apparemment parce qu’il croyait qu’ils encourageaient la loyauté aux amis et à la famille plutôt qu’à l’État. Malgré cette censure, The Blue Castle inspira la production, en 1982, d’une comédie musicale, pleine de sous-entendus politiques, qui met en scène le triomphe des plus faibles sur les instances du pouvoir. L’intérêt porté à l’œuvre de Montgomery ne se confine pas à l’Amérique du Nord et l’Europe. En 2012, la Publishers Association of China inclut Anne of Green Gables aux 50 romans les plus influents disponibles dans ce pays. Au Japon, la missionnaire Loretta Leonard Shaw* remit un exemplaire de ce roman en cadeau d’adieu à une amie japonaise en 1939, élément déclencheur de l’immense popularité des livres de la Canadienne dans ce pays. Certains lecteurs japonais croient que Montgomery renforce l’idée que les femmes doivent valoriser le dévouement envers la famille plus que leur propre développement, mais d’autres soutiennent qu’elle encourage les femmes à faire entendre leur propre voix.
Les Japonais réagirent également avec un enthousiasme stupéfiant aux descriptions de la nature dans la province natale de l’auteure et, depuis des décennies, ils font partie des touristes les plus nombreux parmi les milliers qui visitent chaque année le parc national du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard, inauguré en 1937 avec la « maison aux pignons verts » comme attraction principale. Quelle que soit l’origine de la fascination qu’elle inspire, Montgomery fut l’ambassadrice culturelle la plus influente de son pays pendant le xxe siècle ; les universitaires canadiens voyageant et enseignant à l’étranger entre les années 1960 et 1980 étaient souvent surpris de découvrir que Montgomery, en anglais ou en traduction, était le seul écrivain canadien connu dans de nombreux pays.
Au moment même où les critères d’analyse littéraire étaient reformulés, on publia des extraits des dix journaux intimes manuscrits que Montgomery rédigea de 1889 jusqu’à l’année de sa mort. Ils témoignent d’une femme éminemment brillante, cultivée, dotée d’un sens raffiné de l’histoire et parfaitement consciente du fait que l’univers rural isolé et intensément religieux dans lequel elle fut élevée était en train de disparaître en raison du développement industriel et de la Grande Guerre. En 1919, elle commença à recopier et à mettre en forme ses journaux, déterminée à documenter ce changement social massif ainsi que la place qu’elle y occupait. Elle consigna également de nombreuses réalités qu’elle ne pouvait pas exprimer publiquement, car, en tant que femme de pasteur, elle devait faire preuve de discrétion et de tact. Ses journaux servaient de « refuge » à son « esprit malade », consumant la « fumée » produite par le tumulte de ses émotions. Certains lecteurs furent très surpris de constater que Montgomery souffrait de sautes d’humeur extrêmes, exacerbées par son mariage tardif à un homme déprimé et hypocondriaque. La plume acérée et le fond moralisateur de l’auteure aux romans si humoristiques et tolérants à l’égard des excentricités de la nature humaine furent tout aussi inattendus. Les lecteurs éprouvent de la sympathie pour cette femme qui essayait de compenser les lacunes de son mari en travaillant avec une ardeur redoublée à organiser pour l’église des activités sociales et des collectes de fonds, et à trouver des remplaçants quand il était incapable d’assumer ses fonctions. Ils l’admirent d’avoir encouragé d’autres écrivains. Ils sont stupéfiés par l’énergie et l’efficacité qu’elle déployait dans ses rôles d’épouse, de mère, d’assistante du pasteur, de soutien de sa famille élargie, d’amie, d’écrivaine professionnelle et de conférencière populaire.
Il faut toutefois comprendre que l’auteure des journaux intimes présente d’elle-même l’image qu’elle souhaitait laisser dans les mémoires. À tort ou à raison, elle en vint à se dépeindre comme la victime d’un destin cruel, conférant une aura tragique à la protagoniste de ces documents qu’elle ne voulait pas voir publier avant sa mort. Même s’ils fournissent un itinéraire chronologique de sa vie, ainsi que de nombreux indices d’ordre psychologique, ils comportent de sérieuses omissions, en particulier sur ses doutes personnels et sa vie familiale de plus en plus difficile. Elle se préoccupe, par exemple, de sa part de responsabilité dans sa propre malchance, mais sans entrer dans les détails et sans faire d’examen approfondi, se demandant si des aspects de son tempérament ou certains de ses actes auraient causé des problèmes aux gens qu’elle aimait et à elle-même. L’historien canadien John Michael Bumsted déclara qu’elle était elle-même, dans ses journaux, le plus grand personnage littéraire qu’elle ait créé.
Pour Montgomery, écrire était une profession : en décembre 1903, elle confia à MacMillan qu’« [elle était] franchement en littérature pour gagner [sa] vie ». Dès qu’elle se rendit compte que des éditeurs étaient prêts à payer pour obtenir ses poèmes et ses romans, elle fut déterminée à faire son chemin comme auteure. Ses journaux intimes et ses lettres témoignent de son habileté grandissante et de sa fierté envers l’amélioration de son talent artistique et de son revenu. Écrire lui procurait aussi de la joie. Dans The alpine path, elle cite une note de son journal intime datée du 23 août 1901 : « Mais oh, j’adore mon travail ! J’adore concocter des histoires, et j’adore […] transformer quelque fantaisie “farfelue” en vers. » L’écriture lui permettait d’exprimer par les mots ce qu’elle entrevoyait comme « un royaume de beauté idéale », dissimulé sous « un simple voile ténu ». Sa créativité, essentielle à la nature passionnée de son imagination débridée, la soutint au milieu des nombreuses vicissitudes de son existence. Elle se délectait de la gloire et du respect que son travail lui apportait et, pendant ses dernières années souvent remplies d’angoisse, elle crut, à juste titre, que ses livres lui survivraient. Elle est une source d’inspiration pour le tourisme, à l’Île-du-Prince-Édouard depuis plus d’un siècle, et, plus récemment, à Leaksdale, Norval et Bala. Ses romans et journaux intimes furent repris sous forme de dramatiques à la radio, de pièces de théâtre, de comédies musicales, de séries télévisées et de films, et continuent d’engendrer une industrie de marchandises dérivées. Son nom, certains de ses personnages et plusieurs titres de ses ouvrages furent déposés comme marques de commerce par ses héritiers.
Au xxie siècle, les historiens et les critiques culturels s’entendent pour dire que les écrits de Lucy Maud Montgomery ne peuvent être étiquetés « seulement » comme littérature pour enfants ou littérature populaire, et que ses romans et ses journaux intimes sont d’importants témoignages qui décrivent la continuité et le changement dans la vie et la société canadiennes, la condition féminine, l’autorité de la religion, le développement des professions, les répercussions de la Première Guerre mondiale et de la grande dépression, l’évolution de l’édition internationale et le gigantesque passage de la vie agricole à l’industrialisation. Montgomery est aujourd’hui reconnue comme une écrivaine immensément douée et aux talents exceptionnels qui a influencé de nombreuses personnes au Canada et dans le monde entier par la force de sa plume.
Lucy Maud Montgomery a publié plus de 20 livres, plus de 500 poèmes et 500 nouvelles dans divers périodiques, ainsi que d’autres textes dans des livres et des revues. Ses histoires ont fait l’objet de plusieurs recueils depuis sa mort. Ses romans mettant en scène le personnage d’Anne sont : Anne of Green Gables (Boston, 1908), Anne of Avonlea (Boston, 1909), Anne of the Island (Boston, 1915), Anne’s house of dreams (Toronto, 1917), Rainbow Valley (Toronto, 1919), Rilla of Ingleside (Toronto, 1921), Anne of Windy Poplars (Toronto, 1936), et Anne of Ingleside (Toronto, 1939). Tout juste avant sa mort, Montgomery a concocté un dernier roman autour de sa plus célèbre protagoniste à partir de nouvelles qu’elle avait déjà écrites ; il a d’abord été publié en partie sous le titre The road to yesterday (Toronto, 1974), puis au complet sous le titre original qu’elle lui avait donné, The Blythes are quoted, Benjamin Lefbvre, édit. (Toronto, 2009). Elle a également écrit une trilogie dont le personnage principal est une jeune auteure : Emily of New Moon (Toronto, 1923), Emily climbs (Toronto, 1925) et Emily’s quest (Toronto, 1927). Parmi ses autres ouvrages et recueils d’histoires figurent : Kilmeny of the orchard (Boston, 1910), The Story Girl (Boston, 1911), Chronicles of Avonlea […] (Boston, 1912), The golden road (Boston, 1913), Further chronicles of Avonlea […] (Boston, 1920), The Blue Castle : a novel (Toronto, 1926), Magic for Marigold (Toronto, 1929), A tangled web (Toronto, 1931), Pat of Silver Bush (Toronto, [1933]), Mistress Pat : a novel of Silver Bush (Toronto, 1935), et Jane of Lantern Hill (Toronto, 1937). En 1934, en collaboration avec Marian Keith [M. E. MacGregor (Miller)] et M. B. McKinley, elle a écrit Courageous women (Toronto). Son livre de poésie, The watchman and other poems (Toronto), a paru en 1916, et sa courte autobiographie, « The alpine path : the story of my career », a été publiée en six parties dans la revue Everywoman’s World (Toronto), 7 (janvier–juillet 1917), no 6 : 38–39, 41 ; no 7 : 16, 32–33, 35 ; 8 (août 1917–juin 1918), no 2 : 16, 32–33 ; no 3 : 8, 49 ; no 4 : 8, 58 ; no 5 : 25, 38, 40, puis en un seul livre, après sa mort, sous le même titre (Markham, Ontario, 1974). Ses dix volumes de journaux intimes, manuscrits qui comptent environ 5 000 pages de grand format, ont été édités et publiés en cinq volumes.
Depuis les années 1980, au Canada, ont paru plusieurs traductions françaises des ouvrages de Montgomery, présentées ici selon l’ordre chronologique des publications originales en anglais : Anne : la maison aux pignons verts [traduction d’Anne of Green Gables], H.-D. Paratte, trad. (Montréal, 1986), Anne d’Avonlea [traduction d’Anne of Avonlea], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1988), Kilmeny du vieux verger [traduction de Kilmeny of the orchard], Michèle Marineau, trad. (Montréal, 1992), la Conteuse [traduction de The Story Girl], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1993), Chroniques d’Avonlea [traduction de Chronicles of Avonlea […]], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1991), la Route enchantée, la conteuse est de retour […] [traduction de The golden road], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1994), Anne quitte son île [traduction d’Anne of the Island], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1988), Anne dans sa maison de rêve [traduction d’Anne’s house of dreams], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1990), la Vallée Arc-en-Ciel [traduction de Rainbow Valley], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1991), Chroniques d’Avonlea ii [traduction de Further chronicles of Avonlea], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1991), Anne… Rilla d’Ingleside [traduction de Rilla of Ingleside], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1992), Émilie de la Nouvelle Lune [traduction d’Emily of New Moon], Paul Daveluy, trad. (Montréal, 1983), Émilie de la Nouvelle Lune 2 [traduction d’Emily climbs], Paul Daveluy, trad. (Montréal, 1988), le Château de mes rêves (traduction de The Blue Castle : a novel], Hélène Le Beau, trad. (Montréal, 1991), Émilie de la Nouvelle Lune 3 [traduction d’Emily’s quest], Paul Daveluy, trad. (Montréal, 1989), le Monde merveilleux de Marigold [traduction de Magic for Marigold], Michèle Marineau, trad. (Montréal, 1991), l’Héritage de tante Becky [traduction de A tangled web], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1994), Pat de Silver Bush [traduction de Pat of Silver Bush], Hélène Le Beau, trad. ([Montréal], 1991), Mademoiselle Pat [traduction de Mistress Pat : a novel of Silver Bush], Hélène Le Beau, trad. ([Montréal], 1992), Anne au domaine des Peupliers [traduction d’Anne of Windy Poplars], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1989), les Vacances de Jane [traduction de Jane of Lantern Hill], Hélène Le Beau, trad. (Montréal, 1990), et Anne d’Ingleside [traduction d’Anne of Ingleside], Hélène Rioux, trad. (Montréal, 1990).
La Lucy Maud Montgomery Coll. (R2434-0-0), conservée à Bibliothèque et Arch. Canada, contient des contrats d’édition et une lettre, ainsi que d’autres sources dispersées dans de nombreux fonds. La L. M. Montgomery Coll., à la Univ. of Guelph Library (Ontario), Arch. and Special Coll., renferme d’importantes archives ; les manuscrits de quelques-uns des romans de Montgomery se trouvent dans la L. M. Montgomery Coll. à la Confederation Centre Art Gallery (Charlottetown). La liste d’ouvrages très sélective qui suit a été établie à partir de la bibliographie de notre biographie exhaustive et de la bibliographie accessible en ligne sur le site de la Univ. of Guelph, « L. M. Montgomery Research Centre » : www.lmmrc.ca.
Gabriella Åhmansson, A life and its mirrors : a feminist reading of L. M. Montgomery’s fiction (1 vol. paru, Uppsala [Suède], 1991– ), 1 (An introduction to Lucy Maud Montgomery : Anne Shirley), est une très bonne étude sur l’œuvre de fiction de Montgomery, parmi les premières sur le sujet. Dans Anne around the world : L. M. Montgomery and her classic, Jane Ledwell et Jean Mitchell, édit. (Montréal et Kingston, Ontario, 2013), des érudits internationaux examinent des aspects de sa vie privée et l’influence qu’elle a exercée sur ses lecteurs ; on peut y lire notamment notre article intitulé « Uncertainties surrounding the death of L. M. Montgomery », aux pages 45–62. Anne’s world : a new century of Anne of Green Gables, Irene Gammel et Benjamin Lefebvre, édit. (Toronto et Buffalo, N.Y., 2010), s’intéresse à des questions de culture et d’identité, ainsi qu’à la portée mondiale persistante de ce roman. F. W. P. Bolger, The years before Anne ([Charlottetown], 1974), est une ressource précieuse qui contient les Penzie MacNeill letters et quelques-unes de ses premières publications. J. M. Bumsted, « Maud Montgomery’s finest character creation », Atlantic Provinces Book Rev. (Halifax), 15 (1988), no 1 : 10, présente une analyse perspicace du deuxième volume de ses journaux intimes. Bumsted a également commenté le premier volume dans le même périodique (« Who’s afraid of Lucy Maud Montgomery ? », 13 (1986), no 1 : 1) ; son évaluation du troisième volume a paru dans Island Magazine (Charlottetown), no 34 (automne–hiver 1993) : 37–40. E. R. Epperly, The fragrance of sweet-grass : L. M. Montgomery’s heroines and the pursuit of romance (Toronto et Buffalo, 1992), propose une autre bonne étude de sa fiction. Mollie Gillen, The wheel of things : a biography of L. M. Montgomery, author of Anne of Green Gables (Don Mills [Toronto], 1975), excellent ouvrage basé sur les lettres de G. B. MacMillan, découvertes par Gillen, est une des premières biographies de Montgomery. Parmi plusieurs recueils d’essais utiles, L. M. Montgomery and Canadian culture, Irene Gammel et E. [R.] Epperly, édit. (Toronto et Buffalo, 1999), est l’un des plus complets et contient une bibliographie pertinente. L’excellent périodique en ligne de la L. M. Montgomery Literary Soc., « The Shining Scroll » : lmmontgomeryliterarysociety.weebly.com/the-shining-scroll-periodical.html, a été créé en 1993 et donne de l’information sur les nouvelles recherches, les publications et les événements liés à Montgomery. The L. M. Montgomery reader, Benjamin Lefebvre, édit. (3 vol., Toronto et Buffalo, 2013–2015), qui contient de nombreux documents internationaux inédits, fournit aux chercheurs du matériel inestimable pour une réévaluation des écrits, de la popularité, de la réputation et de l’importance culturelle de l’auteure. L. M. Montgomery’s rainbow valleys : the Ontario years, 1911–1942, Rita Bode et L. D. Clement, édit. (Montréal et Kingston, 2015), traite de l’héritage de Montgomery en Ontario, où elle a écrit la majorité de ses livres et huit de ses dix journaux personnels au cours de la seconde moitié de sa vie. Storm and dissonance : L. M. Montgomery and conflict, Jean Mitchell, édit. (Newcastle, Angleterre, 2008), se penche sur le côté plus sombre de ses œuvres de fiction et de ses écrits personnels.
After Green Gables : L. M. Montgomery’s letters to Ephraim Weber, 1916–1941, H. F. Tiessen et P. G. Tiessen, édit. (Toronto et Buffalo, 2006), est un recueil de premier plan ; les lettres de Weber, tout comme les lettres de MacMillan, sont des ressources majeures. The Green Gables letters : from L. M. Montgomery to Ephraim Weber, 1905–1909, Wilfrid Eggleston, édit. (Toronto, 1960), regroupe des lettres des premières années de leur correspondance. My dear Mr. M. : letters to G. B. MacMillan from L. M. Montgomery, F. W. P. Bolger et E. R. Epperly, édit. (Toronto, 1980), ressource primordiale, reproduit des lettres de Montgomery adressées à son correspondant en Écosse. The selected journals of L. M. Montgomery, M. [H.] Rubio et E. [H.] Waterston, édit. (5 vol., Toronto, 1985–2004), contient des extraits des dix journaux intimes manuscrits conservés à la Univ. of Guelph Library dans la L. M. Montgomery Coll. Ces journaux, qui constituent une ressource essentielle, ont suscité un regain d’intérêt pour les écrits de Montgomery et une réévaluation de son œuvre. The complete journals of L. M. Montgomery : the PEI years, M. H. Rubio et E. H. Waterston, édit. (2 vol., Toronto, 2012–2013), est aussi un ouvrage fondamental qui couvre les années que Montgomery a passées à l’Île-du-Prince-Édouard, de 1889 à 1911, et contient tous les textes et photographies omis dans le titre précédent. Le premier volume de L. M. Montgomery’s complete journals : the Ontario years, Jen Rubio, édit. (1 vol. paru, Oakville, Ontario, 2016– ), 1 (1911–1917) ajoute encore plus de détails sur la vie de Montgomery et fournit beaucoup d’information sur les années de guerre. Notre biographie définitive, Lucy Maud Montgomery : the gift of wings ([Toronto], 2008), qui a nécessité 35 années de recherches approfondies, s’appuie sur de nombreuses entrevues avec des gens, dont son fils cadet, qui connaissaient Montgomery et qui se souvenaient d’elle. E. [H.] Waterston, Magic island : the fictions of L. M. Montgomery (Toronto, 2008), étudie ses écrits en faisant le lien entre ses livres et sa vie, et est complémentaire à notre biographie définitive. On consultera également l’analyse d’E. [H.] Waterston, Kindling spirit : L. M. Montgomery’s Anne of Green Gables (Toronto, 1993), ainsi que notre courte biographie écrite en collaboration avec E. [H.] Waterston, Writing a life : L. M. Montgomery (Toronto, 1995 ; accessible en ligne à www.lmmrc.ca/biography.html). Readying Rilla : L. M. Montgomery’s reworking of Rilla of Ingleside, E. [H.] Waterston et Kate Waterston, édit. (Oakville, 2016), reproduit le manuscrit original de l’auteure, avec ses propres révisions notées à la main, révélant ainsi l’artiste en pleine activité créatrice. Pour terminer, E. [H.] Waterston, Rapt in plaid : Canadian literature and Scottish tradition (Toronto et Buffalo, 2001), présente Montgomery dans un contexte de tradition littéraire et culturelle écossaise.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Mary Henley Rubio, « MONTGOMERY, LUCY MAUD (Macdonald) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/montgomery_lucy_maud_17F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/montgomery_lucy_maud_17F.html |
| Auteur de l'article: | Mary Henley Rubio |
| Titre de l'article: | MONTGOMERY, LUCY MAUD (Macdonald) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2018 |
| Année de la révision: | 2018 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |