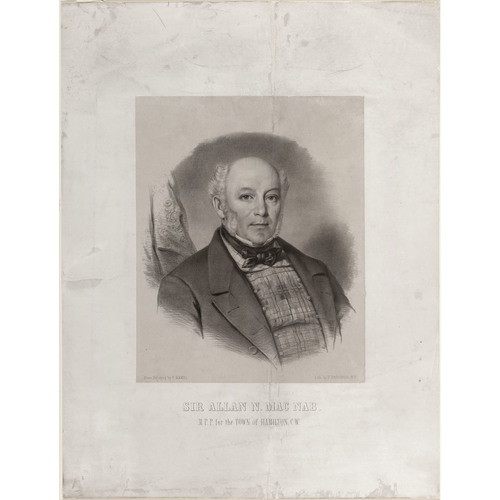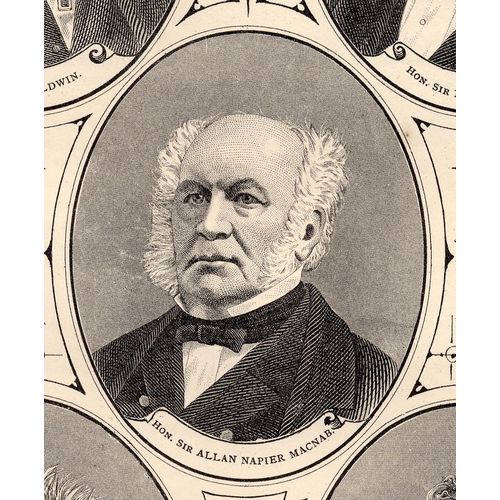MacNAB, sir ALLAN NAPIER, homme politique, homme d’affaires, spéculateur foncier, avocat et militaire, né le 19 février 1798 à Newark (Niagara-on-the-Lake), Haut-Canada, le troisième des sept enfants d’Ahan MacNab et d’Anne Napier, décédé le 8 août 1862 à Hamilton, Haut-Canada.
Le père d’Allan Napier MacNab avait été lieutenant dans le 2e corps d’armée des Queen’s Rangers de John Graves Simcoe*, qui participa à la guerre d’Indépendance américaine. Mis en demi-solde, il s’installa à York (Toronto) où on lui refusa un autre grade et un poste dans l’administration civile. En faillite à un certain moment, Ahan MacNab luttait en marge de la société tory du Haut-Canada. C’est dans ce climat instable que naquit Allan Napier MacNab. Malgré les problèmes financiers de la famille, il fréquenta quelque temps la Home District Grammar School du révérend George Okill Stuart à York. Les relations nouées par son père avec l’establishment civil et militaire d’York le serviront dans sa future carrière. Plus important encore, il fit siennes les hautes ambitions financières et sociales de son père, son penchant pour l’armée ainsi que sa persévérance dans les situations défavorables.
Pendant la guerre de 1812, MacNab, qui avait 14 ans lorsqu’elle éclata, donna libre cours à ses instincts guerriers. Il combattit à Sackets Harbor, à Plattsburgh et à Black Rock, état de New York, ainsi qu’au fort Niagara. En mars 1814, il fut promu enseigne du 49e régiment. Sa carrière militaire ayant été abrégée par le licenciement de certains régiments à la fin de la guerre, MacNab rechercha fiévreusement un autre emploi. En 1816, il entra à l’étude du juge D’Arcy Boulton*, père. Que MacNab ait mis près de deux fois le temps normal pour être admis au barreau fut le résultat de son instruction incomplète et de son goût pour l’action. Ainsi, dans sa jeunesse, il se mêla de théâtre, de menuiserie et de spéculation foncière. Puis, en 1820, il renoua ses relations avec l’armée en devenant capitaine de la milice d’York. Même son mariage en 1821 avec Elizabeth Brooke, fille d’un militaire britannique, ne réussit pas à l’assagir. Ce n’est qu’à la mort soudaine de sa femme, alors qu’elle donnait naissance à leur second enfant, en janvier 1825, qu’il commença à s’astreindre à une discipline de vie. Il entra au barreau en 1826.
Il décida de quitter York, où les possibilités d’avancement semblaient bloquées par les familles Allan, Robinson, Boulton et Strachan. MacNab manifestait toujours de la réticence « à accepter un rôle secondaire » et préféra installer son bureau, en qualité de premier avocat résidant, dans la modeste mais prometteuse localité de Hamilton, où, espérait-il, l’avancement serait plus facile. Comptant sur les relations de son père avec la famille Jarvis, il se lia rapidement d’amitié avec William Munson Jarvis, shérif du district de Gore, dont la famille lui fournit une aide précieuse dans le domaine des affaires et de la politique. Des relations avec des gens de robe le rapprochèrent de l’influente famille Chisholm d’Oakville et des Hatt d’Ancaster. De plus, John Beverley Robinson, lui aussi vétéran de 1812, lui obtint la charge de notaire. En août 1827, il défendit avec succès plusieurs tories éminents de Hamilton accusés d’avoir couvert de goudron et de plumes George Rolph, un réformiste qui avait été accusé d’adultère et dont l’avocat était William Warren Baldwin*. Avocat de plus en plus recherché, MacNab avait déjà, au bout d’un an, au moins un étudiant en apprentissage sous sa direction. Il était maintenant en mesure d’acheter et d’exploiter des terres dans la région de Hamilton. En partie grâce aux Chisholm, MacNab fut nommé, en mai 1830, lieutenant-colonel du 4e régiment de la milice de Gore. À ce moment-là, il avait à sa charge quatre sœurs célibataires, sa mère veuve depuis peu, et ses deux enfants. En septembre 1831, il épousa Mary Stuart, fille de John Stuart, ancien shérif du district de Johnstown, et nièce de George Okill Stuart et de Henry John Boulton. Ce mariage l’unit encore à des personnes influentes et fut, en l’occurrence, une alliance très bien venue.
MacNab comprit parfaitement les mécanismes d’avancement, mais c’est le hasard qui le mit en vue auprès du public. En 1829, il avait refusé de témoigner devant un comité de l’Assemblée, présidé par le réformiste William Warren Baldwin, lequel enquêtait sur la pendaison en effigie du lieutenant-gouverneur sir John Colborne à Hamilton par une foule de tories. Entraînée par William Lyon Mackenzie, l’Assemblée condamna MacNab à dix jours de prison pour violation des privilèges de la chambre. Il est douteux que MacNab eût envisagé une telle issue. Mais il devint un martyr tory, image qu’il exploita efficacement pendant les élections de 1830 alors que John Willson* et lui battirent les réformistes dans le comté de Wentworth.
Au cours de son premier mandat à l’Assemblée, MacNab rencontra de nombreuses difficultés. Il avait la conviction qu’il ne serait pas sage de s’identifier à un seul groupe dans une atmosphère politique qui se caractérisait par le manque de stabilité des alliances. Dans un premier geste pour augmenter son influence politique dans la province, MacNab chercha à renforcer ses liens dans la région de Wentworth. La puissance des hommes politiques était fonction de celle qu’ils possédaient dans leur région respective et, de ce côté, MacNab avait du travail à faire. Avec William Hamilton Merritt de St Catharines, les Chisholm d’Oakville, ainsi qu’avec les Béthune et les Cartwright de la région de Cobourg-Kingston, il s’occupa à décentraliser et redistribuer le pouvoir politique et commercial de la coterie d’York. MacNab devait agir prudemment. Non seulement devait-il affronter une forte opposition politique dans Wentworth, conduite par James Durand de Dundas, mais il était aussi endetté à la fois envers l’institution financière d’York, la Bank of Upper Canada, et envers plusieurs relations d’York qui avaient contribué à son avancement.
William Lyon Mackenzie, allié des Durand, fut la première cible de MacNab. Circonvenu par Mackenzie à la fois à l’Assemblée et dans une réunion politique à Hamilton, MacNab riposta en appuyant une motion, en décembre 1831, ayant pour but d’expulser son rival de l’Assemblée pour diffamation. Ce fut la première de cinq expulsions ; MacNab prit une part active à toutes. La signification de ces expulsions dépassa bientôt la vengeance personnelle et même les différends du parti. En dirigeant l’attaque contre l’irascible rédacteur en chef, MacNab fut capable d’établir son ascendant sur l’Assemblée et de maintenir un lien avec les tories d’York. Il avait grandement besoin de cet appui parce qu’il se tramait, sous le couvert de celui-ci, des manœuvres et des oppositions à l’intérieur du parti pour l’obtention du pouvoir économique et commercial au Haut-Canada. La lutte à l’intérieur du parti fut plus évidente en ce qui avait trait aux banques et à la spéculation foncière.
Au début, MacNab évita d’entrer en conflit direct avec York. Tout en appuyant la Commercial Bank de John Solomon Cartwright* à Kingston, dans l’espoir de diriger son « agence » future à Hamilton, le rusé débiteur continuait à fournir à la Bank of Upper Canada son aide à l’Assemblée. En retour, il profita d’un crédit généreux de la part de cette dernière et, en mars 1833, fut nommé son conseiller juridique pour le district de Gore. Utilisant ce crédit et ses propres réserves d’argent assez limitées, il augmenta sa spéculation foncière. En mai 1832, il possédait environ 2 000 acres de terre indéfrichées dans les districts de London, Gore et Newcastle. Plus important encore, en 1835, il avait accaparé la plupart des meilleurs terrains dans le centre de Hamilton en pleine expansion. Bien que ses avoirs aient dramatiquement fluctué et que leur valeur totale ne fut jamais connue, il devint vraisemblablement, comme le rapportait sir Charles Bagot* en 1842, « un grand propriétaire, peut-être le plus grand du pays ».
Bien qu’il y ait lieu de croire que MacNab n’était pas scrupuleux dans l’amortissement des hypothèques avant la revente, les acomptes qu’il versait sur l’achat de terrains épuisaient sérieusement ses fonds en caisse, particulièrement au début des années 1830. Sa propriété de Burlington Heights, sur laquelle s’élèverait bientôt le symbole des aspirations sociales de MacNab, le splendide Dundurn Castle de 72 pièces, avait été achetée, en novembre 1832, de John Solomon Cartwright, pour la somme de £2 500, soit £500 de plus que MacNab comptait payer. Le jour même où il signa l’acte d’achat, un incendie détruisit ses chantiers de construction à Hamilton, causant des dommages s’élevant entre £5 000 et £10 000. De plus, il fut démis comme président de la Desjardins Canal Company, en 1834, après avoir déposé en nantissement les titres d’une partie importante de ses biens fonciers pour garantir un prêt du gouvernement à la compagnie en 1832. Ses relations avec la hiérarchie tory s’étaient également détériorées. En retard de quelque trois ans pour ses paiements à un créancier important, Samuel Peters Jarvis*, MacNab prétendit que Jarvis était en dette envers lui pour des services anciens. Aux yeux de Jarvis, le bouillant avocat de Hamilton était tout simplement un « scélérat ».
Le resserrement du crédit plaça MacNab dans une situation difficile face à ses créanciers à York. Toutefois, le décès du registraire des terres de Wentworth retarda l’affrontement. Quiconque exerçait une influence dominante sur le Bureau d’enregistrement pouvait, en toute quiétude, acquérir des terrains inexploités, choisis, dans la région de Wentworth sans passer par la vente publique. À la suite d’une dure lutte avec James Durand, en avril 1833, MacNab obtint ce poste pour son frère David Archibald. Il avait acquis une grande influence sur le développement foncier de Wentworth et, comme résultat, il détenait une solide emprise sur l’avenir politique et commercial du comté.
Ce fut une victoire éphémère. Peter Robinson*, commissaire des Terres de la couronne, désirant mettre un frein à la spéculation foncière effrénée et, de ce fait, conserver à York la mainmise sur le développement du Haut-Canada, émit un arrêté en conseil, le 8 novembre 1833, dans le but de resserrer et centraliser le contrôle sur la spéculation foncière. Cette démarche sapa l’action de MacNab et le poussa dans un conflit ouvert avec la capitale. Interprétant l’arrêté en conseil comme une tentative par les tories d’York de contourner les « vendeurs de terrains » locaux et de monopoliser les profits, MacNab était furieux. En moins d’un mois, il présenta un projet de loi ayant pour but d’obtenir la reconnaissance juridique d’une banque rivale, la Gore Bank de Hamilton, critiqua les pouvoirs excessifs de la Commercial Bank et de la Bank of Upper Canada et même se mit à tergiverser sur l’appui qu’il accorderait au projet de loi en vue de l’érection d’York en municipalité sous le nom de Toronto.
Les répercussions ne se firent pas attendre. Le Conseil législatif non seulement rejeta son projet de loi sur la banque, mais aussi commença à entraver ses transactions immobilières en lui refusant un statut privilégié au Bureau d’enregistrement et en ignorant ses demandes et plaintes continuelles. Malgré la montée des coûts de construction de Dundurn, MacNab persévéra et réalisa des bénéfices sur ses transactions de terrains en 1834. Cependant, le contrôle définitif sur les terrains continua d’être entre les mains de Toronto.
Par contraste, il connut la réussite dans le domaine bancaire. Il y gagna l’appui d’hommes d’affaires en vue de Hamilton ainsi que l’aide des membres de l’Assemblée, qui désiraient l’établissement de banques locales pour la mise en valeur de leurs propres régions métropolitaines. La Gore Bank reçut sa charte à la fin de 1835. MacNab en possédait la majorité des actions. Il s’opposa alors à l’émission de chartes en faveur d’autres banques régionales.
Libéré des contraintes financières que Toronto imposait, MacNab continua à la fois d’étendre son empire commercial et de consolider son emprise politique locale. En 1837, il exploitait une ligne de navigation à vapeur entre Rochester, Oswego et Hamilton, était propriétaire d’un bassin portuaire important sur la baie de Burlington, promoteur principal et président du Hamilton and Port Dover Railway, administrateur actif du Great Western Railway, spéculateur foncier insatiable, constructeur, loueur et vendeur de maisons et de magasins, et propriétaire d’une taverne à Hamilton. Ses entreprises de chemin de fer augmentèrent la valeur de ses terrains et, en 1835 et 1837, il vendit de vastes lots en faisant de bons profits. Mais l’énergie que MacNab déploya dans les affaires contribua à diviser l’électorat de Wentworth, les ruraux se retrouvant en gros d’un côté et les gens de milieu urbain de l’autre. Sauf les foires commerciales qu’il patronna, MacNab accorda peu d’attention au vote rural et, lors des élections de 1834, il se retira aussitôt du comté pour représenter le nouveau comté de Hamilton, centre de ses activités commerciales.
Même si on le considérait comme un des plus importants tories, c’est le pragmatisme plutôt que l’idéologie qui réglait les manœuvres commerciales de MacNab. Les tories de Toronto étaient ses concurrents commerciaux les plus importants. N’étant pas intéressé aux canaux traditionnels de commerce avec la Grande-Bretagne, il pouvait facilement souscrire aux projets de chemins de fer du Great Western, de Hamilton et Port Dover (le dernier en rapport avec sa ligne de navigation à vapeur) comme de simples liens entre l’est et l’ouest des États-Unis. Il ne lui répugna pas non plus d’approcher des capitalistes de New York, pour le financement. En fait, l’année de la rébellion dans le Haut-Canada, il fit un plaidoyer passionné en faveur d’une plus grande immigration des Américains, soutenant, à la différence de la plupart des tories, qu’ « ils étaient des gens entreprenants et que, si on les admettait, ils seraient d’un grand apport pour le pays ». Il reconnut qu’il profiterait de la vente de terrains aux immigrants. Il critiqua aussi l’ingérence britannique dans les affaires bancaires du Haut-Canada et prétendit que les avocats britanniques devraient être soumis à un stage avant de pratiquer le droit dans le Haut-Canada, comme l’étaient les avocats canadiens en Angleterre. En soignant ses intérêts personnels et ceux de sa région, MacNab était prêt à aller à l’encontre non seulement des tories de Toronto mais aussi du ministère des Colonies.
Les gestes que posa MacNab révèlent toutefois qu’il ne pouvait être défini complètement par le mot tory. Partisan des « réserves » du clergé, il croyait néanmoins que toutes les dénominations, y compris les catholiques, devaient recevoir une part égale des bénéfices qu’elles procuraient. Bien qu’anglican, il alla souvent à l’église presbytérienne, épousa une catholique en secondes noces et s’opposa à l’orangiste tory Ogle Robert Gowan*, partiellement en raison de la forte position protestante de celui-ci. En 1836, en effet, il proclama son indépendance de tous les partis politiques et, en partie grâce à cette couverture, fut élu président de la chambre d’Assemblée en 1837.
Cependant, dans les années 1830, MacNab s’intéressa beaucoup à certains principes tories. Il souhaitait le développement des classes sociales, non leur amoindrissement ou leur abolition. Même au plus fort de son conflit avec les hommes politiques et les fonctionnaires de Toronto, il favorisa un Conseil législatif dont les membres seraient nommés, suggérant seulement que l’ensemble de ses conseillers soient plus représentatifs. Pour être écouté dans les milieux dirigeants et faire progresser les politiques militaires et économiques qu’il préconisait, MacNab tenta avec un certain succès de contourner le conseil, qui était sous la domination des tories de Toronto, et de traiter directement avec le lieutenant-gouverneur sir Francis Bond Head*. En 1836, MacNab s’opposa au gouvernement responsable parce qu’il romprait les liens « avec la mère patrie ». L’attachement à l’armée, bien que n’étant pas un phénomène exclusivement tory, était surtout une préoccupation du groupe dominant. C’est pourquoi en construisant Dundurn Castle, MacNab espérait parvenir, sans doute, à se faire admettre au sein de l’élite sociale de la colonie. Mais, en 1837, on ne pouvait prévoir qui du tory, de l’homme d’affaires ou de l’homme aux tendances libérales chez MacNab allait l’emporter.
Les tensions dans sa personnalité et ses vues du monde furent mises à rude épreuve par la rébellion mal inspirée de Mackenzie en décembre 1837 et janvier 1838. Avec quelque 65 hommes « recrutés à la hâte », MacNab se rendit précipitamment par bateau à vapeur à Toronto où, encouragé par Head, il aspira au commandement des forces loyalistes. Presque toutes les troupes régulières britanniques de Toronto avaient été dépêchées au Bas-Canada pour aider à réprimer la rébellion, mais à Toronto le colonel James FitzGibbon, retraité de l’armée active britannique et adjudant général de la milice, refusa de servir sous MacNab. On consentit à un compromis : sous le commandement nominal de FitzGibbon, MacNab conduisant le « corps d’armée principal », plus de 1 000 hommes se dirigèrent vers le nord, le 7 décembre, à la taverne Montgomery où ils mirent en fuite les rebelles.
MacNab ne fit pas attention aux plaintes et aux intrigues des officiers de l’armée active à Toronto qui prétendaient avoir été mal traités par Head et lui-même. À la suite de la victoire à la taverne Montgomery, Head nomma MacNab seul commandant des troupes envoyées dans le district de London pour réprimer les rebelles conduits par Charles Duncombe. La conduite de MacNab comme commandant fut discutable. Il eut à faire face à de graves problèmes de communication, de service d’approvisionnement, d’autorité sur des volontaires ardents, mais non aguerris, en même temps qu’il ignorait certaines règles fondamentales des opérations militaires. Il doit partager la responsabilité avec les services de l’Intendance, pour les privations et la démoralisation causées par les retards dans le paiement des miliciens et des fournisseurs. La mobilisation de plus de 1500 hommes se fit dans le plus complet désordre. Dès le 14 décembre, MacNab admit qu’il disposait « d’au moins six fois plus d’hommes [qu’il n’en avait] besoin ». Cependant, il prit la défense de son armée, insistant sur son importance comme menace et comme preuve de l’enthousiasme local, soutenant que « les volontaires qui se joign[aient à lui] dans ce district [London], ne seraient pas heureux d’être licenciés et tous laissés aux hommes de Gore ». Dans la confusion qui en résulta, Duncombe, comme l’avait fait Mackenzie avant lui, s’enfuit aux États-Unis.
MacNab traita les prisonniers rebelles de façon à modifier l’image qu’on se faisait de lui, d’un tory à l’esprit étroit. Il fut capable d’évaluer les degrés d’implication et, de sa propre initiative, il emprisonna seulement les chefs des rebelles et permit à leurs partisans « déçus » de rester libres sur parole. Il alla jusqu’à promettre la clémence à plusieurs. L’intérêt qu’il porta au simple soldat le fit également aimer de ses hommes. MacNab croyait que les officiers gagnaient le respect de leurs subordonnés non seulement par leur courage à la guerre mais aussi en tempérant la sévérité de la justice par la bienveillance et l’accessibilité en dehors du champ de bataille. Ses relations avec la milice furent généralement excellentes et il détourna adroitement les critiques de mauvaise administration vers le commandement central de Toronto et de Montréal.
Mackenzie quitta sa retraite américaine, rentra sur le territoire canadien et occupa l’île de Navy le 13 décembre 1837. Head continua d’ignorer les officiers réguliers de son état-major et, le 25 décembre, dépêcha le « populaire » MacNab, encadré d’officiers de l’armée régulière et appuyé par la marine, pour commander les troupes à la frontière du Niagara. Devant la participation active de sympathisants américains, le lieutenant-gouverneur reconnut que la révolte avait « pris un caractère nouveau et différent », bien que MacNab et lui-même eussent réagi comme ils l’avaient fait auparavant. Les volontaires du Haut-Canada affluèrent à la frontière – environ 2 000 vers le 29 décembre et plus de 3 000 au 10 janvier – bien que les fournitures et le cantonnement fussent insuffisants et, plus grave encore, les instructions imprécises. Alors qu’il refusait d’autoriser une attaque contre l’île, Head négligea d’indiquer d’autres solutions comme le blocus de l’île et de ses fournisseurs américains. Ni MacNab ni Head ne semblèrent aptes à interpréter les rapports contradictoires au sujet de la force ou du moral de leurs ennemis ; le colonel Colley Lyons Lucas Foster*, officier britannique compétent de l’armée active, resta à Toronto et le commandant en chef Colborne, qui était à Montréal, ne fut pas tenu au courant de la situation. MacNab alternait les exercices militaires et les exploits gastronomiques. La faiblesse de commandement au front devint apparente quand une sortie, à l’aube du 29 décembre, conduite par des officiers à moitié ivres, faillit tourner au désastre. MacNab et sa milice manquaient nettement de la discipline nécessaire pour contenir passivement les rebelles. Sur les ordres de MacNab, dans la nuit du 29 décembre, Andrew Drew*, officier retraité de la marine royale, conduisit un contingent contre le Caroline, navire américain qui approvisionnait les rebelles, et le détruisit dans les eaux américaines.
La réaction fut prompte. Un citoyen américain avait été tué et MacNab fut inculpé de meurtre dans le comté d’Erie, état de New York. Les journaux américains devinrent de plus en plus bellicistes. Colborne ordonna immédiatement au colonel Foster de prendre le commandement de toutes les milices et troupes régulières dans la province et au colonel Hughes, Britannique de l’armée active, de remplacer MacNab comme commandant à Niagara. Protestant que Hughes recevrait « tout le mérite », malgré que la milice et lui aient accompli « tout le travail pénible », MacNab devait finalement céder devant l’insistance de Colborne. MacNab quitta la frontière, ironiquement la nuit même où Mackenzie et ses rebelles se retirèrent à la dérobée de l’île de Navy. Pendant que le colonel Hughes occupait l’île presque déserte, MacNab, le destitué, intriguait à Toronto au sujet de son commandement perdu.
L’expérience de la rébellion, forte en émotions de toutes sortes, transforma l’attitude souple du MacNab des années 1830. Le sentiment d’avoir fait ses preuves, renforcé par la réception d’un titre de chevalier en mars 1838, fortifia sa conviction que les attributs du pouvoir et le prestige lui étaient dus à juste titre. Il ignora les critiques du juge en chef John Beverley Robinson, de William Henry Draper* et du gouverneur général Colborne, au sujet de son rôle pendant la rébellion. Il ne se rendit pas compte également que des bouleversements profonds étaient sur le point de se produire dans les structures sociales et politiques du Haut-Canada.
La décennie des années 1840 fut une période de changements économiques et politiques complexes. L’union du Haut-Canada et du Bas-Canada, en 1841, le rappel des Corn Laws en 1846 et la compression rigoureuse des dépenses furent le présage de l’avènement du gouvernement responsable en 1848. MacNab ne fut pas le seul à être impuissant ou à éprouver de la répugnance à s’adapter à un nouvel ordre de priorités politiques, économiques et sociales. Jusqu’au milieu des années 1840, John Solomon Cartwright, Henry Sherwood* et quelques autres tories appuyèrent les critiques de MacNab au sujet de la politique domestique et impériale. Après la retraite de Christopher Hagerman* au début de 1840, parce que MacNab fut le leader de ce petit groupe, beaucoup l’ont représenté comme le type parfait du tory attardé. En réalité, il ne fut pas tellement l’avocat d’une structure sociale et politique abstraite, que le défenseur de sa situation privilégiée à l’intérieur de la structure en place. L’ardeur de sa résistance aux changements dans les années 1840 varia directement selon l’obtention ou non de certains postes.
En 1839, le gouvernement britannique et son premier représentant au Canada, Charles Edward Poulett Thomson*, qui sera bientôt lord Sydenham, croyaient que l’union du Haut et du Bas-Canada, établie sur le fondement de la représentation égale et d’une direction modérée et efficace, conduirait à l’assimilation des Canadiens français et à une administration plus économique du pays. MacNab appuya les buts économiques du projet de loi de Thomson en faveur de l’union, mais s’opposa à ses aspects culturels parce qu’il avait conscience que les députés de langue française domineraient la législature et que les liens traditionnels du Canada avec la Grande-Bretagne diminueraient. En mars 1839, MacNab, Sherwood et plusieurs autres tories appuyèrent les motions de Cartwright, dont le but était d’assurer la prédominance des loyaux habitants du Haut-Canada dans la législature unie. Grâce à des conservateurs influents comme William Henry Draper qui votèrent contre elles, les motions de Cartwright furent rejetées.
Après cette défaite, MacNab était tout disposé à travailler à l’intérieur de la nouvelle union. Il était même prêt à accepter la définition du gouvernement responsable telle que donnée en 1839 par lord John Russell : le Conseil exécutif, bien qu’émanant de l’Assemblée, était responsable uniquement devant le gouverneur général qui devait avoir le droit de choisir et de remplacer ses membres aussi bien que de distribuer les postes. De cette façon, les liens traditionnels avec la couronne et le contrôle ultime de celle-ci demeureraient inviolés. De cette façon, également, présumait MacNab, on ne pouvait ignorer la présence de ceux qui étaient loyaux à la couronne.
Dans ses relations avec le Canada, à la fin des années 1830 et durant les années 1840, le ministère des Colonies fit valoir le besoin de bons administrateurs capables de relever les finances, ce que MacNab était loin d’être. Il fut également affecté directement par une réduction des dépenses. Ses honoraires élevés de conseiller de la reine (nomination qu’il reçut en 1838) furent minutieusement examinés et accordés à regret en 1839 et 1840. En dépit des protestations de MacNab, le commandement général de la milice de Gore fut confié à un officier plus expérimenté durant le soulèvement des Patriotes de juin 1838. Non seulement les recommandations de MacNab furent ignorées lors de la réorganisation de la milice en 1839–1840, mais aussi, en raison de coupures budgétaires, il ne put continuer plus longtemps d’être officier dans la milice active. La perte de ce poste diminua son prestige, ses chances de faire du « patronage » et son revenu.
Vers le milieu de l’année 1841, MacNab avait concentré son mécontentement croissant sur le gouverneur général. Sydenham encouragea son secrétaire provincial, Samuel Bealey Harrison, qu’il considérait comme un homme politique modéré et talentueux, à se porter candidat dans Hamilton parce que MacNab avait fait savoir qu’il se présenterait dans Wentworth. Quand MacNab déjoua la manœuvre en se présentant dans Hamilton où il défit Harrison, ses relations tendues avec Sydenham devinrent évidentes. Incapables d’en arriver à un accord, les deux parties se crurent victimes d’injustice et de trahison. En ignorant les sujets loyaux, conclut MacNab, Sydenham allait à l’encontre de la vraie politique de la couronne et, en conséquence, on devait lui résister. Malheureusement pour la crédibilité de MacNab, sa définition d’une juste politique avait tout l’air d’une argumentation spécieuse : qui, après tout, était plus loyal que lui le chevalier valeureux ?
Si Sydenham ne pouvait pas calmer MacNab, il pouvait l’isoler. C’est ce qu’il fit. Sous la tutelle de Sydenham, les alliés virtuels de MacNab, comme Draper, commencèrent plutôt à former un parti qui se caractérisait par ses vues modérées et ses hommes doués de compétence administrative. À court d’appui – il put compter sur six ou sept votes dans la législature après les élections de 1841 – MacNab rechercha une entente avec le parti canadien-français par laquelle on mettrait fin à l’Union et on créerait à la place deux gouvernements liés par une politique économique commune. De concert avec les réformistes du Haut-Canada, tels que Robert Baldwin* et Francis Hincks*, MacNab réalisa que les Canadiens français formaient le groupe pivot à l’intérieur de l’Union et qu’ils ne pourraient ni ne voudraient être assimilés, comme l’espéraient lord Durham [Lambton*] et Sydenham. Privé par Sydenham d’avancement dans le gouvernement, MacNab réagit d’une manière qui lui avait profité dans le passé ; il en appela directement à une instance supérieure. Inexplicablement, ou tel il sembla à MacNab, un voyage en Angleterre, au début de 1842, se révéla infructueux. Le ministre des Colonies, lord Stanley, lui refusa la dignité de baronnet mais, à titre de compromis, MacNab se vit offrir le poste d’adjudant général du Haut-Canada. Toutefois, quand le successeur de Sydenham, sir Charles Bagot, fit obstacle à cette nomination, l’amertume de MacNab dépassa les limites. De plus en plus isolé au sein de l’Assemblée – même Sherwood entra dans l’administration de Bagot à titre de solliciteur général en juillet 1842 – MacNab, comme l’écrivit Bagot, se conduisit « d’une manière très factieuse – et très mal ».
En septembre 1842, la meilleure occasion de sa vie s’offrit à MacNab d’organiser un parti efficace. Des tories tels que Sherwood et plusieurs conservateurs modérés désapprouvaient la formation du premier gouvernement réformiste de Baldwin et Louis-Hippolyte La Fontaine. Draper se retira de la politique active et MacNab devint chef des éléments conservateurs modérés et tories dissidents. Mais quand le gouvernement réformiste remit sa démission en décembre 1843 sur la question du contrôle du « patronage », sir Charles Metcalfe* désigna Draper, le modéré semi-retraité, pour former un nouveau gouvernement. Comme l’a plus tard expliqué Metcalfe, MacNab était « tellement antipathique aux partis qui constituaient alors la majorité dans la chambre d’Assemblée [...] qu’[il pouvait] difficilement le faire entrer au conseil ».
Tard en 1844, MacNab commença à prendre un certain recul : les vieux alliés, tels que Cartwright, quittaient la politique ; les relations personnelles entre MacNab et Draper étaient tendues, au moins depuis l’affaire du Caroline. À la suite des déceptions que lui avaient causées les autorités coloniales, les différences avec les réformistes ne lui semblaient plus tellement irréconciliables. Même sur la question cruciale de la fidélité à l’Angleterre, il admit publiquement que Baldwin répondait à toutes les exigences. En fait, il se méfiait plus maintenant des conservateurs comme Sherwood, qui l’avaient laissé tomber sur des questions décisives dans le passé, que de plusieurs réformistes. Le pragmatisme souple dont il fit preuve avant 1837 commençait à réapparaître. Comme il le confia à un ami : « la persévérance et le travail, bientôt, me permettront de surmonter tous mes malheurs ». De 1845 à 1847, ses faits et gestes politiques plus modérés peuvent être attribués à des opérations lucratives dans les chemins de fer qui retenaient davantage son attention.
C’est sir Allan qui, en juillet 1851, après avoir bu « une ou deux bouteilles de bon porto », formula la phrase bien connue : « Ma politique se résume dans les chemins de fer. » Après 1845, il fut à diverses reprises président de trois compagnies, président du conseil d’administration d’une autre et administrateur d’au moins deux autres : le Great Western, 1845–1854 ; le Grand Tronc, 1854–1856 ; le Galt and Guelph, 1853–1860 ; le Hamilton and Toronto, 1853–1856 ; le Hamilton and Port Dover, 1854–1860 ; la North West Transportation, Navigation, and Railway Company, 1858–1860. Il présida sept fois la commission des chemins de fer à l’Assemblée, entre 1848 et 1857. George Brown* l’accusa de s’être « arrangé pour faire la fortune ou la ruine de chaque projet de chemin de fer selon qu’il le jugeait à propos ». Par ses discours publics et ses lettres privées, MacNab donnait prise à ce jugement. Comme ce fut le cas de plusieurs des activités de MacNab, cependant, la réalité était plus terre-à-terre.
Durant la période exploratoire du développement des chemins de fer, avant 1850, l’énergie indomptable et le peu de scrupules de MacNab l’ont beaucoup aidé. À titre de président du Great Western entre 1845 et 1849, il fut actif au pays et à l’étranger. Inlassablement, il désarma ses deux principaux compétiteurs, le Niagara and Detroit Rivers Railway dirigé par John Prince et le Toronto and Goderich Railway dirigé par le vénérable homme d’affaires de Toronto, William Allan*, et défendu à l’Assemblée par le rival de MacNab au leadership tory, Henry Sherwood. En stigmatisant le premier comme une arme des capitalistes américains et le dernier comme une extension de la Canada Company, il s’acquit l’appui en faveur du Great Western. Il conclut aussi un arrangement clandestin avec Prince qui, en retour d’une somme dont la rumeur fit état, retira son projet de la compétition directe pour trois ans.
Malgré ses critiques sur les sources de financement de Prince, MacNab rechercha lui aussi l’appui financier au sud de la frontière et, pendant une brève période, employa même comme agent William Hamilton Merritt, le représentant politique et financier du Niagara and Detroit Rivers Railway. Ses relations avec les capitalistes britanniques révèlent un côté sordide de la carrière de MacNab dans les chemins de fer. Il refila 55 000 actions du Great Western à un syndicat dirigé par le roi tristement célèbre des chemins de fer en Grande-Bretagne, George Hudson, qui à son tour tenta de vendre ces actions à un prix artificiellement gonflé avant le premier appel de capital. MacNab et Peter Buchanan* se joignirent au syndicat en vendant les actions jusqu’alors sans valeur. C’était le dernier des soucis du spéculateur que l’acheteur pût fournir le capital au-delà du premier paiement, même si le chemin de fer ne pourrait être construit si on était incapable de répondre à des appels ultérieurs de capital. Se fichant de cette distinction, MacNab encaissa un bénéfice de £2 500. Parce que l’économie était à la baisse, cependant, le syndicat ne put écouler toutes ses actions, ni payer le premier appel. Pour la somme de £5 000 MacNab permit aux membres du syndicat de lui remettre toutes les actions moins 10 000. Les intérêts du portefeuille de MacNab primaient ceux du chemin de fer. Son mercantilisme, son insuccès dans la recherche de sources de capitaux sûres pour le chemin de fer, son incompétence dans la gérance, et son influence déclinante à l’Assemblée lui valurent d’être déposé comme président du Great Western en 1849, bien qu’il demeurât un des administrateurs.
Pour MacNab, c’était un revers parmi d’autres. Sa femme était décédée en 1846. L’année suivante, il fut de nouveau incapable d’obtenir le poste d’adjudant général. Lors de la démission de Draper en mai 1847, Sherwood, de qui MacNab ne pouvait espérer que peu de tolérance, prit la tête du gouvernement. Il ne parvint pas non plus à réaliser une alliance avec Baldwin parce que, comme l’a noté un historien, les réformistes étaient « assez puissants [...] pour ignorer les avances du chevalier ». Même si MacNab avait été président (orateur) depuis 1845 et espérait être réélu en 1848, le nouveau gouvernement Baldwin-La Fontaine appuya plutôt Augustin-Norbert Morin. Ayant trop spéculé sur les terrains – à la fin de 1845, William Cayley* et lui avaient acheté de George Rolph 145 acres dans la ville de Dundas pour £7 200 – ses finances étaient désorganisées et ses créanciers désireux « de serrer la vis ». Pour comble, la goutte était devenue sa fidèle compagne.
Sa frustration et sa colère furent à leur comble lors de l’adoption, en 1849, du projet de loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion, que MacNab regardait comme une récompense des activités rebelles du passé. Il revint à l’attitude factieuse et amère qui l’avait caractérisé en 1843. S’appuyant sur le mécontentement à Montréal et dans les centres urbains à travers le Haut-Canada au sujet de la situation économique, il dénonça dans des discours et décria lord Elgin [Bruce], les Canadiens français, ainsi que les réformistes « déloyaux ». À la différence des tories de Montréal, cependant, il ne chercha pas à excuser l’incendie des édifices du parlement et la signature du Manifeste annexionniste. Il préféra se rendre à Londres et faire un appel personnel aux plus hautes autorités. Informé par le ministère des Colonies que l’intervention britannique dans les affaires canadiennes irait à l’encontre du gouvernement responsable, il revint chez lui abattu et quelque peu déprimé.
Ce qu’il y avait de turbulent et d’ultra-tory chez MacNab disparut finalement à la fin de 1849. Graduellement, il mit de l’avant l’aspect modéré, visible dans la période d’avant la rébellion, qui lui permit de combler le vide entre les factions tories extrémistes et conservatrices modérées. Sa conduite pondérée pendant la crise des indemnités aux victimes de la rébellion, comparée à celle de plusieurs tories, le maintint en bonne position. Graduellement, il devint le premier porte-parole des tories sur les questions importantes. Après avoir succédé à Sherwood comme leader en 1849 et 1850, MacNab, au début des années 1850, fit de son mieux pour contenir la faction ultra-tory qui adhérait à la High Church. En 1852, conscient, comme il le fut au début des années 1840, que la puissance parlementaire reposait en fin de compte sur une alliance avec les députés francophones, il tenta de miner le groupe réformiste du Haut-Canada faisant partie du gouvernement Hincks-Morin formé à la fin de 1851, en prenant contact avec Joseph-Édouard Cauchon*, partisan influent de Morin. On en arriva à une entente préliminaire sur une alliance qui viserait à garantir « à chaque partie de la province [...] la direction entière de sa législation et de son gouvernement ». Mais on ne mit pas l’entente en vigueur à ce moment. Étant partisan des écoles confessionnelles, MacNab permit aussi aux conservateurs qu’il dirigeait de faire de la sécularisation des réserves du clergé, sur laquelle il avait été d’opinion modérée depuis les années 1830, une question libre lors des élections de 1854.
Ce fut la modération de MacNab qui, en partie, facilita la formation, en septembre 1854, d’une alliance entre les conservateurs du Haut-Canada et les réformistes de Hincks-Morin. Quelques ultra-tories s’y opposaient ainsi qu’un groupe plus nombreux de Clear Grits conduits par George Brown. MacNab étant devenu premier ministre, la coalition adopta d’importantes mesures législatives : la réorganisation de la milice, la sécularisation des réserves du clergé, l’abolition de la tenure seigneuriale et l’établissement d’un Conseil législatif électif, mesures qui placèrent MacNab à l’avant-garde des réformes politiques. La coalition de 1854 fut possible parce que, pour les conservateurs modérés et les réformistes modérés, autant français qu’anglais, les liens économiques dépassaient les différences confessionnelles. Au désir commun d’une organisation rationnelle de l’économie s’ajoutait chez les réformistes modérés canadiens-français un sentiment de crainte face à la puissance grandissante des Clear Grits. Comme John Alexander Macdonald*, MacNab semblerait avoir été l’héritier direct du conservatisme modéré du Draper des années 1840.
La conduite politique de MacNab dans les années 1850, cependant, ne peut se comprendre indépendamment de ses affaires personnelles dans les chemins de fer. En 1850, l’administration des chemins de fer exigeait une compétence particulière que ne possédait pas MacNab. Quand il vint à comprendre qu’il ne pourrait pas exercer le pouvoir réel, il commença de plus en plus à en convoiter le faste. Durant les années 1850, il rechercha surtout la sécurité et s’efforça constamment, comme il le confessa, « de régler [ses] affaires embrouillées et d’assurer le bien-être de [ses] enfants ». Il employa souvent des moyens dénués de scrupules. Par exemple, alors qu’il était président du Great Western en 1847, Charles Stuart, l’ingénieur en chef, fit le tracé du chemin de fer à travers son domaine. Comme administrateur en 1851, MacNab vendit une partie de sa propriété de Burlington Heights au chemin de fer, à un prix exorbitant. En 1860, ses bénéfices sur les chemins de fer se montaient en valeur d’aujourd’hui aux environs de $400 000.
MacNab, au courant des manœuvres louches des promoteurs d’une filiale du Great Western, tenta aussi l’extorsion. Peter Buchanan donna à un autre promoteur l’avertissement suivant : « si [MacNab] n’a pas approuvé d’une manière formelle vos actes dans le Hamilton and Toronto, il pourrait fort bien les mettre en doute et même vous taxer d’illégalité ». Mais MacNab ne pouvait guère aller plus loin : il existait en effet des preuves écrites qu’il avait des intérêts dans un contrat de construction de route, dont il était lui-même un des administrateurs. Bien que ses coadministrateurs tracassés fussent tout à fait disposés à tromper les actionnaires, le gouvernement et le public en général, ils se refusaient à trahir leurs propres collègues. Ce qui n’était pas le cas de MacNab. Avec ses procédés inusités, sa réputation suspecte, il était, selon les dires d’un associé, « une excroissance dont on ne peut se défaire ».
Le Great Western tenta de se débarrasser de MacNab comme administrateur en juin 1854, et en guise d’essai lui promit un cadeau de £5 000 s’il prenait sa retraite. MacNab accepta la promesse et se tourna ensuite vers le grand rival du Great Western, le Grand Tronc, dont les politiques concernant les accords de tarifs et les pratiques compétitives courantes avaient retenu de plus en plus son attention à mesure que ses relations avec le Great Western se détérioraient. Ainsi, le gouvernement de coalition de 1854, approuvé par Francis Hincks, réformiste et, pendant longtemps, promoteur du Grand Tronc, et par John Ross*, président de cette compagnie, était politiquement favorable à MacNab, particulièrement parce que, comme premier ministre, il pouvait extorquer de l’argent du Great Western tout en étendant son influence dans les cercles du Grand Tronc. En 1854, un des administrateurs du Great Western fit pression pour en arriver à « une entente immédiate [...] avec MacNab pour £5 000 [... afin] de s’assurer qu’il reste à la tête du gouvernement et accorde son appui à la compagnie ». MacNab reçut les £5 000 en avril 1855, mais il ne fut pas aussi chanceux avec le Grand Tronc. Son pouvoir politique précaire commença à lui échapper en 1855 et 1856. MacNab fut rarement à l’Assemblée parce qu’il était atteint de la goutte, et quelques-uns de ses collègues pensèrent qu’il avait retardé le projet de loi ayant pour but de rendre électif le Conseil législatif. S’opposant à la conception étroite que se faisait MacNab du favoritisme, à son leadership de plus en plus décroissant et, sans doute, à ses tentatives pour acquérir le pouvoir à l’intérieur du Grand Tronc, John Ross démissionna du gouvernement de coalition en avril 1856. Plaidant l’absence d’une majorité pour leur parti dans le Haut-Canada, les autres membres du gouvernement venant du Haut-Canada démissionnèrent au mois de mai. Transporté à l’Assemblée, MacNab nia s’être opposé à aucune mesure libérale proposée par le gouvernement. Il ne trouva pas d’appui et démissionna, sur quoi John Alexander Macdonald forma un nouveau ministère incluant, à l’exception de MacNab, la plupart des anciens membres. En novembre, il fut évincé du poste d’administrateur du Grand Tronc. MacNab avait joué jusqu’au bout ses atouts : il semblait alors à bien des gens qu’en politique aussi bien qu’en matière de chemins de fer, il n’était plus du tout utile.
Un autre versement de £6 000 fut effectué à MacNab par le vice-président du Great Western, John Radcliffe, qui, en retour, rechercha l’aide de MacNab dans l’achat d’un réseau de lignes de chemin de fer communément connu comme la voie du sud. MacNab accepta avec empressement, sans doute stupéfié du peu d’intelligence de Radcliffe. Revigoré grâce au titre de baronnet, qu’il obtint en juillet 1856 sur la recommandation du gouverneur général sir Edmund Walker Head, et au cadeau de £ 6000 du Great Western, il s’embarqua pour l’Angleterre.
N’ayant rien obtenu en faveur du Great Western, MacNab revint pour peu de temps au Canada en 1857 et démissionna de son siège à la législature puis retourna en Angleterre. En 1859, il disputa sans succès le siège de Brighton à la chambre des Communes d’Angleterre. Tracassé par des problèmes financiers et par la difficulté de vendre certains terrains, il revint de nouveau à Hamilton pour régler ses affaires. En dépit de la goutte dont il souffrait, il se porta candidat au Conseil législatif comme représentant de la division de Western en 1860, fut élu et devint orateur (président) en 1862. La perspective d’une vente de terrains appréciable au gouvernement dominé par les conservateurs l’incita à se tourner vers le Conseil législatif. Il reçut $20 000, mais ce ne fut pas assez pour contenter ses nombreux créanciers. En août 1862, mourait le laird de Dundurn, débiteur sans un sou vaillant.
Même sa mort souleva des controverses. Pendant que ses créanciers discutaient de ses biens, la possession de son âme fut l’objet d’un débat entre les Églises anglicane et catholique. Cette dernière querelle fut gagnée par sa belle-sœur, Sophia Stuart, catholique fortement trempée. Bien que Sophia, la seconde fille de MacNab, eut épousé en 1855 un baron anglais, le vicomte Bury, sir Allan partit sans laisser d’héritier mâle. Robert, son fils unique, était mort en 1834. C’est ainsi que ses nombreuses distinctions sociales ne purent être léguées à personne.
Peu doué dans le domaine de la planification et de l’organisation, mais instigateur enthousiaste de nombreux projets commerciaux, militaires et politiques, MacNab entretint une image qui en fait ne recouvrait rien et ses succès étaient plutôt une façade. Le fait qu’il n’appartenait pas entièrement au monde des grands féodaux et n’était pas membre de sa classe dirigeante, ni ne faisait partie totalement du monde des grands entrepreneurs explique qu’il servit de pont entre les deux groupes, mais combien fragile. Sous cet aspect, il fut le reflet de plusieurs des contradictions qui se manifestaient dans le Haut-Canada pendant une période de profonds changements sociaux, politiques et économiques.
Allan Napier MacNab fut un homme public et d’affaires durant une si longue période que ses lettres, ou des documents le concernant, se trouvent dans la plupart des fonds d’archives. Nous ne donnerons dans cette bibliographie que les sources les plus importantes que nous avons consultées. [p. b.]
APC, MG23, L4 ; MG24, A13 ; A15 ; A40 ; B4 ; B14 ; B17 ; D16 ; D18 ; E1, 2–40 ; G20 ; 125 ; MG26, A, 539 ; RG 1, E3, 21, 49, 54 ; RG 5, A1, 115, 127, 138, 140–141, 184, 195, 217, 242 ; RG 7, G16, A, 3 ; RG 8,1 (C series), 610, 924, 1227, 1272, 1274 ; RG 9, I, B3, 2, 5, 6 ; RG 30, 1–17.— HPL, Ferrie papers ; Hamilton biography, Sir Allan Napier MacNab.— MTCL, William Allan papers ; Robert Baldwin papers ; Samuel Peters Jarvis papers.— PAO, Cartwright (John Solomon) papers ; Gilkinson (William and Jasper T.) papers ; Jarvis-Powell papers ; Macaulay (John) papers ; Robinson (John Beverley) papers ; Street (Samuel) papers.— PRO, CO 42/439, 42/444.— QUA, John Solomon Cartwright papers ; Kirkpatrick-Nickle legal records ; John Macaulay papers.— UTL-TF, ruts coll. 56.— UWO, 144 (Harris family papers).— Arthur papers (Sanderson).— Canada, House of Commons, Journals, 1870, app.l.— Canada, prov. du, Legislative Assembly, Journals, 1841–1862.— Coll. Elgin-Grey (Doughty).— Debates of the Legislative Assembly of United Canada (Gibbs et al.).— H.-C., House of Assembly, Journal, 1830–1841.— Macdonald, Letters (Johnson et Stelmack), I.— Opinions of the Canadian press of the Hon. Sir Allan Napier MacNab, bart., late speaker of the House of Commons in Canada (Londres, 1859).— British Colonist (Toronto), 1838–1854.— Colonial Advocate, 1834.— Correspondent and Advocate (Toronto), 1834–1836.— Examiner (Toronto), 1838–1855.— Globe, 1845–1862.— Gore Gazette (Ancaster, Ont.), 1827–1829.— Hamilton Gazette (Hamilton, Ont.), 1852–1855.— Hamilton Spectator, 1847–1862.— Leader, 1853–1858.— Times (Hamilton, Ont.), 1858–1862.— Toronto Patriot, 1832–1844.— Dent, Canadian portrait gallery, IV.— Morgan, Sketches of celebrated Canadians.— Notman et Taylor, Portraits of British Americans, II.— P. A. Baskerville, The boardroom and beyond ; aspects of the Upper Canadian railroad community (thèse de
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Peter Baskerville, « MacNAB, sir ALLAN NAPIER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/macnab_allan_napier_9F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/macnab_allan_napier_9F.html |
| Auteur de l'article: | Peter Baskerville |
| Titre de l'article: | MacNAB, sir ALLAN NAPIER |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1977 |
| Année de la révision: | 1977 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |