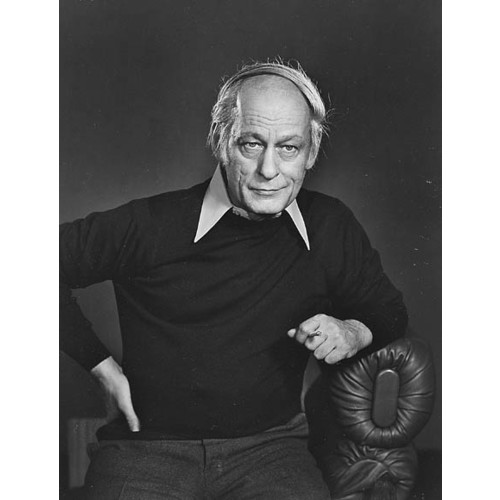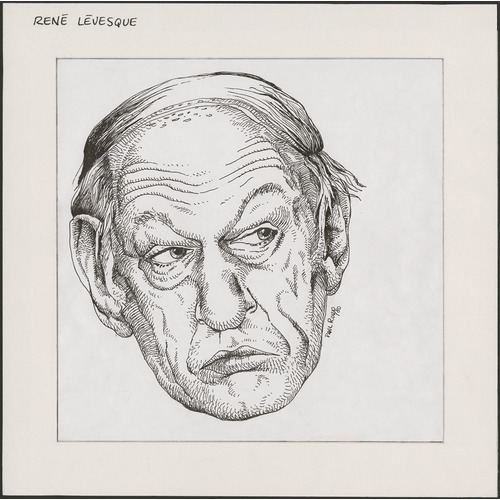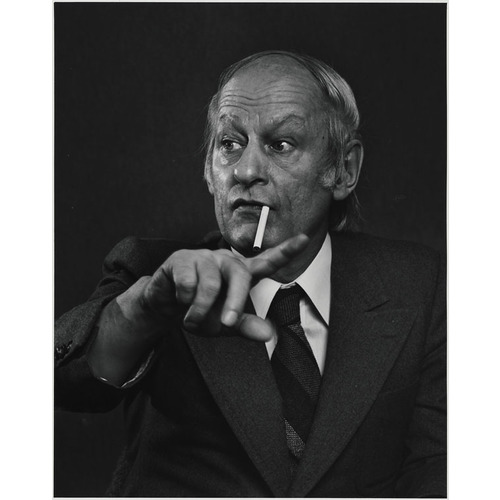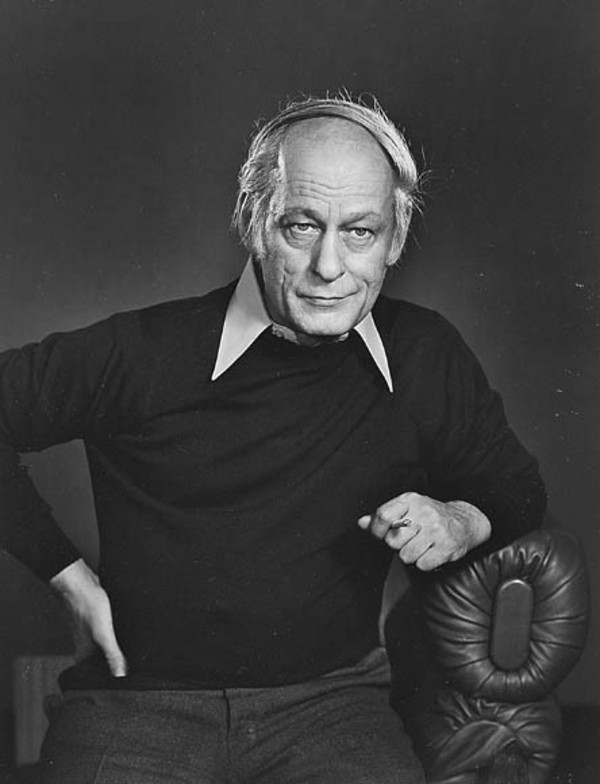
Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3195219
LÉVESQUE, RENÉ (baptisé Charles-René), journaliste, homme politique et auteur, né le 24 août 1922 à Campbellton, Nouveau-Brunswick, et baptisé le 10 septembre suivant à New Carlisle, Québec, fils aîné de Dominique Lévesque, avocat, et de Diane Dionne ; le 3 mai 1947, il épousa à Québec Louise L’Heureux, et ils eurent deux garçons et une fille ; divorcé en 1978 ; le 12 avril 1979, il épousa à Montréal Corinne Côté (décédée en 2005) ; décédé le 1er novembre 1987 à Montréal et inhumé le 5 au cimetière de la paroisse Saint-Michel à Sillery (Québec).
Durant les années 1920, la côte sud de la Gaspésie, dans la province de Québec, ne dispose d’aucun hôpital digne de ce nom. Aussi le plus québécois des premiers ministres québécois a-t-il poussé ses premiers cris dans un hôpital du Nouveau-Brunswick, de l’autre côté de la baie des Chaleurs. De son propre aveu, René Lévesque connaît une enfance heureuse à New Carlisle, au bord de la mer, entre un père idolâtré, pour qui le mot « culture » a un sens, et une mère dont le caractère est du vif-argent comme le sien, d’où une relation difficile, mais pleine de « je t’aime » jamais prononcés. L’enfant grandit dans cette inoubliable Gaspésie du bout du monde, avec ses pêcheurs de morue et ses villages qui se jettent dans la mer. Selon ses proches, la compassion marquée qu’il témoignera toute sa vie pour les démunis et les petites gens lui vient de son vieux fond gaspésien, de son contact précoce avec la pauvreté et le sous-développement, même si lui est issu d’une famille aisée. Une attitude sans doute explicable aussi par le modèle du père admiré, dont il dira que, tout avocat qu’il était, il affichait un respect inconditionnel des autres.
New Carlisle compte alors un peu moins de 1 300 habitants dont le tiers, francophone, subit la loi des grandes familles loyalistes qui, fuyant la Révolution américaine, s’y sont fixées au xviiie siècle. Deux sociétés différentes vivant côte à côte, parfait symbole des « deux solitudes » canadiennes. Dans ce monde où l’anglais est le passeport obligatoire pour se faire comprendre, le jeune René ne tarde pas à devenir bilingue. Il découvre aussi que les riches parlent anglais, habitent des résidences qui ont l’air de châteaux à côté des modestes maisons des francophones, et disposent d’un réseau d’écoles modernes qui font paraître son école de rang pour ce qu’elle est : une « misérable cabane à plus d’un kilomètre de la maison », écrira-t-il dans Attendez que je me rappelle…, les mémoires qu’il publiera à Montréal en 1986.
Toute sa vie, Lévesque montrera une image d’homme du peuple qui tranchera avec ses origines bourgeoises. Sa mère, Diane Dionne, est fille de médecin et appartient à la lignée des seigneurs de Tilly, près de Québec. Originaire de Saint-Pacôme, dans la région de Kamouraska, son père est un avocat en vue du barreau de Québec en Gaspésie. Avant de s’établir à New Carlisle et de s’intégrer à l’élite canadienne-française alliée au family compact loyaliste qui régente la ville, Dominique Lévesque a été l’associé d’Ernest Lapointe*, dont le cabinet d’avocats était situé à Rivière-du-Loup et qui deviendra le lieutenant québécois du premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King*. Rebelle dans l’âme, le jeune René a de qui tenir. L’un de ses ancêtres maternels, riche habitant et bailli de la seigneurie de La Pocatière, Germain Dionne, nostalgique du Régime français, a combattu l’armée anglaise aux côtés des insurgés américains lors du soulèvement des colonies. Côté paternel, son ancêtre Charles Pearson est un mutin de la marine britannique qui, après avoir déserté son navire en rade dans l’anse de la rivière Ouelle, y a pris racine et y est devenu premier meunier du moulin seigneurial. En 1817, il s’est marié avec Marguerite Pastourel ; leur fille Marcelline a épousé Dominique Lévesque (arrière-grand-père paternel de René), de la sixième génération des Lévesque originaire de Normandie.
Très tôt, René Lévesque se rend compte qu’il est né pour tenir les premiers rôles. Aîné d’une famille de quatre enfants, il en impose à tous, tant à l’école de rang de New Carlisle qu’au séminaire de Gaspé, où il entreprend ses études classiques en septembre 1933. À son arrivée au séminaire, l’une des premières questions qu’il adresse au supérieur, le père Alphonse Hamel, a pour but de savoir s’il y a une bibliothèque. Il accepte mal la discipline, affiche un côté calculateur, atténué cependant par un leadership intellectuel évident. Initié par son père aux grands maîtres de la littérature française et à la politique, il est plus éveillé et cultivé que la moyenne. Conscient de sa supériorité, il ne se lie pas facilement, préférant à l’amitié la compagnie des Jules Verne, Alexandre Dumas, Émile Zola ou Victor Hugo, auteurs qu’il découvre dans la bibliothèque bien garnie de son père. Secret de nature, il élève un mur devant celui qui veut l’entraîner sur le terrain des émotions et des sentiments, trait de caractère qu’il conservera sa vie durant. Mais, comme ce surdoué remporte tous les prix, on lui pardonne tout.
Les maîtres jésuites de René, dont Charles Dubé, cousin du fameux François Hertel [Rodolphe Dubé], le choient, tout en le sensibilisant à l’effervescence nationaliste et à ses causes, l’infériorité économique et sociale des Canadiens français qu’attise la misère noire des années 1930. Dans ses mémoires, Lévesque avouera qu’il a apprécié le livre iconoclaste de François Hertel, Leur inquiétude, publié à Montréal en 1936 et dont la conclusion limpide prédit que la séparation du Québec se fera un jour. Durant la campagne électorale de 1935, à l’occasion d’une assemblée publique dans la cour du séminaire, il entend la diatribe nationaliste du dentiste Philippe Hamel*, tribun couru de l’Action libérale nationale, contre l’emprise des « trusts étrangers » sur la vie des Canadiens français. À 13 ans, dans le journal du séminaire, « l’Envol », il pose la question existentielle : pourquoi demeurer Français ? Sa conclusion montre combien sa pensée politique se fait déjà précise et annonce le politicien nationaliste réaliste, tout en laissant transparaître un sentiment vaguement revanchard : « Réclamons aux Juifs et aux Américains, au lieu des postes méprisables que nous possédons, les positions élevées qui nous sont dues. Du jour où cela sera accompli, nous pourrons nous dire maîtres chez nous. »
En juin 1937, une tragédie frappe René, qui a alors 14 ans. Son père, l’homme le plus important de sa vie, comme il l’écrira dans ses mémoires, meurt à 48 ans dans un hôpital de Québec. À la fin de l’été de 1938, René est transplanté de sa baie des Chaleurs natale à Québec. Il vit comme une trahison le remariage rapide de sa mère, en janvier 1939. Diane Dionne épouse en effet Albert Pelletier, avocat lié à l’hebdomadaire séparatiste de Québec la Nation, dont l’influence sur le jeune René comptera malgré leurs rapports personnels difficiles. Privé de la rigueur d’un père idolâtré, brouillé avec sa mère, il décroche peu à peu des études. Il a brillé en rhétorique, comme à Gaspé, mais au début de 1940, tandis qu’il fait sa première année de philosophie, les autorités du collège des jésuites Saint Charles Garnier lui montrent la porte, ses notes ayant misérablement chuté. On accepte alors de le prendre au séminaire de Québec ; il y termine tant bien que mal ses études classiques en 1941, avant d’entreprendre, à l’université Laval, des études de droit qu’il abandonne en 1943, au grand désespoir de sa mère.
Lévesque opte pour la bohème, court les filles, s’adonne au poker avec Jean Marchand et Robert Cliche*, deux étudiants de l’université Laval promis comme lui à la célébrité, et rêve de devenir écrivain. Dramaturge en herbe, il écrit avec Lucien Côté une « folichonnerie pleine d’imagination », Princesse à marier, qu’il fait jouer au palais Montcalm, à Québec. La pièce est un four monumental. Échec qui ne l’empêche pas de faire une seconde et dernière incursion dans le monde d’Arlequin. En 1943, vraisemblablement, il écrit pour la radio un texte intitulé Aux quatre vents. La pièce ne sera jamais jouée avant qu’on la retrouve, un demi-siècle plus tard ; elle sera publiée à Montréal en 1999. Âgé d’une vingtaine d’années, Lévesque y paraît pessimiste au sujet de l’avenir des Canadiens français de son temps, qu’il ravale à un peuple rendu invisible par l’histoire. Aux quatre vents annonce aussi le René Lévesque des années à venir. En effet, que fera-t-il de sa vie, sinon la passer tout entière à tenter de libérer de leur invisibilité ces Canadiens français devenus des Québécois ?
En réalité, la véritable passion de Lévesque, c’est le journalisme radiophonique découvert plus tôt à CHNC, à New Carlisle, durant l’été de 1938, son dernier été gaspésien. Tandis qu’il fait ses classes à la station de radio privée CKCV, au carré D’Youville, puis à CBV, station régionale de Radio-Canada, au château Frontenac, la guerre éclate. Comme beaucoup de Québécois de sa génération qui répugnent à verser leur sang pour le Commonwealth, Lévesque s’oppose à la conscription obligatoire, question qui déchire le Canada. Mais l’appel du général Charles de Gaulle lancé en juin 1940 à la France occupée l’ébranle. Les nazis menacent la liberté et la démocratie. C’est le défi de sa génération : il ne peut s’en laver les mains.
À l’automne de 1943, Lévesque a 21 ans. Il est appelé sous les drapeaux. Il veut bien aller la voir, cette guerre dont il entretient ses auditeurs sur les ondes de CBV, mais avec un microphone, non un fusil. Il plaide d’abord auprès de ses supérieurs immédiats à Radio-Canada, qui parviennent à faire reporter son entraînement militaire à janvier 1944. Peu avant la date fatidique, il exhorte en vain le directeur général de Radio-Canada de lui dénicher un poste de correspondant de guerre dans l’une des équipes d’outre-mer de la société. C’est l’oncle Sam qui lui épargne le service militaire. L’Office of War Information américain recrute en effet des agents d’information bilingues, comme lui. En mai 1944, le voilà donc à Londres, à la section française de l’émission Voice of America, la Voix de l’Amérique, qui dépend de l’American Broadcasting Station in Europe, radio montée par les Américains qui inonde de propagande les pays occupés, notamment la France. En juin, quand survient le débarquement des Alliés sur le sol français, Lévesque a hâte de se retrouver sur la ligne de feu, mais son odyssée guerrière ne débute vraiment qu’en février 1945. Coiffé du titre de junior lieutenant, il rejoint l’armée du général Omar Nelson Bradley qui, après avoir libéré une partie de la France, s’est arrêtée à Paris. C’est ensuite la marche vers la frontière allemande aux côtés des généraux George Smith Patton et Alexander McCarrell Patch, la traversée du Rhin, la découverte de l’Allemagne revenue à l’année zéro avec ses grandes villes dévastées comme Nuremberg, Stuttgart et Munich. Enfin, c’est l’horreur de l’holocauste qui lui soulève le cœur au moment où il pénètre dans le camp de Dachau avec le premier contingent de journalistes américains à y entrer.
Lorsque Lévesque revient au pays, à l’automne de 1945, un abîme le sépare de l’apprenti journaliste d’avant-guerre. Sa vie durant, il multipliera les mises en garde, soulignant que, dans toute société, il existe un potentiel de jungle et de barbarie. Il se montrera toujours méfiant vis-à-vis des dérapages possibles du nationalisme québécois qu’il incarnera cependant avec force et raison.
Radio-Canada vient à la rescousse de Lévesque en lui ouvrant ses portes, à la fin du mois d’octobre 1945. Malgré une voix éteinte rapportée de guerre, il devient annonceur à la Voix du Canada, émission quotidienne d’information produite par le service international de Radio-Canada, et diffusée de Montréal à l’adresse de la France et de certains autres pays et territoires de langue française. Lévesque y présente les actualités canadiennes en quatre volets : nouvelles, documentaires, reportages et activités culturelles. Il y restera près de huit ans. Il trouve aussi refuge dans le mariage, les enfants, la famille. Le 3 mai 1947, il jure fidélité à Louise L’Heureux, sa promise d’avant-guerre.
À Radio-Canada, Lévesque n’est pas confiné à ses activités pour la Voix du Canada (qui sont parfois diffusées au pays) : on peut l’entendre aussi sur le réseau national. Après avoir animé Journalistes au micro (1949–1950), il collaborera simultanément à la Revue de l’actualité (1951–1954) et à la Revue des arts et lettres (1952–1954), où il mettra du vitriol dans ses critiques de cinéma. En quelques années, il s’impose comme l’une des valeurs sûres de Radio-Canada. Imaginatif, mais brouillon, il adore les reportages à chaud. Ceux qu’il écrit de Corée, où il séjourne comme correspondant de guerre de juillet à septembre 1951, le consacrent grand reporter international. Durant ces années, il fait équipe avec Judith Jasmin*, avec laquelle il entretient une liaison amoureuse. Même s’il n’a pas le physique de l’emploi, il passe alors pour le don Juan de Radio-Canada. Quelque chose d’attirant émane de lui. Il aime les femmes et celles-ci le lui rendent bien. En octobre 1951, Jasmin et lui sont assignés à la visite canadienne de la princesse Élisabeth et du prince Philippe, duc d’Édimbourg. À partir de janvier 1954, ils coaniment Carrefour, nouvelle émission de radio vouée exclusivement aux reportages. Mais, bientôt, la télévision qui s’anime le boude. Lévesque n’est pas un adonis. Petit de taille, il a le crâne dégarni, présente des tics et fume comme une locomotive. Pourtant, à l’automne de 1955, sa pimpante entrevue avec des écolières russes sur la place Rouge fracasse l’écran du téléjournal. C’est que Radio-Canada l’a assigné pour la radio mais aussi pour la télévision – une fois n’est pas coutume – à la couverture du voyage de Lester Bowles Pearson*, ministre canadien des Affaires extérieures et futur premier ministre du Canada, en Union soviétique. Quand l’intraitable Nikita Sergheïevitch Khrouchtchev malmène Pearson devant lui, l’envoyé spécial de Radio-Canada obtient sa première exclusivité internationale. En 1956, même si ses patrons de Radio-Canada doutent qu’il possède le physique de l’emploi, il finit par faire le saut à la télévision qui l’élève rapidement au rang de « dieu des ondes imagées », selon l’expression de Georges-Émile Lapalme, chef provincial du Parti libéral. À Point de mire, émission culte de la fin des années 1950, il met toute sa passion de pédagogue et de communicateur à expliquer les grands drames de la planète, comme la crise du canal de Suez ou la guerre d’Algérie. C’est à cette époque que ce séducteur-né noue des amours secrètes avec une jeune comédienne qui lui donne en 1958 une fille hors mariage, qu’il ne reconnaîtra jamais. Cette paternité extraconjugale incite Louise L’Heureux à entreprendre des procédures de divorce, qu’elle abandonnera cependant.
En décembre 1958, les réalisateurs de Radio-Canada se mettent en grève pour obtenir le droit de former un syndicat. Cette grève devient rapidement politique et annonce le bouleversement des années 1960. Cet événement auquel Lévesque se mêle de très près marque un tournant dans sa carrière. Il y entre journaliste, mais en sort politicien. Le conflit s’enlise durant plus de deux mois. Rien ne bouge. L’indifférence du gouvernement de John George Diefenbaker* et de ses collègues anglophones de la Canadian Broadcasting Corporation, qui boycottent la grève qu’ils considèrent comme une révolte contre le Canada, le sidère. Nombreux sont ceux qui diront que cette grève a joué un rôle de catalyseur dans l’évolution nationaliste de Lévesque. De plus, il s’adresse pour la première fois à la foule et mesure son emprise sur elle. Le conflit réglé, il paraît évident que la télévision est devenue trop petite pour lui. Jusqu’ici, il a posé les questions ; désormais, il voudra aussi donner les réponses.
Le 22 juin 1960, Lévesque plonge dans l’arène politique comme candidat dans la circonscription de Montréal-Laurier, où il sera élu de justesse. Courtisé par les libéraux depuis sa démission de Radio-Canada, en avril, il a fini par se rallier au C’est le temps que ça change ! de leur nouveau chef, Jean Lesage*, qui préfigure la Révolution tranquille. La solidité et le sérieux des réformes proposées par les libéraux – gratuité scolaire, assurance-hospitalisation, orientation économique, modernisation de l’État, guerre au favoritisme politique – l’ont convaincu. Il s’imposera vite comme ministre-vedette de la fameuse « équipe du tonnerre », qui entend faire entrer la province dans la modernité. Cette équipe, baptisée aussi par la presse les « trois L », réunit les trois principaux ténors du Parti libéral dont le nom de famille commence par « L » : Lesage, Lapalme et Lévesque. Le nouveau premier ministre, Lesage, confie d’abord deux ministères à Lévesque, celui des Travaux publics et celui des Ressources hydrauliques. Aux Travaux publics, convaincu qu’on peut faire de la politique et rester honnête, Lévesque s’attaque, à la demande de son chef qui en a fait l’une de ses priorités, à la corruption, plus précisément au système de « patronage » instauré par l’ancien gouvernement de Maurice Le Noblet Duplessis*. Désormais, tout contrat gouvernemental supérieur à 25 000 $ fera l’objet d’un appel d’offres.
En mars 1961, le ministère des Ressources hydrauliques, qui fusionne avec celui des Mines, devient le ministère des Richesses naturelles ; Lévesque demeurera à sa tête jusqu’en janvier 1966. Il laisse les Travaux publics à René Saint-Pierre. Politicien concret, Lévesque ne s’embarrasse pas d’idéologie. S’il mise avant tout sur l’État comme levier de développement économique, c’est parce que les Québécois francophones ne possèdent qu’une seule grande entreprise : leur gouvernement. Ils sont privés d’une véritable classe d’entrepreneurs capables de lutter contre le retard économique de la province dans certains secteurs. L’électricité, dont le Québec abonde, doit devenir un monopole public. Trop vite concédée aux capitalistes étrangers qui imposent des tarifs exorbitants et disparates, selon qu’on habite Montréal ou la Gaspésie, et qui exportent les profits à l’extérieur du Québec, l’électricité doit être confiée à la Commission hydroélectrique de Québec (ou Hydro-Québec), créée en 1944 par le gouvernement d’Adélard Godbout*, qui a nationalisé la Beauharnois Light, Heat and Power Company et la Montreal Light, Heat and Power Consolidated pour former l’embryon d’Hydro-Québec. Il suffit d’en intégrer l’exploitation, alors dispersée dans les 11 compagnies privées que le gouvernement entend étatiser, pour qu’elle devienne la locomotive de l’économie québécoise. En 1962, Lévesque soulève un tollé en prononçant pour la première fois le mot tabou de « nationalisation ». Il finit par l’imposer malgré le refus original de Lesage, inquiet des répercussions de l’étatisation sur la dette de la province.
Le premier ministre change en effet son fusil d’épaule. Le chantage des banquiers de Toronto et de Montréal, qui refusent non seulement de financer la nationalisation, mais menacent de boycotter les emprunts du gouvernement s’il étatise la Compagnie d’électricité Shawinigan, l’a ulcéré. L’argument de l’augmentation de la dette qui conduirait la province à la faillite, invoqué par les ministres opposés à la nationalisation, comme George Carlyle Marler, ne tient pas. Dans son rapport, Douglas Henderson Fullerton, expert financier indépendant consulté par Lesage, le rassure. Si les prêteurs canadiens ne veulent pas prendre part au financement de la nationalisation, les Américains se feront un plaisir de s’en charger, car la dette de la province est l’une des plus basses du pays. Lévesque obtient la même assurance du courtier Roland Giroux*, familier des milieux financiers américains. Après les élections, Lévesque le dépêchera à New York avec ses conseillers Michel Bélanger* et Jacques Parizeau* pour emprunter les sommes nécessaires au financement de la nationalisation. De leur côté, les compagnies d’électricité ont finalement baissé pavillon, limitant leurs actions à faire monter les enchères au sujet de la compensation financière que le gouvernement prévoit leur verser. Enfin, si Lesage met fin à sa valse-hésitation, c’est aussi pour réaffirmer son leadership mis à mal par son indécision. Quoi de mieux pour rebâtir l’unité qu’une élection-surprise gagnée d’avance, selon les chiffres du sondage d’opinion que le premier ministre a commandé en catimini ?
Le 14 novembre 1962, au cours d’une élection quasi référendaire et au cri de Maîtres chez nous, l’électorat dit oui à la nationalisation des compagnies privées d’électricité. Évalué au départ à 600 millions de dollars, son coût total atteindra 604 millions de dollars. L’emprunt fait à New York s’élèvera à 300 millions de dollars. La ferveur nationaliste des années 1960 a joué en faveur de Lévesque. Il devenait inconcevable que de grandes compagnies étrangères exploitent les ressources de la province pour ensuite expédier à l’extérieur la majorité de leurs profits. De plus, les avantages de la nationalisation ont fini par s’imposer. Il fallait en terminer avec le gaspillage causé par le chevauchement des lignes et l’anarchie dans les bassins, où les entreprises privées se marchaient sur les pieds, et avec une tarification inégale. L’État récupérera les impôts des compagnies, qui filent à Ottawa. L’économie québécoise verra aussi la création d’une batterie d’entreprises secondaires dans les régions. Enfin, Lévesque, dont le charisme et la force de persuasion n’étaient pas négligeables, a eu l’appui de la population et de la presse. Il a pu aussi compter sur le respect et l’admiration que lui voue encore Lesage.
Trois ans plus tard, le 15 octobre 1965, Lévesque dressera un premier bilan d’Hydro-Québec. Elle est devenue la première firme industrielle du Québec avec 17 000 employés et un actif de 2,5 milliards de dollars. Elle produit 34 % de l’énergie hydroélectrique du Canada. De plus, le « colosse », comme dit la presse, parle français, aussi bien sur les grands chantiers qu’à son siège social, où l’anglais était jusque-là roi et maître même si les employés étaient majoritairement francophones. L’hydroélectricité devient une pépinière pour les cadres et ingénieurs francophones, autrefois sous-estimés à la Compagnie d’électricité Shawinigan.
Lévesque découvre aussi que le secteur minier n’est que la « succursale » de multinationales étrangères qui expédient le minerai brut aux États-Unis, où usines et manufactures le transforment en produits finis. La province se satisfaisant de redevances parmi les plus basses du pays, les profits aussi filent à l’extérieur. Les cadres et le savoir-faire sont étrangers. Lévesque constate aussi qu’il manque une véritable politique de développement minier. Convaincu que l’État doit jouer un rôle dans l’exploitation et l’exploration du sous-sol québécois, il procède à une refonte en profondeur de la loi des mines, vieille de plus de 80 ans. Puis, en forçant la main de Lesage, soumis aux pressions des grandes entreprises, il créera en 1965, avec l’appui de son allié, le ministre Eric William Kierans*, la Société québécoise d’exploration minière, ou SOQUEM. Pour s’assurer que les concessions ne dormiront plus durant des années, les baux deviennent révocables après dix ans d’inactivité. Enfin, il double les droits miniers versés jusqu’alors par les compagnies minières.
Bien avant l’éveil des Premières Nations, Lévesque se passionnait déjà pour la question autochtone. La Gaspésie de son enfance, c’était aussi la patrie des Micmacs cantonnés dans leurs misérables réserves de Restigouche et de Maria (Gesgapegiag), tout à côté de New Carlisle. À l’été de 1954, chez les Inuits de la baie d’Ungava, accompagnant le prince Philippe, comme reporter de Carrefour, il a découvert leur tiers-monde, non sans éprouver un malaise. En 1961, lors d’un voyage au Nouveau-Québec, qui relève de son ministère des Richesses naturelles, il a redécouvert l’univers quasi carcéral dans lequel vivent Amérindiens et Inuits. Et il s’est désolé de l’absence du français sous la latitude nordique québécoise. Dans les écoles fédérales, ni le français ni l’inuktitut n’ont droit de cité. Ce vaste territoire a été concédé au Québec en 1912, mais les gouvernements québécois précédents ont laissé Ottawa s’y installer avec ses écoles, ses dispensaires et ses fonctionnaires qui anglicisent les autochtones.
Résolu à rapatrier l’autorité sur le Nouveau-Québec et ses habitants, Lévesque se heurte au refus du ministre fédéral du Nord canadien et des Ressources nationales, Arthur Laing, qui freine le transfert en affirmant que les Inuits ne veulent pas parler français. À la fin de mai 1964, à Winnipeg, Laing soutient qu’Ottawa doit se réserver les domaines de l’éducation, de la santé et du bien-être « afin, selon l’édition du 30 mai du quotidien montréalais le Devoir, de préserver les droits des Esquimaux comme citoyens de première classe ». Furieux, Lévesque lui réplique que ses craintes « s’inspirent de considérations politiques et d’hypocrisie ». Laing déclare aux Communes qu’il doute de la sincérité de Lévesque qui lui rappelle que le Québec est la seule province du Canada qui, depuis la Confédération, donne l’exemple du respect des droits linguistiques et religieux de la minorité. Quant à elle, la presse de Toronto prête à Lévesque des « ambitions territoriales », selon le titre d’un article de Blair Fraser* paru le 16 mai 1964 dans le magazine Maclean’s, voire des visées séparatistes. Pourtant, il s’agit d’un territoire qui appartient au Québec et la population inuite, n’étant pas considérée comme « indienne » par le fédéral, échappe à la Loi concernant les Indiens. Pire encore aux yeux de Lévesque : la province voisine de Terre-Neuve administre ses Inuits depuis son entrée dans la Confédération. Cette politique de deux poids, deux mesures et les procès d’intention qu’on lui fait l’exaspèrent. Selon ce que rapporte Fraser, il avertit : « Cette question de l’Ungava est une affaire type pour la coopération fédérale-provinciale. Si on ne peut même pas régler ça, on ne peut rien régler. » Le bon sens finira par triompher grâce à l’implication directe des premiers ministres Pearson et Lesage. Pendant qu’il était ministre fédéral du Nord canadien et des Ressources nationales, entre 1953 et 1957, ce dernier ne s’était pas préoccupé de la question. Mais il soutient alors à fond la revendication de Lévesque. Tout en pondérant à l’occasion l’agressivité de son ministre, il n’en invite pas moins le premier ministre Pearson à mettre Laing au pas et exige, à la conférence fédérale-provinciale de novembre 1963, que le transfert de compétence se fasse avant le 1er avril 1964.
Quelques années plus tard, le Nouveau-Québec des années 1960, avec ses cabanes insalubres sans électricité ni chauffage, qu’a connu Lévesque, deviendra méconnaissable. L’électricité et les habitations chauffées seront devenues la règle. Mais plus encore, la ville de Kuujjuaq disposera aussi d’un hôpital, d’une école polyvalente, d’un aréna et d’un centre administratif. Lévesque n’est pas étranger à ce bilan. En plaçant le Nord sous sa protection, il a suscité innovation et concurrence intergouvernementales dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’économie.
En octobre 1965, remaniement-surprise. Le pendule de la réforme libérale passe de l’économie aux politiques sociales. Lévesque quitte les Richesses naturelles pour le ministère de la Famille et du Bien-être social. Le monde des démunis, il connaît. À son bureau de circonscription, le samedi matin, la salle est bondée de petites gens qui demandent à voir « René ». Lévesque possède l’humilité naturelle du petit peuple. Son objectif premier consiste à faire adopter une loi unique de l’assistance sociale, dont le pivot serait la famille. Il s’attaque au problème de l’adoption qu’il veut humaniser, fait approuver l’assistance médicale gratuite aux indigents, augmente les allocations aux mères célibataires, fait préparer un livre blanc sur l’enfance exceptionnelle. En janvier 1966, à la conférence d’Ottawa, persuadé que la sécurité sociale devrait émaner du gouvernement provincial, il réclame, mais sans l’obtenir, le rapatriement des allocations familiales. À la faveur de ce dernier bras de fer avec Ottawa et de celui qui l’a opposé plus tôt à Laing, Lévesque prend la mesure du fédéralisme canadien qui lui semble se durcir vis-à-vis des exigences québécoises depuis l’arrivée de Pierre Elliott Trudeau* à Ottawa après les élections de novembre 1965. En février 1969, il admettra dans une entrevue avec Jacques Guay, du Magazine Maclean de Montréal : « Moi, je ne croyais déjà plus en la possibilité qu’un État fédéral accepte de s’amputer. À force de voir se multiplier les dossiers et les conflits avec Ottawa je devenais, sans oser me l’avouer, de plus en plus souverainiste. »
Le 5 juin 1966, la défaite électorale de son parti annonce la fin de la carrière politique libérale de Lévesque. Privé du pouvoir, il a l’impression de faire face au vide et ne sait trop quoi faire de son avenir. Seule certitude immédiate : il remplira son mandat de quatre ans de simple député. Pour après, il s’interroge : peut-être retournera-t-il au journalisme, mais rien n’est moins sûr. Lévesque repense ses appartenances politiques dans un Québec gagné par la fièvre de la contestation qui balaie l’Occident. Les pacifistes dénoncent la guerre du Viêtnam, les étudiants occupent les campus, les indépendantistes scandent le Québec aux Québécois, les unionistes réclament Égalité ou Indépendance, comme l’a écrit leur chef Daniel Johnson* – devenu depuis premier ministre – dans son manifeste paru à Montréal en 1965. En juillet 1967, le président de la France, Charles de Gaulle, lance du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal son célèbre « Vive le Québec libre ! » Il y a aussi le Front de libération du Québec (FLQ) qui fait sauter ses bombes.
Naguère, quand on demandait à Lévesque s’il était nationaliste, il hésitait, hanté encore par ses souvenirs de guerre. Même s’il l’est à sa manière, la question le rendra toujours mal à l’aise. En 1948, il a écrit dans le magazine du personnel du service international de Radio-Canada : « Je suis à toutes fins pratiques un nationaliste québécois, un parfait Laurentien. » En fait, c’est le nationalisme canadien-français traditionnel avec ses « trucs du genre refrancisation, chèques bilingues, le drapeau », comme il le dira en 1969 au Magazine Maclean, qui le laisse froid. Lévesque, qui émaille ses propos d’exemples tangibles qui suscitent la confiance, fait preuve d’un nationalisme concret. S’il évoque le barrage de la Manicouagan, c’est pour suggérer aux Québécois francophones qu’ils sont capables de grandes choses. Il ne sera jamais un porteur de drapeau, craignant la politique de la rue, son émotivité et ses brutalités toujours possibles. Voilà pourquoi il a constamment eu maille à partir avec le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), dont l’action directe, la violence verbale et le discours pollué par le chauvinisme lui répugnaient. Néanmoins, aux élections de juin 1966, où le parti présentait des candidats, il a ressenti un malaise. Comme Pierre Bourgault*, alors à la tête du RIN, a tempéré son discours et donné à son option un contenu à saveur sociale-démocrate, il a eu l’impression de combattre un parti frère.
Plus tôt, le 27 février, Lévesque a précisé que le nationalisme, tel qu’il tentait de le vivre, visait à abolir les privilèges et non les droits de la minorité anglophone. Dans ses mémoires, il confirme : « Je suis nationaliste […] si cela veut dire être pour soi, férocement pour soi – ou contre quelque chose, contre une situation de fait. Mais jamais contre quelqu’un. » Cette « situation », il la voit plus clairement après six années de luttes politiques. La Révolution tranquille n’était qu’une amorce. Le Québec doit aller plus loin pour se libérer du joug économique subi depuis trop longtemps et d’un régime fédéral qui s’est raidi après les premières années de la décennie, caractérisées par une volonté plus manifeste d’Ottawa de coopérer avec les provinces. L’accélération du nationalisme québécois des années 1960 marque Lévesque. Même si l’on ne peut vraiment parler de conversion, il jette à droite et à gauche, plus particulièrement à compter de 1963, des phrases incendiaires qui témoignent de sa radicalisation. Fin mai 1963, de passage à Toronto, il avoue à l’animateur de télévision Pierre Berton* qu’il ne pleurerait pas longtemps si le Québec se séparait. Le 5 mai 1964, le Devoir rapporte ainsi son passage à Timmins, en Ontario : « Lévesque : mieux vaut la séparation que la querelle continuelle. » Le 9, devant les étudiants du collège Sainte-Marie, à Montréal, il affirme que le seul statut qui convienne au Québec est celui d’un État associé, statut qu’il faudra négocier avec le reste du Canada « sans fusils et sans dynamite autant que possible… Si on refuse ce statut au Québec, nous devrons faire la séparation », écrit le Devoir deux jours plus tard. Selon le Montreal Star du 20 février 1967, il avertit ses auditeurs de l’ouest du pays : « Ou le Québec obtient une nouvelle entente [avec le reste du Canada], ou il finira par se séparer. »
Durant l’été de 1967, après avoir tout bien pesé, Lévesque conclut que le pays est devenu une « maison de fous » et que l’avenir se trouve ailleurs que dans ce Canada fédéral, qu’il rejette, et dont Trudeau s’est fait le champion depuis son élection au fédéral en 1965. « Nous sommes des Québécois », tranche-t-il dans le manifeste qu’il livre en primeur à ses militants de la circonscription de Laurier, le 18 septembre 1967, et dont une version retouchée sera publiée à Montréal l’année suivante. Le titre, Option Québec, en résume l’idée fondamentale. À 45 ans, il choisit de lutter désormais pour une patrie québécoise. Ce faisant, Lévesque se pose en frère ennemi de Trudeau, son allié des années 1950, tandis qu’ils constituaient avec quelques autres l’opposition informelle au gouvernement Duplessis. Aux premières proclamations de la Révolution tranquille, ils étaient d’accord sur un tas de choses : rôle accru de l’État en éducation, dans l’économie et en matière sociale, modernisation du Québec et démocratisation de la vie politique. Mais le conflit de personnalités n’était jamais loin. La nationalisation des compagnies privées d’électricité figurait parmi les sujets qui les opposaient. Leur complicité, jamais facile, a finalement été engloutie par la déferlante du nouveau nationalisme. Dans quelques mois à peine, en avril 1968, Trudeau deviendra premier ministre du Canada. Une lutte de titans s’engage entre deux leaders forts qui ont chacun une vision irréconciliable de l’avenir de leur province.
En octobre 1967, le congrès du Parti libéral du Québec s’ouvre dans un climat d’hostilité qui devient contagieux aussitôt que l’ancienne vedette du parti gagne son siège. Le vent a tourné. Lesage et Kierans, complice de Lévesque pendant les bonnes années de la réforme libérale, scellent son sort en menaçant de démissionner si les délégués valident ses idées. Lévesque n’en dépose pas moins sa résolution, « Un Québec souverain au sein d’une union économique canadienne », inspirée de son manifeste. Le Québec ne sera plus une province, mais un État souverain qui prélèvera ses impôts, fera ses lois, traitera en son nom et dans sa langue avec les autres nations, mais s’associera au Canada au plan économique. Incapable de convaincre ses frères d’armes libéraux, Lévesque retire sa résolution avant le vote à main levée qui aura lieu malgré tout après son départ. Il annonce qu’il s’efforcera de la faire valoir ailleurs. Puis, suivi d’une poignée de partisans, il quitte la salle. Dorénavant, le rebelle siégera comme député indépendant de Laurier tout en préparant la fondation de son propre parti.
Pour les uns, Lévesque fait maintenant figure de héros ; pour les autres, d’ennemi public numéro un. Formé de 400 sympathisants un mois après la démission de Lévesque, l’embryon du futur parti souverainiste en compte 2 000 en janvier 1968. Le 19 avril, à la création du Mouvement souveraineté-association (MSA), dont naîtra le Parti québécois (PQ), le nombre de membres s’élève à plus de 7 000. Dès la fondation du MSA, Lévesque évite au futur parti de dérailler dans la marginalisation politique. Il doit menacer de rentrer chez lui pour obtenir le respect des droits scolaires et linguistiques de la minorité anglophone, contestés par la faction « riniste » du mouvement. Lévesque mesure la fragilité de son leadership et distingue mieux les différents groupes, souvent opposés, qui forment sa nouvelle famille politique : anciens libéraux, séparatistes de Bourgault (qui sabordera le RIN), créditistes du Ralliement national, gauche syndicale à tendance socialiste et une multitude d’étudiants. La moitié des délégués a moins de 30 ans. Contrairement à la fondation du MSA, celle du PQ, le 11 octobre de la même année, se déroule dans la bonne entente. Le programme du PQ ressemblera à celui esquissé au printemps par les délégués du MSA : français seule langue officielle, respect des droits de la minorité, déclaration unilatérale d’indépendance, régime présidentiel, syndicalisme obligatoire, État interventionniste mais qui respectera la liberté d’entreprendre, intégrité du territoire, récupération du Labrador, retrait des alliances guerrières comme l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord.
Mais avant le paradis du pouvoir, c’est la traversée du désert. Entre 1966 et 1976, Lévesque vit plutôt chichement. Jusqu’à sa défaite personnelle aux élections d’avril 1970, il touche son salaire de député. À l’été, il quitte Louise L’Heureux pour s’installer avec Corinne Côté, enseignante originaire d’Alma. Pour vivre, Lévesque ne peut pas compter sur sa pension de député, qu’il remet à sa femme qui élève leurs trois enfants. Heureusement, il tire quelques revenus de sa plume de journaliste. Déjà, en septembre 1966, Dimanche-Matin, périodique de Montréal, lui a confié une chronique hebdomadaire qu’il abandonne en 1969, peu avant les élections de 1970. Après son échec dans Laurier, le Journal de Montréal fait à son tour appel à lui, moyennant une rétribution de 200 $ par semaine. Lévesque a toujours refusé de toucher un salaire à titre de chef du PQ. Mais en février 1976, après la fermeture du quotidien indépendantiste le Jour, de Montréal, qui le prive de son cachet de chroniqueur, le parti lui verse un salaire de 18 000 $ par année.
Le PQ a brigué les suffrages pour la première fois aux élections du 29 avril 1970, dominées par la peur du séparatisme agitée par le nouveau chef libéral, Robert Bourassa*, et l’intervention des libéraux fédéraux qui publient à Montréal, dans leur bulletin de liaison intitulé Quoi de neuf ?, une étude qui veut démontrer la rentabilité du fédéralisme pour les Québécois. Les chiffres sont cependant si fantaisistes que Bourassa et Trudeau la désavouent. La promesse de Bourassa de créer 100 000 emplois, thème porteur dans un Québec où le taux de chômage est élevé, pèse lourd aussi sur l’issue du scrutin. Battu dans la circonscription de Laurier, Lévesque ne réussit à faire élire que sept députés, même si son parti récolte 23,1 % des voix. La même année, la Crise d’octobre se révèle dévastatrice pour son option politique. Pour venir à bout du FLQ, qui a kidnappé le diplomate anglais James Richard Cross et le ministre provincial du Travail et de la Main-d’œuvre, ainsi que de l’Immigration, Pierre Laporte*, que l’on retrouvera assassiné le 17 octobre, Trudeau, sous la pression du gouvernement Bourassa, jongle avec l’idée de proclamer la Loi sur les mesures de guerre. Le 14 octobre 1970, en cheville avec Claude Ryan*, directeur du Devoir, Lévesque réunit des personnalités provenant de différents milieux sociaux, dont Louis Laberge*, président de la Fédération des travailleurs du Québec, Alfred Rouleau, futur président du mouvement Desjardins, et les sociologues Fernand Dumont* et Guy Rocher. L’objectif des 16 signataires d’une déclaration commune rédigée par Lévesque vise à inciter les gouvernements à renoncer à la manière forte et à négocier avec les kidnappeurs pour sauver la vie des otages. Leur appel n’est cependant pas entendu. Le 16 octobre, Ottawa proclame la Loi sur les mesures de guerre qui impose l’état de siège [V. Pierre Elliott Trudeau]. Le lendemain, une quarantaine de militants du PQ ont déjà été arrêtés. Aux yeux de Lévesque, il s’agit d’une mesure extrême et antidémocratique qui viole l’habeas corpus britannique vieux de plusieurs siècles. Associé au FLQ par ses adversaires, le PQ est saigné de 45 000 membres qui n’osent plus s’afficher « péquistes ».
Mis au ban de l’opinion publique, le PQ est victime de l’espionnage illégal de la Gendarmerie royale du Canada qui, pendant la nuit du 8 au 9 janvier 1973, vole par effraction la liste de ses adhérents dans le cadre de ce qui sera connu comme l’opération HAM, telle que le révéleront les rapports des enquêtes du juge David C. McDonald (1979–1981), à Ottawa, et du commissaire Jean F. Keable (1981), à Québec. Lévesque accusera le gouvernement Trudeau d’avoir voulu profiter des excès du terrorisme felquiste pour porter un coup fatal à son parti.
Le handicap électoral de Lévesque reste toujours le même : la souveraineté fait peur. Passé au PQ en mai 1972, Claude Morin, ex-sous-ministre des Affaires fédérales-provinciales et des Affaires intergouvernementales dans les gouvernements de Lesage, Johnson, Jean-Jacques Bertrand* et Bourassa, le convainc de tenir un référendum avant toute proclamation d’indépendance. Mais le premier ministre Bourassa précipite les élections avant qu’il n’ait le temps de faire accepter l’idée par les fidèles de l’économiste Parizeau, partisans d’une indépendance sans référendum ni association obligatoire avec le reste du Canada. Le 29 octobre 1973, c’est le raz-de-marée libéral. Battu personnellement une deuxième fois, Lévesque, candidat dans la circonscription de Dorion, perd l’un des sept députés élus trois ans plus tôt. Tout n’est pas noir cependant. Le vote souverainiste passe de 23,1 à 30,2 % et atteint près de 40 % chez les francophones. De plus, le PQ devient l’opposition officielle, que dirigera une recrue de poids, le constitutionnaliste Jacques-Yvan Morin. Le Parti libéral fait élire 102 députés grâce à un mode de scrutin peu démocratique qui attribue 5,5 % des sièges au parti qui a obtenu 30,2 % du vote.
Lévesque se demande s’il est encore l’homme de la situation. Il a envie de rentrer dans ses terres et de faire autre chose de sa vie. À Québec, ses six députés sont laissés à eux-mêmes. Bientôt, son manque d’intérêt vis-à-vis du parti suscite la grogne. À l’approche du congrès de novembre 1974, à la demande pressante de son entourage, il accepte de rester à son poste, mais à ses conditions. Il est déterminé à mater ceux qui grignotent son autorité à la faveur du débat sur l’obligation de tenir un référendum avant toute proclamation d’indépendance. Au congrès, passé à l’histoire comme celui de l’étapisme, idée attribuée à Claude Morin, il fait inscrire le mot « référendum » dans le progamme. Début septembre 1976, il brise la rébellion des députés Robert Burns et Claude Charron qui remettent son leadership en question.
La paix revenue, Lévesque aborde avec confiance et sérénité la campagne électorale de l’automne de 1976. Il a eu 54 ans le 24 août précédent. Il paraît plus décontracté, moins agressif. Sa vie amoureuse s’est stabilisée depuis qu’il vit avec Corinne Côté. Pour un parti indépendantiste, jamais les probabilités d’accéder au pouvoir n’ont été aussi élevées. Lévesque s’attend à prendre un minimum de 35 sièges et, si la chance le sert, à former un gouvernement minoritaire. La proposition d’un référendum conditionnel à l’attitude fédérale, adoptée au congrès de 1974, fait place à un engagement électoral plus clair : il y aura référendum avant la fin du premier mandat.
Lévesque fait face à un gouvernement usé par six années au pouvoir et discrédité par le favoritisme, l’ingérence politique et les conflits d’intérêts à la Société des alcools du Québec et à la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec (révélés par la commission d’enquête sur le crime organisé), sans compter les accusations de népotisme portées contre Bourassa. D’autre part, ce dernier se leurre en croyant remporter le match sur le dos d’Ottawa. Au printemps, venu solliciter son appui à son projet de rapatriement de la constitution de 1867, Trudeau a menacé de procéder unilatéralement à la suite du refus de Bourassa, à qui il fournit ainsi le prétexte pour précipiter les élections. Enfin, la fragilité du gouvernement libéral est également redevable à la Loi sur la langue officielle (aussi appelée loi 22) qui a notamment proclamé le français langue officielle du Québec, mais déchiré l’électorat anglophone traditionnellement acquis aux libéraux. Mais ce n’est pas tant la proclamation du français langue officielle qui a ulcéré les anglophones que les tests linguistiques imposés aux enfants désireux de s’inscrire à l’école anglaise, car ils craignent qu’ils écartent de leurs écoles immigrants et francophones. Lévesque y voit quant à lui une mesure arbitraire et odieuse qui ouvre la porte à la discrimination entre les différents groupes ethniques. Surtout, la loi 22 ne s’attaque pas avec réalisme à la francisation des immigrants.
Le 15 novembre, le PQ passe de 6 à 71 députés, et le Parti libéral, de 97 à 26. Pour Claude Morin et certains analystes, Lévesque doit avant tout sa victoire à la mise en retrait de la souveraineté durant la campagne et à sa promesse de tenir un référendum. N’empêche que sa volonté d’instaurer la transparence politique et un bon gouvernement, selon l’expression consacrée, a convaincu aussi une majorité d’électeurs. Lévesque a réussi le tour de force de non seulement rassembler sa base électorale habituelle – syndiqués, étudiants, enseignants, intellectuels, jeunes – mais de faire une percée dans des milieux jusque-là réfractaires à son message comme les petits commerçants, les maires des villages et petites villes, les femmes, les personnes âgées, les agriculteurs et, même, les militaires. Contrairement aux anglophones qui ont ressuscité la moribonde Union nationale plutôt que de reporter leurs voix sur le PQ, les immigrants se sont montrés beaucoup plus réceptifs. L’histoire bascule. Pour la première fois, un parti qui se propose de faire éclater la Confédération formera le gouvernement du Québec. Le premier ministre fédéral, Trudeau, avertit le vainqueur, félicité du bout des lèvres, qu’il ne négociera jamais la partition du Canada.
Lévesque détiendra le pouvoir durant deux mandats : 1976–1981 et 1981–1985. Pour le seconder, il fait appel à une équipe de 18 ministres, dont 5 ont la responsabilité de 2 ministères, pour un total de 23 ministères. Certains présentent des curriculum vitæ impressionnants et sont diplômés de grandes écoles : Jacques Parizeau (London School of Economics and Political Science), Jacques-Yvan Morin (Harvard University et University of Cambridge), Claude Morin (Columbia University), Yves Bérubé (Massachusetts Institute of Technology), Bernard Landry (Institut d’études politiques de Paris). D’autres, comme l’animatrice Lise Payette, apportent ce qui fait parfois défaut à ceux qui brillent par leur éducation et leur expérience : vedettariat, brio et charisme. Lévesque aura besoin de toutes ces compétences pour redresser aussi bien la gestion financière de l’État que l’économie. Les services publics coûtent plus cher au Québec que partout ailleurs au Canada. Une famille québécoise de quatre membres paie 1 000 $ de plus en taxes et impôts qu’une famille comparable d’une autre province. La croissance économique pour l’année sera inférieure à celle du pays, tandis que le chômage grimpera à 9,5 %. Ces sombres perspectives sont loin de paralyser le nouveau gouvernement qui, à peine élu, entame un vaste mouvement de réformes qui n’est pas sans évoquer celui des années 1960. Ces changements modifieront profondément la société québécoise. D’abord, Lévesque peut enfin réaliser son objectif de la transparence politique qu’il pousse le plus loin possible en interdisant les caisses électorales secrètes, auxquelles il substitue, en 1977, un régime de financement public des partis politiques. Victime d’un régime électoral qui crée une distorsion entre la force réelle d’un parti et sa représentation parlementaire, il amorce une réforme de la carte électorale, qui accorde jusqu’à six fois plus de poids au vote rural qu’urbain, et du mode de scrutin, qui crée lui aussi une distorsion entre le pourcentage des voix et le nombre de sièges, pour y introduire des éléments du vote proportionnel. Il ne pourra cependant mener à bien cette dernière réforme à cause de l’opposition rangée de ses députés. S’appuyant sur l’hostilité de la population à la représentation proportionnelle et insécurisés par la complexité du scrutin proportionnel, la majorité d’entre eux y voient aussi une source d’instabilité politique qui, par exemple, rendrait difficile l’adoption de projets de lois controversés. Le 23 juin 1978, Lévesque fera également voter la Loi sur la consultation populaire, qui régira l’exercice référendaire.
Durant la campagne électorale, Lévesque a promis de rendre la province de Québec aussi française que celle de l’Ontario était anglaise. À ses yeux, cependant, loi et langue se marient mal, comme il en a prévenu le premier ministre Bourassa quand celui-ci a sanctionné la Loi sur la langue officielle, en 1974. De plus, il dit ouvertement que cela l’humilie de devoir légiférer, car seul un peuple dominé et colonisé doit brandir la loi pour imposer sa langue. Mais le déclin du français, à Montréal surtout, l’anglicisation massive des immigrants, et le contexte démographique et linguistique nord-américain, qui place les Québécois francophones dans un rapport de un contre 40, menacent la survie du Québec français.
Dans l’esprit de Lévesque, il ne s’agit pas de raser la Loi sur la langue officielle pour accoucher d’une nouvelle Grande Charte de la langue destinée à l’édification des peuples. Il veut simplement la modifier pour redonner aux francophones la jouissance utile de leur langue au travail, dans l’affichage, le commerce, l’administration publique, et pour favoriser la francisation des immigrants. Mais, conseillé par les sociologues Rocher et Dumont, l’influent et persuasif Camille Laurin*, ministre d’État au Développement culturel, l’entraîne plus loin qu’il ne le voudrait. Sanctionnée et entrée en vigueur le 26 août 1977, la Charte de la langue française, communément appelée loi 101, proclame l’unilinguisme de la société québécoise, et exclut l’anglais du Parlement et des tribunaux, en violation de l’article 133 de la constitution canadienne qui y garantit l’usage des deux langues (disposition de la loi que cassera la Cour suprême du Canada en décembre 1979). De plus, la loi réserve l’école anglaise aux enfants dont les parents ont étudié en anglais au Québec (c’est la « clause Québec »), contrairement à la « clause Canada », favorisée par Lévesque, qui ouvrirait l’école anglaise aux enfants de tous les anglophones canadiens. Selon le docteur Laurin, la veille même du dépôt de son livre blanc au Parlement, le 1er avril 1977, le premier ministre lui a dit sans précautions au cours d’un tête-à-tête émotif : « Je ne peux pas dire que j’aime votre loi, docteur. Je dois la passer parce que nous ne sommes pas libres. Je ne peux pas empêcher les immigrants de venir chez nous, mais si je ne fais rien, ils vont s’angliciser et nous déposséder. Je n’ai pas le choix. Si on vivait dans un pays normal, docteur, on n’aurait pas besoin de votre loi. » S’il se rallie finalement à la clause Québec, c’est aussi parce qu’il mise sur l’adoption de la réciprocité qu’il a proposée aux provinces anglaises où existe une minorité française. Selon celle-ci, les anglophones d’une province qui accorderait à sa minorité un traitement scolaire équivalent à celui accordé par le Québec à sa minorité anglophone pourraient inscrire leurs enfants à l’école anglaise québécoise. Cette réciprocité, si elle était acceptée par les provinces anglaises, annulerait dans les faits la clause Québec. Lévesque ne peut, au cabinet, s’opposer à l’article du projet de loi sur la langue d’enseignement sans risquer d’être mis en minorité. Ce texte – qui deviendra la loi qui aura le plus d’effet sur le visage du Québec et la mentalité de ses habitants – jouit d’un appui solide dans l’opinion, chez les militants et les députés, et au conseil des ministres. C’est loin d’être le cas chez les anglophones, dont plus de 130 000 choisiront d’émigrer entre 1976 et 1981, surtout vers l’Ontario. De même, motivées par le déplacement de leurs activités financières vers l’ouest du pays, certaines grandes entreprises, comme la Sun Life Assurance Company of Canada (ou Compagnie canadienne d’assurance sur la vie, dite du Soleil), multinationale dont 80 % des affaires s’effectuent à l’extérieur de la province, s’installeront à Toronto en accusant la loi 101.
Pour faire oublier le championnat québécois du plus grand nombre d’accidents de la route, des plus faibles indemnisations et des primes d’assurance les plus coûteuses au Canada, et aussi pour corriger le fait qu’une voiture sur cinq roule sans assurance au Québec, Lévesque institue le régime public et obligatoire d’assurance-automobile prôné en 1974 dans le Rapport du comité d’étude sur l’assurance automobile, étude présidée par Jean-Louis Gauvin et commandée par le gouvernement Bourassa qui l’a par la suite écartée. Pleinement entrées en vigueur en mars 1978, la Loi constituant la Régie de l’assurance automobile du Québec et la Loi sur l’assurance automobile constituent une législation impopulaire. Complexe, le nouveau régime soumet le conducteur à une double assurance, l’une publique pour les dommages corporels sans égard à la responsabilité (ce qui, accusent certains ministres, déresponsabilisera les conducteurs), l’autre privée pour les dommages matériels (ce qui, croit-on, fera augmenter encore les coûts). De plus, la réforme suscite un tollé chez les avocats et les assureurs proches du parti qui se voient enlever le pain de la bouche. Soumis à la pression des avocats, fort bien représentés au cabinet, le gouvernement se divise. La législation ne franchit la ligne d’arrivée qu’avec l’appui décisif de Lévesque à la ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, Lise Payette.
Selon Lévesque et son ministre de l’Agriculture, Jean Garon, Ottawa avantage les grandes exploitations céréalières et bovines des provinces de l’Ouest en cantonnant le Québec dans la production laitière. Cette politique fait obstacle à la volonté de Lévesque de diversifier l’agriculture québécoise pour développer l’agroalimentaire et l’autosuffisance agricole. Par ailleurs, pour enrayer la spéculation, il fait sanctionner, le 22 décembre 1978, la Loi sur la protection du territoire agricole (qui a un effet rétroactif au 9 novembre précédent).
En matière économique, on assiste également à l’émergence de l’entrepreneurship québécois. Après avoir aboli, en 1978, la taxe de vente de 8 % sur les biens de consommation courante afin de favoriser les familles à faible revenu tout en aidant les secteurs fragiles de l’économie – textile, meuble, chaussure et vêtement –, le ministre des Finances, Parizeau, crée en 1979 le régime d’épargne-actions pour initier les Québécois au marché des actions tout en mettant à la disposition des petites et moyennes entreprises une réserve de capitaux locaux. Dans la même veine, le gouvernement met sur pied le Programme de stimulation de l’économie et de soutien de l’emploi (1977), adopte une politique d’achat préférentiel (1978), avant de publier en 1979 une stratégie de développement économique, Bâtir le Québec […].
En matière sociale, Lévesque fait adopter une kyrielle de mesures qui trahissent l’orientation sociale-démocrate de son gouvernement : médicaments gratuits aux personnes âgées (1977), Loi sur la protection de la jeunesse (1977), avortement thérapeutique (1977), Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (1978), Loi sur les services de garde à l’enfance (1979). Dans le domaine du travail, le gouvernement fait voter une loi antibriseurs de grève (1977), favorise la concertation patronale-syndicale en organisant le sommet économique de La Malbaie (1977) et sanctionne la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979). En matière culturelle, outre la Charte de la langue française et la création des maisons de la culture, la Loi constituant la Société québécoise de développement des industries culturelles est sanctionnée en 1978. Côté justice, le ministre Marc-André Bédard dépoussière et démocratise l’administration de la justice, met en place la Commission québécoise des libérations conditionnelles et institue le recours collectif (1978). Lévesque dote aussi la province d’une politique de la recherche scientifique (1980). Pour mettre fin à la mainmise américaine sur l’amiante québécois, dont la fibre brute file à l’étranger pour y être transformée, il dépose le projet de loi 121 qui autorise le gouvernement à nationaliser la société Asbestos Limitée (1978). Une longue guérilla judiciaire s’engage avec la compagnie américaine et durera jusqu’en 1982. Entre-temps, la fibre d’amiante sera déclarée cancérigène et l’industrie s’effondrera. Le beau rêve coûtera 435 millions de dollars aux contribuables.
En politique étrangère, Lévesque poursuit deux objectifs principaux. Dans la foulée des premiers ministres Lesage et Johnson, il vise à accroître au maximum la visibilité du Québec dans le monde en multipliant les contacts avec les autres pays, dont la sympathie lui sera utile si jamais les Québécois l’autorisent à former un nouveau pays. Le second pilier de sa politique extérieure repose sur sa volonté de traiter directement, en son nom et sans chaperon fédéral, avec les hauts dignitaires et chefs d’État étrangers. Cette politique l’oppose à Ottawa, jaloux de sa souveraineté internationale, et s’accompagne parfois de faux pas. En janvier 1977, à l’Economic Club of New York, où seul figure le fleurdelisé québécois à côté de la bannière étoilée, Lévesque tente de rassurer les 1 600 convives – des prêteurs et investisseurs américains pour la plupart – sur la sécurité de leurs investissements au Québec. Comme il consacre la presque totalité de son discours à établir un parallèle osé entre l’indépendance québécoise et celle des colonies américaines, 200 ans plus tôt, il fait un « bide retentissant », tel qu’il l’écrira dans ses mémoires. Échec qu’il répare, en novembre de la même année, lors d’une visite officielle aussi retentissante à Paris. Le président de la France, Valéry Giscard d’Estaing, et son premier ministre, Raymond Barre, l’accueillent avec tous les égards dus à un véritable chef d’État, et non comme un simple premier ministre de province, comme l’exigeait Ottawa. Mais, plus que l’épaisseur du tapis rouge, c’est la volonté de Lévesque de donner à la concertation franco-québécoise une dimension plus politique qui inquiète Ottawa. La création d’un sommet annuel des premiers ministres français et québécois vient confirmer les craintes canadiennes, d’autant plus que les premiers ministres de France et du Canada ne se rencontrent pas une fois l’an. De plus, placé sur le même pied que le premier ministre d’un pays souverain qui a autorité sur tout, Lévesque, simple chef provincial, pourra aborder des questions outrepassant la compétence québécoise. Ottawa n’aura de cesse de faire reculer Paris là-dessus. Aussi, en février 1979, pour atténuer l’impact du premier sommet franco-québécois, qui se déroule cette fois à Québec, le premier ministre canadien Trudeau réclame que Barre séjourne d’abord à Ottawa.
Cette visite est pour Lévesque l’occasion de préciser ses intentions à l’égard de Corinne Côté. Leur liaison est devenue publique lorsque Lévesque, accompagnée de Corinne, a écrasé par accident un clochard qui gisait dans la rue, dans la nuit du 5 au 6 février 1977. En septembre 1978, il a obtenu son divorce de Louise L’Heureux. La présence de la jeune femme aux côtés du premier ministre québécois, à l’occasion d’une réception en l’honneur de Barre et de son épouse, indispose le couple français. À Paris, la maîtresse ne figure pas au nombre des invités... Le pouvoir n’a pas changé Lévesque d’un iota : aussi rebelle qu’avant, il refuse parfois de se plier aux contraintes protocolaires de sa charge. Il fume toujours autant devant les caméras, porte des chemises à manches courtes et, en toutes circonstances, des souliers sport, ses éternels Wallabee qui font rire la presse. Il répare l’accroc en confiant à ses hôtes que Corinne Côté est sa fiancée et qu’il l’épousera en avril. Ce qui est bel et bien fait le 12 avril 1979 au cours d’une cérémonie intime.
En cette année préréférendaire, le plus important défi qui attend Lévesque est cependant de convaincre une majorité de Québécois de le suivre jusqu’à l’indépendance. C’est le combat de sa vie. Pendant la campagne électorale de 1976, il a promis de tenir un référendum avant la fin de son premier mandat. Le 1er novembre 1979, en dépit de sondages peu favorables, il dépose à l’Assemblée nationale le livre blanc sur la souveraineté-association, qui propose au reste du Canada une nouvelle entente entre deux peuples souverains politiquement, mais associés économiquement : la Nouvelle Entente Québec-Canada : proposition du gouvernement du Québec pour une entente d’égal à égal : la souveraineté-association. Le document souligne la soif d’autonomie du peuple québécois et l’impasse du régime fédéral, et propose de rapatrier tous les pouvoirs et impôts dans le cadre d’une nouvelle association entre deux États souverains de nature plus économique que politique. Plus soucieux de leurs conditions de travail, qu’ils sont à négocier, que de l’issue du référendum, les fonctionnaires provinciaux perturbent l’événement en chantant Ô Canada avant de fracasser des vitres et d’enfermer les journalistes dans la salle de presse. La situation se complique encore au conseil des ministres du 19 décembre 1979. L’adoption d’une question référendaire longuette et complexe divise les ministres. Celle-ci inclut la demande d’un mandat de négocier une nouvelle entente avec le reste du Canada, ainsi que l’idée d’un second référendum, adoptée au congrès de juin précédent (pour consulter la population sur les résultats des pourparlers avec le fédéral qui suivraient le premier référendum). Au début de la soirée, certains, comme Denis Lazure* et Lise Payette, rentrent chez eux convaincus que le premier ministre aurait ce qu’il voulait, même aux dépens de Parizeau. L’opposition du ministre des Finances à cette idée, selon lui bizarre, d’un second référendum s’essouffle à mesure que le temps passe. Lévesque doit user de toute son autorité pour le faire plier. Le lendemain, à l’Assemblée nationale, la lecture de la question par le premier ministre semble le troubler. Il quitte précipitamment l’enceinte, convaincu que le libellé définitif n’est pas celui adopté la veille. En réalité, Lévesque a oublié de l’informer des modifications mineures apportées après coup par les juristes. Naturellement méfiant, Parizeau a eu un doute sur le coup, mais révise sa position à tête reposée.
Lévesque a tout prévu, sauf le retour de son éternel rival politique, Trudeau. Battu par les conservateurs de Charles Joseph (Joe) Clark aux élections du 22 mai 1979, le chef libéral refait surface en décembre après le renversement du gouvernement conservateur. Le 18 février 1980, Trudeau est réélu, juste à temps pour le référendum. Le 20 juin précédent, Lévesque a tranché : le référendum aura lieu au printemps de 1980, décision qu’il a rendue publique le lendemain sans préciser la date exacte, celle du 20 mai 1980, qu’il divulguera le 15 avril à l’Assemblée nationale. Le 4 mars, les ténors du gouvernement engagent un débat parlementaire de 35 heures sur la question référendaire, qui prend fin le 20. Remporté haut la main par le gouvernement, l’affrontement procure une légère avance au camp du Oui. En effet, un sondage interne du parti accorde plus de 58 % des voix aux orateurs du PQ, contre seulement 12 % à ceux du camp du Non de Ryan. Ce sera bien la seule fois. Défavorisée par des sondages négatifs, une stratégie sans ligne directrice claire, une organisation bureaucratisée à l’excès et des militants démotivés, la campagne de Lévesque ne décolle pas. De plus, Lise Payette, ministre d’État à la Condition féminine, provoque la colère des femmes en comparant l’épouse de Ryan à une ménagère vivant dans l’ombre de son mari. Le mouvement contagieux des « Yvette » pour le Non coupe les ailes aux souverainistes, qui ont aussi fort à faire pour affronter la campagne du ministre fédéral de la Justice et procureur général du Canada, Jean Chrétien, que Lévesque juge illégale et immorale. Le ministre fédéral n’hésite pas à passer outre à la Loi sur la consultation populaire, qui, entre autres, limite les dépenses des deux camps, ni à faire accompagner les chèques fédéraux destinés aux Québécois de slogans favorables au camp fédéraliste. Le coup de grâce vient du premier ministre Trudeau qui, en quelques phrases et quelques promesses, brise le rêve de Lévesque. Ce dernier ayant trébuché plus tôt en insistant sur le « Elliott » de son patronyme, qui rappelle l’origine écossaise de sa mère (comme Trudeau a d’ailleurs lui-même trébuché aux élections de 1976 en évoquant la victoire « des frères de sang » pour départager les francophones qui ont voté pour le PQ et les anglophones et allophones ralliés aux libéraux), le chef fédéral ne manque pas de s’exclamer que son « nom est québécois ». Le 14 mai, peu avant le vote, il promet de démissionner si le fédéralisme n’est pas renouvelé à la satisfaction des Québécois. Ce faisant, il fournit aux indécis une raison pour voter non.
Le 20 mai, Lévesque subit la plus cuisante défaite de sa carrière politique. Les sondages ne lui laissaient aucune illusion, mais il a espéré obtenir une majorité chez les francophones. Il ne l’a pas et doit se contenter au total de 40,4 % des voix. Il conclut que les Québécois ne sont pas mûrs pour l’indépendance. Il a cependant du mal à comprendre qu’on puisse se dire non à soi-même. Il ne demandait pas un mandat de séparation, mais un mandat pour négocier un nouvel arrangement avec le Canada. Autour de lui, on lui reprochera d’avoir trop tardé à tenir le référendum, d’avoir laissé se relever l’adversaire doublement décapité par le départ de Bourassa et la chute de Trudeau. Pour l’ancien premier ministre Bourassa, ce référendum était la plus grave erreur politique de Lévesque, car il l’a tenu en sachant qu’il allait le perdre, ouvrant ainsi la voie à Trudeau, qui brûlait d’envie de rapatrier la constitution sans tenir compte des exigences québécoises. Pour Lévesque, le référendum a tout de même donné une légitimité juridique au droit du peuple québécois à s’autodéterminer. En participant à la consultation populaire, Ottawa a agréé, sur le plan international, l’idée que ce sont les Québécois qui doivent décider de leur avenir, non Ottawa, ni le Canada anglais. Affaibli politiquement et ramené à un mandat provincial, Lévesque met en veilleuse sa lutte pour une patrie québécoise. Il s’attelle au replâtrage du vieux document de 1867, faisant siennes les exigences de ses prédécesseurs : égalité entre francophones et anglophones, reconnaissance constitutionnelle de la différence québécoise, nouveau partage des pouvoirs entre Ottawa et les provinces.
La balle est dans le camp des fédéralistes, a lancé Lévesque le soir de sa défaite. Trudeau la saisit au vol et l’invite avec les autres chefs de province à négocier avec lui le nouveau fédéralisme. À la conférence constitutionnelle de septembre 1980, à Ottawa, le chef fédéral insiste pour rapatrier la constitution et y enchâsser une charte des droits et libertés avant de s’attaquer vraiment à la question proprement dite du nouveau partage des pouvoirs réclamés par la majorité des provinces. C’est l’impasse et, pour la dénouer, il menace de se passer de leur accord. Le 6 octobre, il dépose aux Communes une motion pour rapatrier unilatéralement la constitution, incluant notamment une formule d’amendement qui accorde à toutes les provinces le droit de s’opposer à une modification de la constitution qu’elles jugeraient inacceptable. Mais ce veto ne serait valable que pour deux ans après le rapatriement ; les provinces et Ottawa devraient alors s’entendre sur une nouvelle formule, à inventer. Le 12 novembre 1980, Lévesque dépose à l’Assemblée nationale sa propre motion contre le « coup de force » fédéral, qui exige l’unanimité pour être adoptée. L’opposition du chef libéral, Ryan, la fait avorter. Cela n’empêche pas Lévesque, durant l’hiver qui suit, de bâtir un front commun contre Ottawa réunissant huit provinces, exception faite des deux alliés déclarés du fédéral, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. C’est au beau milieu de ces négociations que, le 12 mars 1981, il en appelle au peuple. Son flair politique lui dit qu’inquiétés par les menaces de Trudeau, comme le laissent voir ses sondages internes, les Québécois vont l’élire, lui, plutôt que Ryan qui a commis l’erreur de s’associer aux fédéraux en bloquant l’adoption de sa motion contre le rapatriement unilatéral. Faut rester forts au Québec, proclame le slogan de sa campagne. Aussi axées sur les réalisations du « bon gouvernement », les élections du 13 avril 1981 prennent l’allure d’un plébiscite. Le PQ remporte les deux tiers des sièges. Le 16, les huit provinces s’entendent sur un projet de réforme constitutionnelle qu’elles comptent soumettre à Trudeau. Pour faciliter l’accord, Lévesque doit renoncer au traditionnel droit de veto québécois en faveur d’un droit de retrait avec compensation financière.
Le 28 septembre de la même année, la Cour suprême du Canada, qui a été appelée en avril à se prononcer sur la légalité du rapatriement unilatéral, donne en partie raison à Ottawa. Le rapatriement est légal, mais inconstitutionnel « au sens conventionnel ». Session d’urgence à Québec où Lévesque fait adopter, le 2 octobre, une motion de résistance à laquelle se rallie cette fois Ryan. Début novembre, à Ottawa, secondé par les ministres Allan Joseph MacEachen et Jean Chrétien, ainsi que par ses conseillers personnels, Trudeau accueille les chefs de province pour la conférence de la dernière chance. De son côté, Lévesque s’entoure de Claude Morin, maître d’œuvre de la stratégie québécoise, et des ministres Marc-André Bédard et Claude Charron. Pour certains, cette équipe est non gagnante ; elle aurait plutôt dû comprendre des ministres plus ferrés en matière constitutionnelle et de relations fédérales-provinciales, comme Jacques-Yvan Morin et Jacques Parizeau. Il ne reste plus que trois de la dizaine de sujets discutés aux rencontres constitutionnelles précédentes : rapatriement de la constitution, formule d’amendement et charte des droits. Les trois priorités de Trudeau. Brillamment manipulé par celui-ci, Lévesque tombe dans le piège d’une prétendue alliance Québec-Canada autour de l’idée d’un référendum pancanadien sur la constitution, dont ne veulent pas les provinces anglaises, qui se sentent trahies par Lévesque. Déjà fissuré par le jugement de la Cour suprême et le désir des chefs des provinces anglaises de s’entendre avec Ottawa, le front commun des provinces implose. Au dernier matin de la conférence, Lévesque se voit présenter le texte d’un accord négocié la veille par les ministres Chrétien (pour le fédéral), Roy John Romanow (de la Saskatchewan) et Roy McMurtry (de l’Ontario), qui l’ont auparavant fait approuver par les autres premiers ministres provinciaux. Lévesque se sent à son tour trahi par ses ex-alliés du front commun, dont les tractations nocturnes passeront à l’histoire comme la « nuit des longs couteaux ». Tout en se résignant à l’insertion d’une clause dérogatoire qui réduira la portée de la nouvelle constitution en matière de liberté d’expression, de religion et de langue, Trudeau réalise ses trois grands objectifs. Les francophones hors Québec auront droit à leurs écoles « lorsque le nombre de ces enfants le justifie », selon ce qui deviendra l’article 23 de la nouvelle constitution. Les anglophones des autres provinces auront accès aux écoles anglaises québécoises, en violation de la clause Québec de la loi 101, qui réserve ce droit aux seuls anglophones du Québec. Mais, contrairement à l’Ontario – dont la minorité francophone, pour être inférieure en nombre à la minorité anglophone québécoise, n’en est pas moins importante –, seul le Québec se voit imposer le bilinguisme officiel au Parlement et dans les cours de justice, conformément à l’article 133 de l’ancienne constitution, confirmé dans la nouvelle. Pour Lévesque, il s’agit d’une injustice qui lui fera dire que Trudeau a troqué la reconnaissance institutionnelle du bilinguisme officiel en Ontario contre l’appui de son premier ministre, William Grenville Davis, à son projet de rapatriement. Enfin, pas de reconnaissance du caractère distinct de la société québécoise, pas de droit de veto, mais un droit de retrait sans compensation financière.
Pour Lévesque, le désastre est total. Le nouveau texte constitutionnel réduit les pouvoirs du seul État français de la fédération sans son consentement. Il est si en deçà des exigences historiques du Québec, désormais soumis à la loi du plus fort, qu’il refuse de le signer. Cela signifie que la deuxième plus grande province du Canada ne reconnaît pas la loi fondamentale du pays, même si elle y est assujettie. Le 2 décembre 1981, jour où la Chambre des communes adopte la motion sur la nouvelle constitution, Lévesque fait mettre le fleurdelisé en berne au Parlement. Les deux Canada existaient bel et bien : Trudeau et Lévesque venaient d’en faire la démonstration.
Déjà miné par ses déboires référendaires, Lévesque a du mal à se réconcilier avec cette nouvelle défaite. Il déchante et perd pied au cours des trois dernières années de sa carrière politique où s’accumuleront les coups durs. À peine rentré du sommet d’Ottawa, il apprend que Morin, ministre des Affaires intergouvernementales et principal responsable de la négociation constitutionnelle, a reçu de l’argent de la Gendarmerie royale du Canada en échange d’informations sur le PQ. Ce secret, il l’emportera dans la tombe. Au début des années 1980 sévit une sévère récession économique qui propulse le chômage à des taux records et frappe de plein fouet son gouvernement, aux prises avec un trou budgétaire de 700 millions de dollars. Il exige des syndiqués du secteur public, dont l’emploi est garanti et la rémunération, supérieure au privé, de faire leur part et de renoncer à certains acquis. En juin 1982, devant le refus des syndiqués, Lévesque fait sanctionner la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, qui leur inflige des baisses salariales. C’est la guerre. En décembre de la même année, il promulgue la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public qui impose des coupes salariales rétroactives de 19,45 %. Une avalanche de grèves illégales paralyse la province. Une loi spéciale, la Loi assurant la reprise des services dans les collèges et les écoles du secteur public, y met fin en février 1983. C’est l’intérêt général qui le guide, mais, ce faisant, il s’attaque à sa base électorale même et déchire son parti.
À l’été de 1984, le chef conservateur fédéral, Martin Brian Mulroney, parle de réconciliation nationale et promet, s’il est élu, de ramener le Québec à la table constitutionnelle. Lévesque voit dans cette ouverture l’occasion rêvée de se débarrasser des libéraux fédéraux détestés et surtout de réparer, peut-être, son échec constitutionnel de novembre 1981. Depuis le référendum perdu, discuter de souveraineté n’a plus de sens pour lui, du moins pour un temps. Elle reste à l’horizon, mais ne sera pas l’enjeu des prochaines élections, prévues dans un an. Il est prêt à prendre le « beau risque » (expression empruntée au titre d’un roman de François Hertel) du fédéralisme à propos duquel il fait le commentaire suivant, en novembre 1984, dans Défis québécois, périodique du PQ publié à Montréal : « Il faut quand même noter qu’on n’est pas dans un goulag ! » Il accepte donc la main tendue par Mulroney, devenu premier ministre du Canada le 4 septembre précédent, et impose un moratoire sur la souveraineté qui fait éclater son gouvernement. En novembre 1984, deux des soldats de la première heure, les ministres les plus influents du cabinet, Parizeau et Laurin, démissionnent. Convaincus que leur chef a perdu la foi, cinq autres ministres – Gilbert Paquette, Denise Leblanc-Bantey, Jacques Léonard, Louise Harel et Denis Lazure – et deux députés – Pierre de Bellefeuille et Jérôme Proulx – en font autant.
Ces défections minent l’autorité de Lévesque et le font basculer dans des comportements erratiques. C’est la dépression. En janvier 1985, en pleine détresse psychologique, on doit l’hospitaliser contre son gré, au nom de la sécurité de l’État. L’homme est atteint. À 62 ans, usé, il paraît fini pour les plus jeunes de ses ministres et députés, qui passent tout le printemps à contester ouvertement son leadership. Lévesque s’accrochera au pouvoir jusqu’en juin. Le 20 mars, il profite de la session du printemps pour faire adopter à l’Assemblée nationale une motion sur la reconnaissance des droits des autochtones. Ce dossier lui tient à cœur depuis les années 1960 et, une fois premier ministre, il l’a gardé sous sa responsabilité. Six ans plus tôt, en décembre 1978, il a créé un précédent historique en convoquant à Québec une rencontre entre le gouvernement de la province et les chefs et les représentants de 40 bandes québécoises, dans le but d’amorcer un rapprochement entre Blancs et Amérindiens.
Les grandes lois du gouvernement Lévesque datent surtout du premier mandat. Parmi les plus importantes du second figurent le projet de loi 48 du ministre Garon, qui affirme la pleine souveraineté du Québec sur la gestion des pêches dans le golfe Saint-Laurent, et le projet de loi 37, qui définit un nouveau cadre de négociation dans le secteur public, afin d’éviter que la province ne frôle l’abîme chaque fois que les employés de l’État renouvellent leur convention de travail. Ces projets de loi sont respectivement adoptés en juin 1984 et juin 1985.
Le 20 juin 1985, 25 ans après ses débuts politiques dans le gouvernement de Lesage, Lévesque se résigne à écrire sa lettre de démission comme chef du PQ. Le même jour, il fait acheminer aux médias un banal communiqué annonçant sa démission comme premier ministre. Le 29 septembre, deux jours après la pénible fête d’adieu que lui réserve le parti, il abandonne sa circonscription de Taillon. Il n’est plus que simple citoyen. Son jeune successeur, Pierre Marc Johnson, n’aura une longue carrière ni comme premier ministre ni comme chef du PQ. Aux élections de décembre 1985, il subit la défaite aux mains de Bourassa. Deux ans plus tard, isolé au sein d’un parti qui obéit de plus en plus au clan Parizeau, il devra aussi rendre son tablier de chef. Deux courtes années de retraite donnent juste le temps à Lévesque de renouer avec le journalisme et de publier ses mémoires, dont le succès met du baume sur ses plaies. Le 1er novembre 1987, son cœur qu’il a toujours refusé de soigner subit un infarctus foudroyant. Il a 65 ans. Partout au Québec et même au Canada anglais, c’est unanime : un géant de la politique canadienne et québécoise vient de mourir. De Davis, ex-premier ministre de l’Ontario, qui s’est heurté à lui, à Edgar Peter Lougheed, ex-premier ministre de l’Alberta, qui l’admirait, tous reconnaissent que, par son action et sa contestation du fédéralisme, il a obligé le Canada anglais à voir d’un autre œil la place du Québec dans la fédération. Plus encore, relèvent certains historiens, il a contribué, avec son rival Trudeau, à redéfinir du tout au tout le paysage politique canadien. Mais, ironie de l’histoire, en ébranlant le Canada, il l’a renforcé, note Romanow, l’alter ego de Chrétien durant la funeste nuit des longs couteaux.
L’héritage de Lévesque est multiple et associé à plusieurs moments forts de l’histoire du Québec. Comme journaliste à Radio-Canada, il a contribué à intéresser la société québécoise aux grandes questions internationales, décloisonnant en quelque sorte sa sphère d’intérêt. Durant la Révolution tranquille, devenu homme politique, il a été l’un des moteurs du changement qui a permis au Québec de se moderniser et de s’ouvrir au monde. Il a intégré de nouveaux standards en politique la politique propre – non seulement comme ministre de Lesage, mais comme premier ministre. Il a décomplexé les Québécois francophones, leur a donné confiance en leurs capacités en nationalisant l’électricité et en bâtissant Hydro-Québec.
En fondant le PQ, Lévesque a créé un parti nouveau et original, démocratique à souhait, comme il en existait peu et qui suscitait l’étonnement à l’étranger. Ce faisant, il a introduit le souci de la démocratie dans la démarche indépendantiste, formulé une définition du nationalisme québécois moins chauvine, moins repliée sur elle-même, plus dynamique et belliqueuse aussi, et provoqué par ricochet une affirmation plus ouverte à la réalité québécoise et mieux articulée du nationalisme canadien. Par la loi 101, il a donné au français la place qui lui revenait au Québec, la première, tout en sauvegardant les droits scolaires de la minorité. Enfin, sur le plan de la théorie politique, il a mis au monde le concept de souveraineté-association qui s’est imposé peu à peu, apportant une forte crédibilité politique à l’idée de l’indépendance du Québec.
René Lévesque n’a pas réalisé son grand rêve de donner à ses compatriotes une nouvelle patrie. C’est sans doute l’échec le plus marquant de sa carrière politique. Il a perdu le référendum de mai 1980, s’est fait imposer une constitution et a cédé le traditionnel droit de veto, trois événements qui ont affaibli la position politique du Québec à l’intérieur de la Confédération canadienne. À sa mort, les Québécois étaient toujours Canadiens, mais la majorité francophone ne se percevait plus comme le petit peuple de la légende, replié sur lui-même et parlant une langue dépréciée et marginalisée. Par la parole et l’action, aussi bien comme journaliste que comme ministre libéral et premier ministre souverainiste, il a libéré les Québécois francophones de leur sentiment d’infériorité et leur a donné une piqûre d’adrénaline telle qu’un jour, a-t-il prédit au soir de sa défaite référendaire, ils tiendraient leur rendez-vous avec l’histoire. « Je n’ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d’être québécois que ce soir […] On n’est pas un petit peuple. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. » Ces phrases célèbres, qu’il a improvisées dans l’euphorie de sa victoire du 15 novembre 1976, éclairent son engagement politique, consacré tout entier à faire monter en haut tout ce qui parlait français en bas, comme le rappelaient ses proches. Mais, du même souffle, il a noté dans ses mémoires que les Québécois sont sans doute le seul peuple à avoir « refusé pareille chance d’acquérir paisiblement, démocratiquement, les pleins pouvoirs sur eux-mêmes ». L’épitaphe qu’a écrite pour lui le poète Félix Leclerc donne néanmoins un sens à son héritage, qui ne se mesure pas seulement en réformes et en lois : « La première page de la vraie belle histoire du Québec vient de se terminer… Dorénavant, il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. »
Parmi les écrits de René Lévesque, mis à part ceux que nous avons déjà cités, nous tenons à nommer les suivants : la Passion du Québec (Montréal, 1978) ; Oui (Montréal, 1980) ; Chroniques de René Lévesque (Montréal, 1987) ; René Lévesque par lui-même : 1963–1984, Renald Tremblay, édit. (Montréal, 1988).
La source principale de ce texte est la biographie de Lévesque que nous avons publiée chez Boréal : René Lévesque (4 vol., Montréal, 1994–2005). Il serait impossible d’énumérer les sources multiples que nous avons consultées, tant la documentation au sujet de Lévesque est abondante. Il serait également fastidieux de citer les noms de la centaine de personnes interviewées, dont le témoignage oral constitue, avec la documentation écrite et audiovisuelle, notre matériau principal. Le lecteur trouvera leur nom dans les références et les index de notre biographie en quatre volumes ; toutes les sources documentaires consultées (archives, journaux, périodiques, documents publics et audiovisuels, correspondances, rapports des commissions d’enquête, livres et autres) figurent dans les références de chacun des chapitres.
Il convient toutefois de signaler ici nos sources principales. Grâce à la permission spéciale d’une donatrice, Corinne Côté, seconde épouse de Lévesque, nous avons eu accès à : Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, P18. Ce fonds contient notamment divers documents publics, la correspondance de guerre de Lévesque, les lettres à sa famille et à sa mère, ses papiers personnels. Au bureau de Montréal de la Société Radio-Canada, le secteur de Gestion des doc. de la direction Médiathèque et Arch. conserve des photocopies du dossier d’employé de Lévesque, ainsi que les dossiers de productions d’émissions ; nous avons obtenu une autorisation particulière pour consulter cette documentation. À Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, nous avons consulté : le fonds Ministère du Conseil exécutif, qui porte la cote E5 au Centre d’arch. de Québec ; le fonds Jean Lesage, déposé sous la cote P688 au Centre d’arch. de Québec, pour les années 1960–1966, qui coïncident avec la carrière de Lévesque comme ministre libéral ; le fonds Pierre de Bellefeuille, ex-député de Deux-Montagnes et ex-adjoint du ministre des Affaires intergouvernementales et du ministre des Relations internationales, déposé au Centre d’arch. de Montréal sous la cote P253, pour les années 1978–1984. Nous tenons également à mentionner : Musée de la Gaspésie, Centre d’arch. de la Gaspésie (Gaspé, Québec), P69 (fonds Corporation du séminaire de Gaspé) ; Arch. de la ville de New Carlisle, Québec, conservées à l’hôtel de ville ; Hôtel du Parl., Centre de documentation du Parti québécois (Québec), où se trouvent notamment des textes sur la fondation du parti, sur les congrès, sur les conseils nationaux, sur les réunions des différentes instances, ainsi que les débats internes, les sondages et les documents électoraux ; Arch. d’Hydro-Québec (Montréal), où nous avons entre autres consulté des documents sur les débuts d’Hydro-Québec, sur son fonctionnement et son développement sous Duplessis et Johnson, sur la nationalisation de la Compagnie d’électricité Shawinigan et la croissance ultérieure d’Hydro-Québec ; la documentation du département d’État américain concernant le Québec et les États-Unis, mise à notre disposition par Jean-François Lisée qui l’a rassemblée à Washington.
Outre notre biographie de Lévesque, citons aussi celles de : François Aubin, René Lévesque tel quel (Montréal, 1973) ; Peter Desbarats, René Lévesque ou le projet inachevé, R.-G. Scully, trad. (Montréal, 1977) ; Michel Lévesque, René Lévesque (Montréal, 1991) ; Jean Provencher, René Lévesque : portrait d’un Québécois (Montréal, [1973]). Signalons aussi trois autres livres consacrés à Lévesque : Graham Fraser, le Parti québécois, Dominique Clift, trad. ([Montréal], 1984) ; René Lévesque : l’homme, la nation, la démocratie, Yves Bélanger et Michel Lévesque, édit. (Sillery [Québec], 1992) ; René Lévesque : textes et entrevues (1960–1987), Michel Lévesque, édit. (Sillery, 1991).
Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Québec, Index BMS, dist. judiciaire de Québec, Saint-Cœur-de-Marie, 3 mai 1947.— Instit. généal. Drouin, « Fonds Drouin numérisé », Saint-Étienne (New Carlisle), 10 sept. 1922 : www.imagesdrouinpepin.com (consulté le 6 août 2008).— La Presse (Montréal), 14 avril 1979.— Le Soleil (Québec), 2 nov. 1987.— Canada, Chambre des communes, Débats, 1960–1985 ; Commission d’enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, Rapport (3 vol., Ottawa, 1979–1981).— Dictionnaire des parlementaires du Québec, 1792-1992, Gaston Deschênes et al., compil. (Sainte-Foy [Québec], 1993).— J.-F. Duchaîne, Rapport sur les événements d’octobre 1970 (Québec, 1980) ; Rapport sur les événements d’octobre 1970 : passages retenus et annexes A, B, C et D (Québec, 1981).— Pierre Duchesne, Jacques Parizeau (3 vol., Montréal, 2001–2004), 3.— Québec, Assemblée législative, Débats, 1960–1968 ; Assemblée nationale, Débats, 1968–1985 ; Commission d’enquête sur des opérations policières en territoire québécois, Rapport (Québec, 1981) ; Commission d’enquête sur le crime organisé, CECO : rapport officiel : la lutte au crime organisé (Montréal, 1976).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Pierre Godin, « LÉVESQUE, RENÉ (baptisé Charles-René) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 21, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/levesque_rene_21F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/levesque_rene_21F.html |
| Auteur de l'article: | Pierre Godin |
| Titre de l'article: | LÉVESQUE, RENÉ (baptisé Charles-René) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 21 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2011 |
| Année de la révision: | 2011 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |