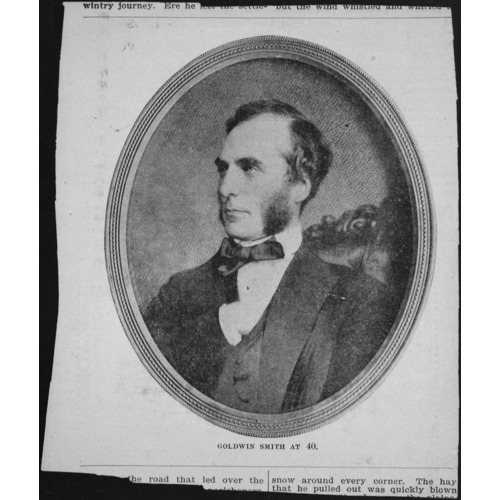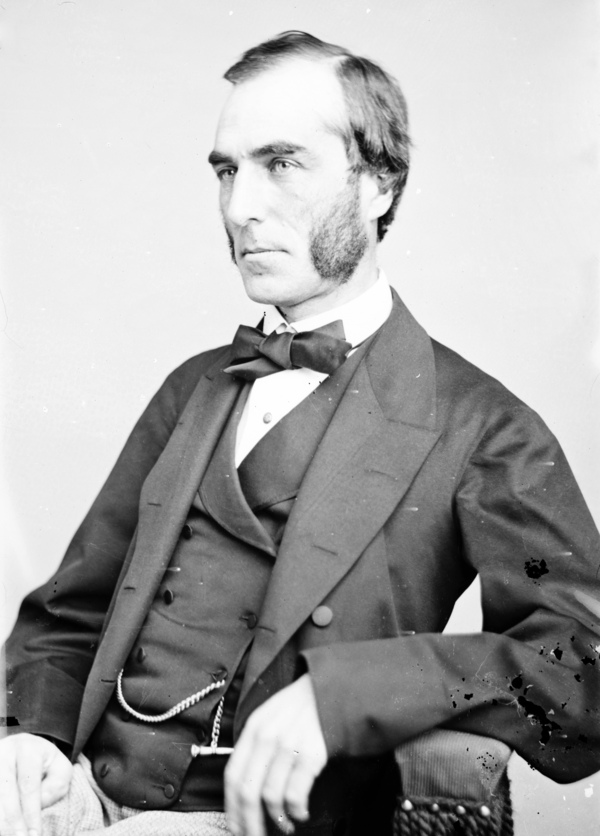
Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
SMITH, GOLDWIN, écrivain, journaliste et polémiste, né le 13 août 1823 à Reading, Angleterre, fils de Richard Pritchard Smith, médecin formé à Oxford ainsi qu’agent de développement et administrateur ferroviaire, et d’Elizabeth Breton ; de leurs sept enfants, il fut le seul qui parvint à l’âge adulte ; décédé le 7 juin 1910 à Toronto.
Après avoir fréquenté une école privée et l’Eton College, Goldwin Smith entra à Oxford, d’abord au Christ Church College en 1841, puis au Magdalen College en 1842. Récipiendaire d’une mention très bien en humanités, il obtint une licence ès arts en 1845 et une maîtrise ès arts en 1848. Il eut aussi une série de prix en études classiques, dont un pour une dissertation latine sur la condition des femmes dans la Grèce antique. Il traduisait et composait des vers latins, comme il allait le faire toute sa vie. Ses études devaient le préparer à devenir avocat ; en 1842, il s’était inscrit au Lincoln’s Inn. Il fut reçu au barreau en 1850, mais ne pratiqua jamais le droit.
Au temps où Smith était à Oxford, l’université était en proie à des controverses religieuses qui portaient principalement sur John Henry Newman et sur le mouvement d’Oxford, comme on l’appelait. Smith admirait le style de Newman, semble-t-il, mais les tendances ritualistes du mouvement et ses affinités avec le catholicisme le rebutaient. Certes, il appartenait à l’Église d’Angleterre (c’était obligatoire, à l’époque, pour étudier à Oxford), mais, peut-être en partie parce que sa mère était d’ascendance huguenote, il tendait vers le libéralisme religieux et manifestait des préventions contre le pouvoir du clergé. Les questions religieuses l’intéresseraient toujours ; cependant, il maîtrisait mal la théologie. Il n’était guère au fait non plus des débats scientifiques qui commençaient à se faire jour à Oxford en cette période prédarwinienne. Ce qu’il en savait, il l’avait probablement appris aux conférences de géologie de William Buckland, lequel soutenait, à la suite de William Paley, que l’ordre qui existait dans la nature prouvait l’existence de Dieu. Smith en viendrait à accepter une version de la théorie évolutionniste et à se rendre compte, comme il l’écrirait en 1883, que cette théorie avait « provoqué une grande révolution », mais il ne comprit jamais tout à fait l’hypothèse de Charles Darwin.
À la fin des années 1840, Smith habita Londres et voyagea en Europe avec des amis d’Oxford. À cause de l’actualité nationale et internationale, et sous l’influence de certaines grandes figures de l’époque, il penchait de plus en plus en faveur des réformes libérales – surtout celles visant à réduire les privilèges de l’Église d’Angleterre –, ce qui ne l’empêcha pas de se ranger bien vite du côté des autorités au moment des désordres chartistes de 1848. Oxford fut la cible de ses premières attaques réformistes. Fellow en droit civil au University College depuis 1846, Smith s’associa aux partisans d’une réduction de la tutelle du clergé sur l’université, notamment en écrivant en 1850 des lettres au Times de Londres. En partie sous l’effet de ces pressions, le gouvernement forma en 1850 une commission royale d’enquête sur l’université, dont Smith fut nommé secrétaire adjoint. La commission remit son rapport en 1852 ; deux ans plus tard, l’Oxford University Act vint assouplir, mais non abolir, les témoignages d’appartenance à l’Église d’Angleterre.
Pendant les années qu’il passa à la commission royale, Smith multiplia ses relations dans les cercles intellectuels et politiques. Il commença aussi à pratiquer le journalisme, qui allait être sa vocation. En 1850, il se mit à collaborer au Morning Chronicle et, en 1855, à la Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art. Il faisait de la critique de poésie dans ces deux périodiques londoniens et y prônait la réforme universitaire. Nommé en 1858 à une nouvelle commission royale qui, sous la présidence du duc de Newcastle, avait pour mandat d’étudier le système d’enseignement britannique, il rédigea une partie du rapport, qui parut en 1862. Entre-temps, en 1858, le gouvernement conservateur de lord Derby l’avait nommé professeur royal d’histoire moderne à Oxford. Cette fonction était si prestigieuse que Smith, âgé de 35 ans seulement, aurait fort bien pu se reposer sur ses lauriers. En 1861, il annonça qu’il avait l’intention d’abandonner la pratique du journalisme pour se consacrer tout entier à sa nouvelle profession d’historien. Manifestement, il projetait de composer une série de graves travaux d’érudition, mais les affaires contemporaines le passionnaient bien trop. Trait le plus frappant de ses écrits en histoire, Smith ne prenait pas assez ses distances par rapport à son sujet : il savait toujours de quel côté ranger les bons et les méchants. Pour lui, l’histoire n’était pas une quête austère et scientifique de l’exactitude et de l’objectivité. « L’histoire sans la philosophie morale, soutenait-il, n’est qu’une succession de faits ; la philosophie morale sans l’histoire risque de devenir fumeuse. »
Profitant du prestige de sa chaire, Smith n’hésitait pas à prendre parti dans les polémiques religieuses et politiques. À n’en pas douter, il était dévoué à ses étudiants et savait les stimuler, mais faire de la vraie recherche ne l’intéressait pas. Aucune de ses publications ne présente de valeur du point de vue de l’érudition. Dans les écrits en histoire et les biographies d’auteurs qu’il fit paraître par la suite, dont une histoire des États-Unis, une histoire du Royaume-Uni et des études sur William Cowper et Jane Austen, il ne fit guère qu’apprêter à sa manière, en y ajoutant ses principes et ses préjugés, ce que d’autres auteurs avaient écrit. Smith était un homme de lettres, non un chercheur. Il publia aussi des récits de voyage et des traductions d’auteurs latins et grecs. Son premier livre, paru en 1861, était typique. Des cinq conférences qui forment Lectures on modern history, trois parlent de controverses religieuses associées au rationalisme et à l’agnosticisme, une, de l’idée de progrès, et une seule, d’un sujet historique : la fondation des colonies américaines. Même s’il niait que l’histoire était une science, Smith ne se gênait pas pour déduire des lois morales de sa lecture du passé. D’abord, il voyait dans « les lois de la production et de la répartition des richesses [...] les plus belles et les plus merveilleuses lois naturelles de Dieu ». « Acheter au plus bas prix et vendre au plus haut, chose qui passe pour être la quintessence de l’égoïsme en matière économique, disait-il, c’est simplement obéir aux commandements du Créateur. » Ces lois, découvertes par Adam Smith, en qui il voyait un prophète, exprimaient un principe d’économie politique dont il ne dérogerait jamais : l’économie de marché, guidée par la « main invisible », avait la sanction divine et, si l’on en observait fidèlement les règles, elle mènerait à une société juste. Ensuite, Smith concluait, de sa lecture de l’histoire, que la religion était le ciment de l’ordre social. « La religion, lançait-il à ceux qui prétendaient que le progrès avait rendu le christianisme désuet, est le cœur même, le centre, le pilier de notre organisation sociale et politique. Sans la religion, le lien civil se relâcherait, les mobiles personnels déclasseraient complètement les mobiles collectifs, l’ambition mesquine et la cupidité se déchaîneraient, la société et le corps politique risqueraient de se dissoudre. »
Smith tirait de l’histoire une troisième leçon dont s’inspireraient toujours ses jugements sur la marche du monde : « l’émancipation des colonies » devait se réaliser le plus tôt possible parce que, sauf dans le cas de l’Inde et de l’Irlande, elle était inévitable. Il exposa cette thèse dans une série d’articles parus en 1862–1863 dans le Daily News de Londres, puis en 1863 dans un opuscule intitulé The empire. Il y présentait l’essentiel des opinions de ses amis John Bright, Richard Cobden et d’autres membres de l’« école de Manchester », selon qui la puissance économique de la Grande-Bretagne était telle, sous le libre-échange, qu’elle ne se trouverait pas réduite par le démantèlement de l’Empire en tant que structure politique. La leçon de la Révolution américaine – révolution en laquelle Smith voyait un désastre qui avait divisé le peuple anglo-saxon – était simplement qu’il fallait laisser les colonies se transformer naturellement en nations. Une fois les colonies libérées du joug de la dépendance, « l’affinité et l’affection mutuelle pourraient faire surgir spontanément quelque chose comme une grande fédération anglo-saxonne, en esprit sinon concrètement ». Condamné par le Times et rangé par Benjamin Disraeli parmi ces « poseurs et pédants » qui auraient mieux fait de laisser agir les hommes d’État, Smith ne démordit pourtant pas de ses convictions anti-impérialistes.
Smith quitta l’Angleterre en 1868 par suite d’un changement radical dans sa situation personnelle. Il avait quitté sa chaire d’Oxford en 1866 pour prendre soin de son père, qu’un accident de chemin de fer avait rendu infirme. À l’automne de 1867, Smith s’était absenté pendant une courte période, et son père s’était enlevé la vie. S’accusant sans doute d’avoir été la cause du drame, et privé de son poste à Oxford, il décida de partir pour l’Amérique du Nord, où il s’était déjà rendu en 1864. Andrew Dickson White, recteur de la Cornell University à Ithaca, dans l’État de New York, lui offrit un poste de professeur dans ce nouvel établissement. Le fondateur Ezra Cornell avait voulu créer une université non confessionnelle et ouverte à toutes les classes sociales, ce qui plaisait à Smith. Par contre, la décision que cette université serait mixte ne lui convenait pas. Il occupa un poste à temps plein à Cornell durant deux ans seulement, mais il conserva toujours des liens avec l’université, qui baptisa un édifice en son honneur en 1906. Soit à cause du climat, soit à cause de la présence des femmes, admises en 1869, il décida en 1871 de quitter l’université et de partir pour Toronto. Il avait de la parenté dans la région. Quatre ans plus tard, il adoptait cette ville pour de bon en s’y mariant. Le 3 septembre 1875, en effet, il épousait Harriet Elizabeth Mann, née Dixon, veuve de William Henry Boulton*. De deux ans sa cadette et Américaine d’origine, elle possédait une belle fortune, notamment un domaine appelé The Grange. Smith se coula avec délices dans sa nouvelle existence. The Grange était plus que confortable et, bien qu’il n’ait plus été de la première jeunesse, il était comblé par son mariage, « une union pour le mitan et le soir de la vie », disait-il à son ami l’Américain Charles Eliot Norton. Ce fut « l’événement le plus heureux de [son] existence [qui le] lia définitivement au Canada », nota-t-il après la mort de Harriet en 1909.
Ce mariage, revanche personnelle sur la tragique rupture de 1776, fut une grande réussite. Après avoir connu des années d’errance et n’avoir eu semble-t-il que des amitiés masculines, Smith avait enfin trouvé la compagne idéale. Harriet était une femme du monde, manifestement toute dévouée à son austère époux qui, contrairement à son premier mari, passait ses journées à lire, à écrire et à causer. Les amis et les visiteurs de Smith, des membres de l’élite intellectuelle du monde anglo-saxon, s’ajoutèrent aux célébrités et hommes politiques canadiens qui fréquentaient déjà le salon de The Grange. « On est soudain transporté dans une vieille maison anglaise entourée de verdure, avec d’anciens lits à colonnes, de vieux domestiques, tous anglais, et des hôtes anglais [...] un manoir anglais situé dans quelque comté d’Angleterre », a écrit Albert Venn Dicey. Smith vécut au Canada durant les 35 dernières années de sa vie. Pourtant, il ne devint jamais tout à fait Canadien. Son « manoir anglais » serait le refuge à partir duquel ce critique littéraire et politique, homme talentueux et virulent, adresserait ses doléances à un monde qui, à son grand dam, ne correspondait pas au credo libéral de l’école de Manchester.
S’installer au Canada, se marier, goûter à la paix d’un foyer n’émoussa nullement la vivacité intellectuelle de Smith ni son désir de rehausser la moralité publique. Au contraire. Il était d’autant plus porté à se dépenser que les débats publics, au pays, lui paraissaient sans substance et trop partisans. À peine était-il à Toronto qu’il commença à faire des recensions pour le Globe, mais il ne tarda pas à se quereller avec le propriétaire du journal, George Brown*, dont la droiture dogmatique ne pouvait souffrir de rival. Ensuite, Smith tenta à plusieurs reprises de fonder des organes de presse indépendants, cet épithète signifiant d’ordinaire : du même avis que lui. D’abord, il aida Graeme Mercer Adam* à lancer, à Toronto, la Canadian Monthly and National Review, dans laquelle il prit en février 1872 le nom de plume qui allait devenir sa signature la plus célèbre, « A Bystander ». En choisissant ce pseudonyme, Smith voulait se présenter comme un personnage de l’extérieur, un témoin qui regardait les choses avec détachement et les analysait. Or, les lecteurs constatèrent assez vite que, même s’il avait quelque chose de l’outsider, il avait ses partis pris, souvent féroces. Lorsque les tenants du mouvement Canada First lancèrent le Nation en 1874, Smith devint l’un des principaux collaborateurs et bailleurs de fonds de ce périodique torontois. Puis, en avril 1876, il prit part à une entreprise plus ambitieuse, la fondation d’un quotidien qui entendait concurrencer le Globe de Brown : l’Evening Telegram, dont l’éditeur était John Ross Robertson*. Cependant, Smith quitta bientôt ce journal, qui prenait une tangente conservatrice.
En juin 1878, Smith rentra à Toronto à la suite d’un séjour de 18 mois en Angleterre avec Harriet. Plus que jamais, il était convaincu que le pays avait besoin de ses lumières. Moins d’un an plus tard, il inaugurait sa propre tribune, le Bystander, qui portait en sous-titre la mention « Revue mensuelle sur l’actualité canadienne et générale ». Le spectacle qu’il offrit était stupéfiant. Durant trois ans, il remplit seul les pages du Bystander, commentant avec éclat et dogmatisme presque tous les événements de la vie politique, culturelle et intellectuelle de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Lui qui s’était promis de débarrasser les Canadiens de leurs œillères reconnaissait avec plaisir dès 1880 : « les grandes questions de philosophie religieuse commencent à intéresser bon nombre de Canadiens ». Il expliqua l’économie politique d’Adam Smith, dénonça le suffrage féminin, menace pour la famille, fit voir les dangers du darwinisme social de Herbert Spencer, pourfendit Bismarck, disserta sur la question de l’Orient, et s’en prit à Disraeli. Lorsque Sarah Bernhardt visita le Canada en 1881, il prit même la peine de marquer son accord avec Mgr Édouard-Charles Fabre* et le Presbyterian de Montréal, qui condamnaient la comédienne pour ses liaisons illicites. Soupçonneux, le Bystander accumulait les indices du pouvoir clérical au Québec et en Irlande ou les signes de la mainmise des juifs sur la presse européenne. Lorsque Smith décida de prendre un peu de répit, en juin 1881, c’était un intellectuel très écouté au Canada. De janvier à octobre 1883, au retour d’un autre long séjour en Angleterre, il publia une deuxième série du Bystander, cette fois au rythme d’un numéro tous les trois mois. La troisième et dernière série parut d’octobre 1889 à septembre 1890. Dans l’intervalle, il soutint un autre journal, le Week, qui commença à paraître en décembre 1883 et dont le rédacteur en chef était Charles George Douglas Roberts*. Le dernier épisode de sa carrière journalistique au Canada débuta en 1896. Il acquit des intérêts majoritaires dans le Canada Farmers’ Sun de Toronto, qui était en difficulté. Ce journal avait soutenu, sous la direction de George Weston Wrigley, des causes radicales, dont la révolte politique des Patrons of Industry. Le Bystander le remit promptement sur la voie de l’orthodoxie en prônant le libre-échange et la compression des dépenses publiques et en s’opposant à la participation du Canada à la guerre des Boers. En plus, Smith trouvait le temps de publier énormément dans la presse internationale, c’est-à-dire dans des organes comme la Fortnightly Review, la Contemporary Review et le Nineteenth Century, a Monthly Review de Londres, l’Atlantic Monthly de Boston, ainsi que le Sun, le Nation et le Forum de New York. En fait, il publiait dans tout quotidien ou mensuel qui acceptait ses articles, ses critiques et ses lettres. Sa production était phénoménale et son style, vif, souvent satirique.
Les activités de Smith ne se limitaient pas aux travaux intellectuels. En bon citoyen, il consacrait de l’énergie et donnait de l’argent à diverses causes. Les affaires municipales l’intéressaient particulièrement, car il était convaincu que les municipalités devaient s’occuper beaucoup plus du bien-être des citoyens que ne le faisait Toronto. Il présida un comité réformiste de citoyens, prôna l’instauration d’un conseil municipal formé de commissaires, lutta pour la préservation et l’agrandissement des parcs récréatifs destinés à la population, fit campagne pour que les tramways circulent le dimanche et combattit les bibliothèques de prêt gratuit. (« Une bibliothèque de romans, dit-il à Andrew Carnegie, est, pour les femmes, [un cadre] mental à peu près équivalent à ce qu’est un saloon, en tant que [cadre] physique, pour les hommes. ») Troublé par la pauvreté et le chômage urbains, il contribuait généreusement à des œuvres de bienfaisance telles l’Associated City Charities of Toronto, qu’il fonda, et la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il appuya aussi la construction d’une synagogue. Durant une vingtaine d’années, il réclama la nomination d’un fonctionnaire municipal qui superviserait l’octroi des subventions aux agences d’assistance sociale. Il eut gain de cause seulement en 1893 après avoir accepté de payer le salaire du fonctionnaire en question pendant les deux premières années. Ses gestes humanitaires s’inspiraient de la philosophie « noblesse oblige », selon laquelle le christianisme impose aux fortunés des devoirs envers leurs frères moins bien nantis. Smith craignait que l’échec de la charité chrétienne volontaire n’augmente la popularité de ceux qui préconisaient des programmes sociaux de tendance radicale. « Le souci de leur propre sécurité, donc, aussi bien que des considérations plus hautes, dicte aux élites naturelles de la société d’être fidèles au poste », déclara-t-il en mai 1889 à un congrès réunissant les œuvres de bienfaisance de Toronto.
Au Canada, Smith continua aussi à s’occuper de l’éducation. Élu en 1874 représentant des enseignants de l’Ontario au conseil de l’Instruction publique, il accéda par la suite à la présidence de l’Ontario Teachers’ Association. Mais, encore une fois, il s’intéressa surtout à la réforme universitaire et, comme en tant d’autres domaines, il prôna des changements qui révélaient ses liens avec Oxford. Presque dès son arrivée, il proposa que les universités de l’Ontario, disséminées sur le territoire, se fédèrent à la manière d’Oxford. Dans les années 1880 et 1890, il suivit les progrès vers une telle fédération, exerçant régulièrement des fonctions à la University of Toronto et défendant l’autonomie universitaire. En 1905, il accepta d’être membre, mais non président, d’une commission royale d’enquête sur la University of Toronto. Les travaux de cette commission débouchèrent notamment, en 1906, sur l’adoption d’une loi créant un conseil d’administration où il fut nommé. Parmi les nombreux diplômes honorifiques que Smith reçut des grandes universités du monde anglo-saxon, celui que lui conféra en 1902 la University of Toronto dut lui être particulièrement agréable. Mis en nomination pour un diplôme sept ans plus tôt, il avait retiré sa candidature parce que George Taylor Denison* et d’autres tenants de la fédération impériale protestaient avec virulence contre l’attribution de ce diplôme à un « traître ».
Smith s’intéressait donc à un vaste éventail de questions et avait des connaissances étendues, mais avant tout, il se souciait du monde contemporain. Sa réputation repose sur l’ensemble d’idées que, régulièrement, et avec une cohérence remarquable, il mit de l’avant en commentant les problèmes de son temps. Bien que, le plus souvent, on l’ait qualifié de « libéral victorien », ce ne sont pas ses principes libéraux qui constituent sa caractéristique la plus frappante, mais plutôt sa foi en la supériorité de la civilisation anglo-saxonne. Non seulement cette foi allait-elle souvent à l’encontre de son libéralisme, mais elle limitait sa capacité de comprendre et de regarder avec sympathie les aspirations du peuple parmi lequel il avait choisi de vivre.
Smith défendait l’économie de marché, prônait la sécularisation de la vie publique et s’opposait à l’Empire. C’est cela, surtout, qui faisait de lui un libéral. Bien qu’il ait cru fermement à l’individualisme et au parlementarisme, Smith ne manifestait aucun souci particulier pour les libertés civiles, sauf dans sa critique du cléricalisme, et il ne favorisait ni le suffrage universel, ni le vote des femmes. Il se méfiait de la démocratie et disait de la Révolution française (événement admiré par la plupart des libéraux) qu’elle avait été « le plus terrible de tous les événements de l’histoire ». Selon lui, l’inégalité faisait partie intégrante de la condition humaine. Même si, à maintes reprises, il professa de la sympathie pour les ouvriers et appuya les syndicats, il avait les grèves en horreur et qualifiait de « chimères » les réformes – impôt unique, inflation fiducuaire, propriété publique, réglementation des heures de travail – que les radicaux ouvriers commençaient à prôner à la fin du xixe siècle. Il croyait le progrès possible, mais disait : « on ne peut atteindre le millénium d’un seul bond ». Selon lui, un certain degré d’intervention gouvernementale dans l’économie pouvait parfois se justifier (il soutenait à contrecœur les arguments de sir John Alexander Macdonald* en faveur de la Politique nationale), mais le collectivisme et le socialisme étaient à rejeter. Il s’opposait à l’impôt sur le revenu, aux pensions de vieillesse et même au financement public de l’éducation. Dans son introduction à Essays on questions of the day, en 1893, il résuma sa philosophie sociale en confessant : « les opinions de l’auteur sont celles d’un libéral de la vieille école [qui] ne [s’est] point encore converti au socialisme étatique, qui attend le progrès non d’un accroissement du pouvoir gouvernemental, mais de ces mêmes agents moraux, intellectuels et économiques qui nous ont conduits aussi loin que nous sommes et dont l’un, la science, possède actuellement une force immensément plus grande qu’auparavant ». De toute évidence, ce n’était pas uniquement le « socialisme étatique » qui n’avait pas réussi à gagner l’adhésion du maître de The Grange. Le nouveau libéralisme social de Thomas Hill Green et de Leonard Trelawney Hobhouse était tout autant une hérésie pour lui. En fait, au soir de l’époque victorienne, on aurait pu raisonnablement appliquer à Smith l’un de ses propres adages, cette phrase adressée en 1884 par le Bystander à ses lecteurs : « Il n’est point de pire réactionnaire que le réformateur écrasé de lassitude. »
Si le passage du temps seulement avait usé jusqu’à la corde sa philosophie sociale, Smith pourrait encore être rangé parmi les libéraux importants, ne serait-ce que ceux de la « vieille école ». Mais son libéralisme paraît encore plus étroit si l’on examine aussi son nationalisme – sa foi en la supériorité des Anglo-Saxons. Smith partageait avec la plupart des penseurs politiques du xixe siècle, libéraux surtout, la conviction que les « nations » existaient en vertu d’« un décret de la nature » et qu’elles étaient « un lien naturel ». Comme John Stuart Mill, mais contrairement à lord Acton, il définissait la nation à l’aide du concept d’homogénéité culturelle. De plus, même s’il s’opposait à l’impérialisme, il ne se distinguait pas de ces impérialistes selon lesquels la collectivité culturelle anglo-saxonne, rayonnant dans le monde entier à partir de la Grande-Bretagne, formait une civilisation supérieure. Les institutions politiques, le système économique, la moralité et la culture de cette collectivité étaient autant de signes de la primauté de la civilisation anglo-saxonne dans un monde fait de nations diverses. Dans sa première critique de l’impéralisme, qui est restée la plus célèbre, il exposait sa conception du nationalisme, voisine de l’impérialisme culturel. « Je ne suis pas plus contre les colonies que je suis contre le système solaire, écrivait-il dans The empire. Je suis contre la dépendance dans les cas où les nations sont prêtes à l’indépendance. Si le Canada devenait une nation indépendante, il serait encore une colonie de l’Angleterre, et l’Angleterre serait encore sa mère patrie dans le plein sens que ces termes ont eu lorsqu’ils ont été appliqués aux plus illustres exemples de colonisation de l’histoire. Nous ser[i]ons de la même race qu’elle, nous parler[i]ons la même langue, nous aur[i]ons les mêmes lois et les mêmes libertés. »
Pour Smith, le grand échec, voire la grande tragédie de l’histoire anglo-saxonne avait été la Révolution américaine. « Avant [ce] déplorable schisme », disait-il, la Grande-Bretagne et les États-Unis « formaient un seul peuple ». Mettre un terme à cette rupture par « l’union morale, diplomatique et commerciale de la race anglo-saxonne où qu’elle [fût] dans le monde » devint l’objectif auquel il subordonna tout le reste. Smith partageait cet objectif avec les Canadiens qui prônaient la fédération impériale – Denison, George Monro Grant, George Robert Parkin* – mais, parce que la première étape qu’il préconisait était l’annexion du Canada aux États-Unis, il y avait affrontement constant entre lui et eux.
La foi de Smith en la supériorité des valeurs anglo-saxonnes se révèle de façon particulièrement frappante dans son attitude envers les « lignées inférieures sans loi ». D’après lui, seules les colonies à majorité anglaise méritaient la liberté. L’Inde, territoire conquis, n’était pas de celles-là ; en renonçant à ce qu’il appelait ce « splendide fléau », la Grande-Bretagne abdiquerait ses devoirs et livrerait le sous-continent à l’anarchie. Troublé par l’Inde, Smith se mettait en colère lorsqu’il était question de l’Irlande. Partout, il se méfiait du catholicisme ; en Irlande, il le méprisait. Les Irlandais, disait-il, étaient une « race aimable mais imprévoyante, sans disposition pour le commerce, dévote, dominée par les prêtres ». Il combattait l’autonomie politique de l’Irlande comme si sa propre vie avait été en jeu. « Autant donner au peuple irlandais des raquettes canadiennes que lui accorder une constitution comme celle du Canada », lançait-il d’un ton sarcastique. Lorsque son allié d’autrefois, William Ewart Gladstone, prit fait et cause pour les Irlandais, il le traita de « vieillard détestable ».
Smith n’avait guère plus de considération pour d’autres groupes non anglo-saxons. Bien que, à l’occasion, il ait exprimé de la sympathie pour « les lignées incultes de l’humanité » – les peuples d’Afrique, par exemple –, il ne voyait aucune raison de déplorer l’oppression subie par les autochtones d’Amérique du Nord. Les Britanniques n’étaient nullement responsables de leur mauvais sort, car ils les « avaient toujours traités avec humanité et justice ». Leur disparition « ne sera[it] pas une grande perte pour l’humanité », concluait-il impitoyablement.
Les juifs occupaient une place à part dans son catalogue d’« indésirables ». Le grand problème dans leur cas, d’après lui, était qu’ils refusaient obstinément de s’assimiler, d’abandonner leurs croyances religieuses et leurs coutumes, de devenir « civilisés ». Régulièrement, il les traitait de « tribaux », d’« usuriers », de « ploutopolitains », et les disait incapables de loyauté envers leur pays de résidence. Le Talmud, affirmait le Bystander, « est un code d’un légalisme casuistique [...] la plus vile, la plus aride, la plus minable de toutes les productions réactionnaires ». Si les juifs refusaient l’assimilation, il fallait les renvoyer dans leur pays d’origine. Dans une phrase qui suait l’arrogance raciste, il déclarait : « la déportation des nègres et la dispersion des juifs sont peut-être les deux pires calamités que l’humanité a connues ». Comme l’a montré Gerald Tulchinsky, un seul mot peut décrire l’ethnocentrisme extrême dont Smith faisait preuve dans ce cas : antisémitisme.
Cette foi en la supériorité des Anglo-Saxons et l’importance qu’il attribuait à la réunification de la « race » déterminaient ses interrogations et ses réponses à propos du « Canada et [de] la question canadienne ». À son arrivée à Toronto, il avait trouvé un mouvement nationaliste tout nouveau et encore peu actif. Il appuya ce groupe de jeunes gens dont William Alexander Foster* exposa le programme dans Canada First ; or, our new nationality : an address. Cet opuscule paru à Toronto en 1871 plaidait en faveur de la promotion d’un sentiment national, de l’éclaircissement du statut du Canada au sein de l’Empire et de la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes politiques. Smith croyait que le mouvement favoriserait l’indépendance du Canada, mais d’autres membres privilégiaient une forme quelconque d’égalité avec les autres parties de l’Empire. Pendant un temps, le mouvement eut la sympathie d’Edward Blake*, éminent intellectuel du Parti libéral, mais dès 1875 environ, il n’existait plus, et son organe de presse, le Nation, disparut en 1876. Manifestement, Smith conclut, au sortir de cette expérience éphémère, que le Canada ne pourrait jamais devenir une vraie nation et que sa destinée était de s’unir aux États-Unis. C’est ce qu’il expliqua en 1877 dans un article de la Fortnightly Review, puis du Canadian Monthly. Ces conclusions, qu’il reprendrait jusqu’à la fin de sa vie, trouvèrent leur expression la plus célèbre en 1891 dans Canada and the Canadian question. Le cœur de son argumentation était que le Canada ne pouvait pas être une nation parce qu’il n’était pas culturellement homogène. Le plus grand obstacle était la province de Québec, habitée par un « peuple réfractaire au progrès, religieux, soumis, poli et satisfait de son sort, malgré sa pauvreté ». Les Canadiens français, poursuivait-il, étaient « gouvernés par le prêtre, aidé à l’occasion du notaire [...] [Ils...] conserv[aient] le caractère national qui leur [était] propre. » La Confédération n’avait pas réussi à fondre en une seule collectivité les « races » et les régions rivales. Le Canada était un pays artificiel qui échappait à la désintégration uniquement à cause de la corruption politique, des faveurs dispensées aux régions et des groupes d’intérêts avantagés par le tarif protecteur. « L’esprit de clocher, écrivait Smith en 1878, règne encore en tout, qu’il s’agisse de la composition d’un cabinet ou de celle d’un club de tir. » D’après lui, les forces géographiques et économiques de l’Amérique du Nord (forces qu’il qualifiait de naturelles) allaient à l’encontre des opinions politiques et des sentiments (forces artificielles) des Canadiens. Comme les États-Unis, le Canada était une nation nord-américaine. Une fois ce fait admis, les deux collectivités uniraient leurs destinées. « Plus on observe la société dans le Nouveau Monde, disait-il, plus on acquiert la conviction que sa structure diffère essentiellement de celle de la société dans le Vieux Monde et que l’élément féodal a été éliminé complètement et définitivement. » La « nation canadienne étant une cause perdue », il était inéluctable que le Canada et son voisin du Sud concluent « une alliance honorable, d’égal à égal, comme l’Écosse et l’Angleterre ».
Au fil des ans, la conviction de Smith quant au destin du Canada se renforça. Plus il observait le Canada français, plus il lui devenait hostile. Il alla même jusqu’à proclamer en 1891 que l’un des principaux avantages de l’unification du Canada et des États-Unis serait de régler définitivement le problème canadien-français. « Ou bien la conquête de Québec a été une chose tout à fait sotte, notait-il, ou bien il faut souhaiter que le continent américain soit de langue anglaise et de culture anglo-saxonne. » Bien que l’opposition des Canadiens français à la guerre des Boers l’ait adouci quelque peu (il envisagea même de s’allier à Henri Bourassa* au sein d’un mouvement anti-impérialiste), il continuait de craindre, comme il le dit en 1905 à Bourassa, « l’alliance [des] aspirations nationales [des Canadiens français] avec celles d’un clergé ambitieux et agressif ». Son idéal d’homogénéité culturelle était incompatible avec une définition politique de la nation qui aurait été fondée sur la diversité culturelle, pierre angulaire de la Confédération. Pour lui, l’appel de la race était irrésistible : « De par leur sang et leur tempérament, leur langue, leur religion, leurs institutions, leurs lois et leurs intérêts, les deux portions de la race anglo-saxonne [qui habitent] notre continent forment un seul peuple. »
Qu’il ait parlé de politique, d’économie ou de la destinée du Canada, Smith semblait toujours pontifier. Pourtant, sous ses dehors assurés, dogmatiques même, se dissimulait un malaise profond. Certes, ce malaise provenait de ses propres doutes en matière religieuse, mais plus encore de son anxiété quant à l’avenir d’une société en proie au scepticisme religieux. Bien qu’il ne semble pas avoir connu la « crise de foi » qui assaillit tant de victoriens, le darwinisme et la critique historique de la Bible l’ébranlèrent certainement au point de ne lui laisser guère plus qu’un vernis de déisme et un vague humanisme fondé sur l’éthique chrétienne. Toute sa vie, il s’interrogea sur la religion ; ses réponses, contenues dans Guesses at the riddle of existence, paru en 1897, témoignent bien de sa perplexité. Toutefois, c’était toujours aux conséquences sociales du déclin de la foi qu’il revenait. Dans un essai publié en 1879 et intitulé « The prospect of a moral interregnum », il faisait observer : « Ce qui est de l’agnosticisme chez les philosophes et les gens très instruits est du sécularisme chez les artisans, et l’on peut s’attendre que bientôt, [ce sécularisme] engendrera des interrogations rebelles sur l’ordre social actuel parmi ceux qui recueillent la portion congrue et qui ne se laissent plus apaiser par la promesse de [connaître] un meilleur sort dans un autre monde. » Pendant 30 ans, il broda autour de ce thème noir, prédisant les tristes suites du déclin et de la chute de presque tout ce qu’il prenait pour des vérités éternelles. Partout se profilaient des « prophètes du désordre » – Karl Marx, Henry George, Edward Bellamy, socialistes et anarchistes de tout poil, dirigeantes de « la révolte des femmes » –, des gens qui remettaient en question l’ordre établi et ne se laissaient plus endormir par l’opium de la religion. Le ton de plus en plus strident de ses écrits montrait qu’il sentait que le monde avait continué de tourner sans lui. Il était simplement trop ancré dans ses habitudes pour admettre, comme Alphonse Desjardins*, chef du mouvement coopératif dans la province de Québec, le pressait de le faire, « que l’on [pouvait] avancer en reconnaissant que la vieille école libérale d’économie politique n’a[vait] pas tout découvert ».
Harriet Smith mourut à The Grange le 9 septembre 1909. En mars suivant, Goldwin Smith se fractura une hanche en glissant. Il mourut le 7 juin 1910 et fut inhumé au cimetière St James. The Grange, qui était demeurée la propriété de sa femme, passa à la municipalité de Toronto ; dans son testament, Harriet Smith avait demandé qu’elle soit transformée en galerie d’art publique. Les 20 000 £ que Smith avait héritées de son père avaient fructifié : au moment de sa mort, elles valaient plus de 830 000 $. Il léguait sa remarquable bibliothèque à la University of Toronto. La plus grande partie de sa fortune et tous ses papiers personnels allèrent à la Cornell University. Comme Smith l’indiquait dans son testament, il voulait ainsi prouver son « attachement d’Anglais à l’union des deux rameaux de [la] race [anglo-saxonne du] continent et [à leur union] avec leur mère commune ».
Les papiers de Goldwin Smith, constitués en grande partie de la correspondance qu’il a reçue et d’exemplaires de ses publications, sont conservés à la Cornell Univ. Library, Coll. of Regional Hist. and Univ. Arch., Ithaca, N.Y. On peut consulter ces papiers sur microfilms dans divers établissements canadiens, y compris aux AN (MG 29, D69). Le secrétaire particulier de Smith, Theodore Arnold Haultain, a compilé et publié une collection de lettres sous le titre A selection from Goldwin Smith’s correspondence, comprising letters chiefly to and from his English friends, written between the years 1846 and 1910 (Toronto, [1913 ?]) ; d’autres lettres rédigées par Smith ont été publiées dans « Letters of Goldwin Smith to Charles Eliot Norton », Mass. Hist. Soc., Proc. (Boston), 49 (1915–1916) : 106–160.
Une longue liste des publications de Smith, Goldwin Smith bibliography, 1845–1913 (Ithaca, 1972), a été compilée par Patricia H. Gaffney lorsque les papiers du sujet ont été microfilmés à Cornell ; on peut trouver d’autres éditions de quelques-unes des monographies de Smith dans le Répertoire de l’ICMH, Canadiana, 1867–1900, et le National union catalog. Ses ouvrages les plus importants sont Rational religion, and the rationalistic objections of the Bampton lectures for 1858 et Lectures on modern history, delivered in Oxford, 1859–61, tous deux publiés à Oxford et à Londres en 1861 ; The empire : a series of letters published in « The Daily News », 1862, 1863 (Oxford et Londres, 1863) ; Canada and the Canadian question (Toronto, 1891) ; Essays on questions of the day, political and social (Toronto, 1893) ; Guesses at the riddle of existence ; and other essays on kindred subjects (Toronto et New York, 1896) ; et Reminiscences, [T.] A. Haultain, édit. (New York, 1910).
Parmi les études, Goldwin Smith : Victorian liberal (Toronto, 1957), d’Elisabeth Wallace, demeure l’ouvrage de base ; celui-ci est fondé sur l’interprétation qui figure dans le chapitre sur Smith dans In search of Canadian liberalism (Toronto, 1960), 85–103, de Frank Hawkins Underhill*. On retrouve aussi cette interprétation traditionnelle dans l’article qui figure dans le DNB. Il existe aussi des études plus critiques : Malcolm Ross, « Goldwin Smith », dans Our living tradition, [1re sér.], C. T. Bissell, édit. (Toronto, 1957), 29–47 ; l’introduction rédigée par Carl Berger pour la plus récente édition de Canada and the Canadian question (Toronto et Buffalo, N.Y., 1971), vi-xvii, de Smith ; et G. [J. J.] Tulchinsky « Goldwin Smith : Victorian Canadian antisemite », dans Antisemitism in Canada : history and interpretation, Alan Davies, édit. (Waterloo, Ontario, 1992), 67–91. [r. c.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Ramsay Cook, « SMITH, GOLDWIN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/smith_goldwin_13F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:
| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/smith_goldwin_13F.html |
| Auteur de l'article: | Ramsay Cook |
| Titre de l'article: | SMITH, GOLDWIN |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1994 |
| Année de la révision: | 1994 |
| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |